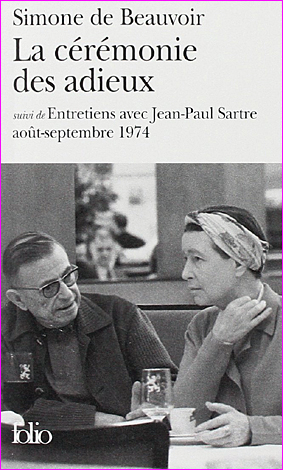
Je poursuis ma réflexion tirée des mémoires de Simone de Beauvoir et des entretiens avec Jean-Paul Sartre. La morale ne se décide pas dans l’abstrait, mais dans l’action. Sartre « comprit que, vivant non dans l’absolu mais dans le transitoire, il devait renoncer à être et décider de faire », La force des choses p.16. La liberté se réalise, elle n’est pas une donnée de nature. Il ne suffit pas d’assumer une situation mais de la modifier au nom d’un avenir qui est un projet politique. Pour Sartre et Beauvoir, c’était le socialisme communiste. « L’existentialisme définissait l’homme par l’action ; s’il le vouait à l’angoisse, c’est dans la mesure où ils le chargeaient de responsabilité », La force des choses p.20.
L’engagement est présence totale au monde. Le monde concret, physique, du corps, des amitiés, mais aussi le monde historique, le contexte social. La vérité se mesure aux conduites, pas aux phrases. L’exigence est avant tout morale. « Les petits-bourgeois qui lisaient (Sartre) avait eux aussi perdus leur foi dans la paix éternelle, dans un calme progrès, dans des essences immuables ; ils avaient découvert l’histoire sous sa figure la plus affreuse (…). L’existentialisme s’efforçait de concilier histoire et morale », La force des choses p.62.
« Je ne pouvais pas être libre seul » dit Sartre, La force des choses p.332. L’exigence morale est un héritage culturel, celui de la Révolution française : « Au nom des principes qu’elle m’avait inculqués, au nom de son humanisme et de ses ‘humanités’, au nom de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, je vouais à la bourgeoisie une haine qui ne finira qu’avec moi », La force des choses p.357. Sartre a découvert chez Marx que les hommes concrets incarnent des intérêts de classe et que la lutte est quotidienne et sans pitié. Foin des grands principes, les intérêts matériels priment (richesse, pouvoir, élitisme). Sartre voulait rétablir l’exigence des grands principes.

Pour lui, les travailleurs (puis les Mao en 68) essaient de constituer une société morale, c’est-à-dire « où l’homme désaliéné puisse se trouver lui-même dans ses vrais rapports avec le groupe », La cérémonie des adieux p.47. Où l’on voit que le marxisme de Sartre est plus philosophique que politique. En bon individualiste, pas question de juger qu’en tout le parti a toujours raison. « Ce qui dépend de nous c’est la liberté ; donc on est libre en toute situation, en toutes circonstances ». Il s’agit au fond d’une liberté stoïcienne. « La liberté et la conscience, pour moi, c’était pareil. Voir et être libre, c’était pareil. Parce que ce n’était pas donné, en le vivant, j’en créais la réalité. (…) La liberté rencontrait des obstacles et c’est à ce moment-là que la contingence m’est apparue comme opposée à la liberté. Et comme une espèce de liberté des choses, qui ne sont pas rigoureusement nécessitées par l’instant précédent », Entretiens p.497.
Pour faire triompher la liberté, il est nécessaire d’agir sur l’histoire. « Le Bien, c’est ce qui sert la liberté humaine, ce qui lui permet de poser les objets qu’elle a réalisés, et le Mal c’est ce qui dessert la liberté humaine, c’est ce qui présente l’homme comme n’étant pas libre, qui crée par exemple le déterminisme des sociologues d’une certaine époque », Entretiens p.617. C’est aussi l’Autorité, validée par l’Important, ce type d’homme que renie Sartre : « L’important, ou bien feint de mépriser les gens ou prétend à leur vénération : c’est qu’il n’ose pas les aborder sur un pied d’égalité », La force des choses p.168.
Dans sa quête, Sartre pouvait tâtonner, mais il ne se fermait jamais. « Tout au long de son existence, Sartre n’a jamais cessé de se remettre en question ; sans méconnaître ce qu’il appelait ses ‘intérêts idéologiques’, il ne voulait pas y être aliéné, c’est pourquoi il a souvent choisi de ‘penser contre soi’, faisant un difficile effort pour ‘briser des os’ dans sa tête », La cérémonie des adieux p.13. C’est cette capacité de remise en cause et de renouvellement qui me rend Sartre sympathique. Malgré ses erreurs et ses choix contestables, surtout à la fin de sa vie où il est devenu sénile, je continue à voir en lui le modèle même du philosophe contemporain, une conscience libre animée d’un doute raisonnable. Est-ce un effet de « sa répugnance à entrer dans l’âge adulte ? », La cérémonie des adieux p.41. Les Mao le rajeunissent par leurs exigences morales mais Sartre, déjà vieux et malade, a confondu leur spontanéité avec la vérité, leur violence avec la libération, leur entêtement avec des convictions.
Il aimait la jeunesse parce qu’il aimait la vie. Mais aussi par ce qu’il pensait que vieillir sclérose et rend plus avare que sage, plus conservateur que novateur. « L’homme est aussi un être hiérarchisé, et c’est en tant que hiérarchisé qu’il peut devenir idiot ou qu’il peut préférer la hiérarchie à sa réalité profonde », Entretiens p.354. Il s’agit de ce qu’il appelait « les faux-jetons ». « La hiérarchie, c’est ce qui détruit la valeur personnelle des gens », Entretiens p.362. Ce pourquoi, au fond, l’idée de Dieu ne lui était pas nécessaire : « Je n’ai pas besoin de Dieu pour aimer mon prochain. C’est un rapport direct d’homme à homme, je n’ai nul besoin de passer par l’infini » Entretiens p.624.

Cela n’empêche pas qu’il y ait diverses qualités d’homme. « Pour moi, le génie et le surhomme, c’était simplement des êtres qui se donnaient dans toute leur réalité d’homme ; et la masse qui se classait suivant des chiffres, suivant des hiérarchies, c’était une pâte dans laquelle on pouvait trouver des surhommes qui allaient venir, qui allait se dégager » Entretiens p.348. La hiérarchie n’existe donc pas de nature mais est l’effet de la liberté humaine. Elle se construit, se constate, se remet en cause à chaque instant. « Je pense que, en fait, chacun a en soi, dans son corps, dans sa personne, dans sa conscience, de quoi être sinon un génie, en tout cas un homme réel, un homme avec des qualités d’homme ; mais que la majorité des gens ne le veut pas, elle s’arrête, elle s’arrête un niveau quelconque, et finalement elle est presque toujours responsable du niveau auquel elle est restée. Je considère donc que, en théorie, tout homme est l’égal de tout homme et des rapports d’amitié pourraient exister. Mais en fait cette égalité–là est défaite par les gens au nom d’impressions stupides, de recherche stupide, d’ambitions, de velléités stupides » Entretiens p.352.
Chacun façonne ce qu’il est et c’est là que Sartre se montre le meilleur : dans cette conscience de la réalité humaine. « J’aime vraiment, réellement, un homme qui me paraît avoir l’ensemble des qualités d’homme ; la conscience, la faculté de juger par soi-même, la faculté de dire oui ou non, la volonté, tout ça, je l’apprécie dans un homme ; et ça va vers la liberté. À ce moment-là, je peux avoir de l’amitié pour lui, et souvent j’en ai pour des gens que je connais fort peu. Et puis il y avait la majorité, les gens qui étaient à côté de moi, dans un train, dans un métro, dans un lycée, à qui authentiquement je n’avais rien à dire ; on pouvait tout juste discuter, en se mettant sur le plan des hiérarchies » Entretiens p.352.
Simone de Beauvoir, La force des choses et Entretiens avec Sartre, 1976, Folio
- Tome 1, 384 pages, €8.40 e-book Kindle €7.99
- Tome 2, 507 pages, €9.00 e-book Kindle €8.99
Simone de Beauvoir, La Cérémonie des adieux, suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre : Août – Septembre 1974, Folio 1987, 624 pages, €10.20 e-book Kindle €9.99
Simone de Beauvoir, Mémoires, tome 1 et 2, Gallimard Pléiade 2018, 3200 pages, €139.00

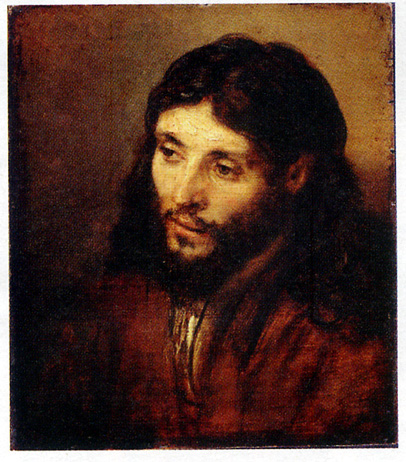
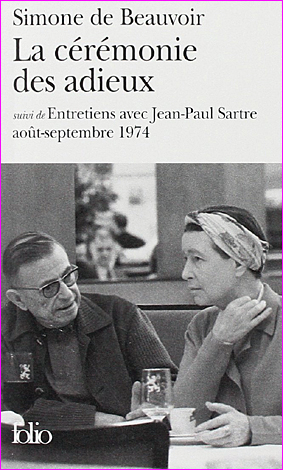


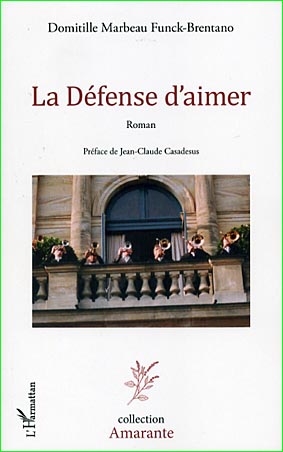

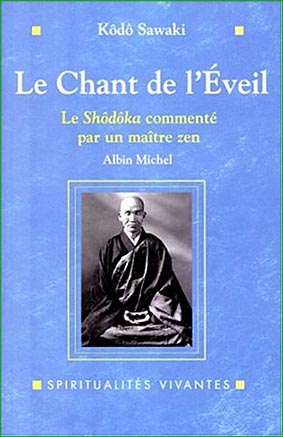
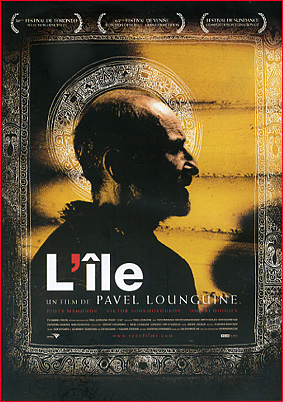





























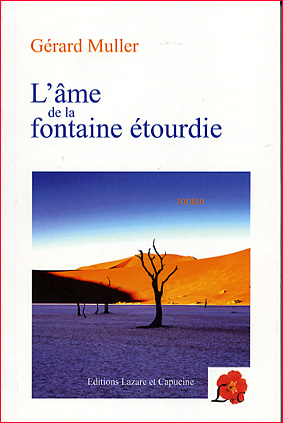












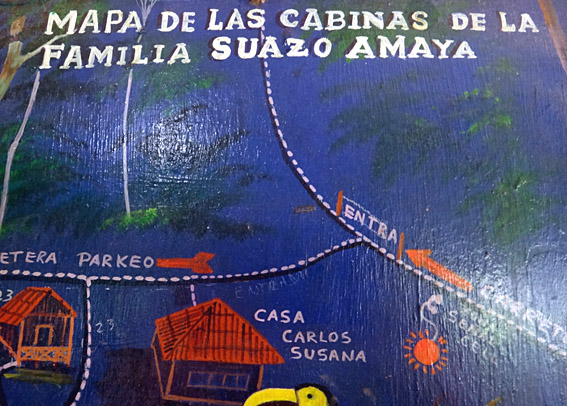






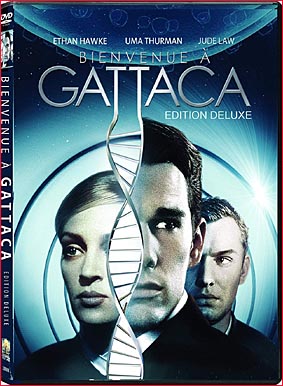




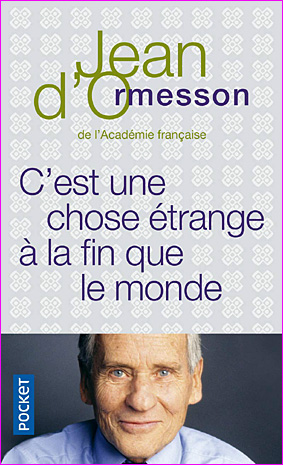










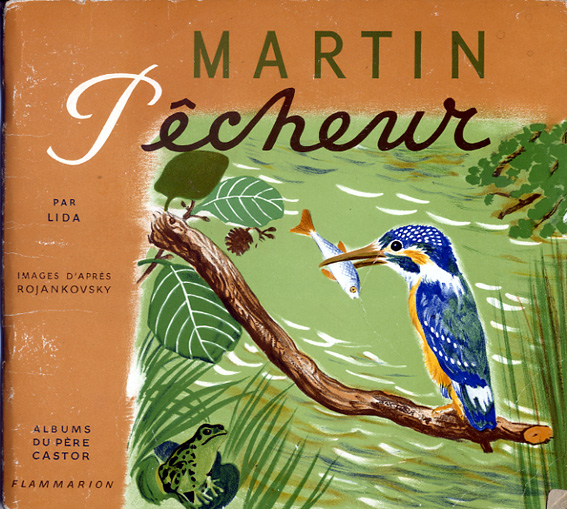

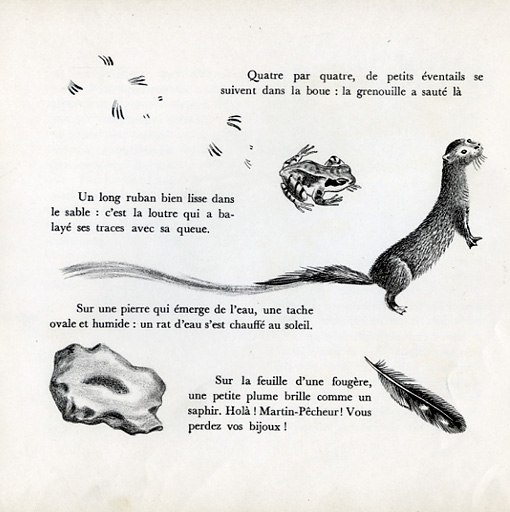

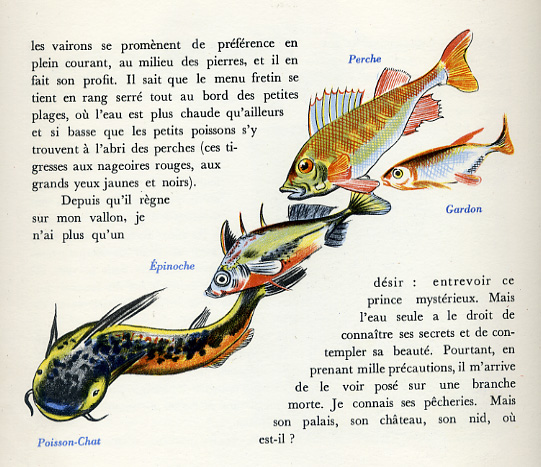
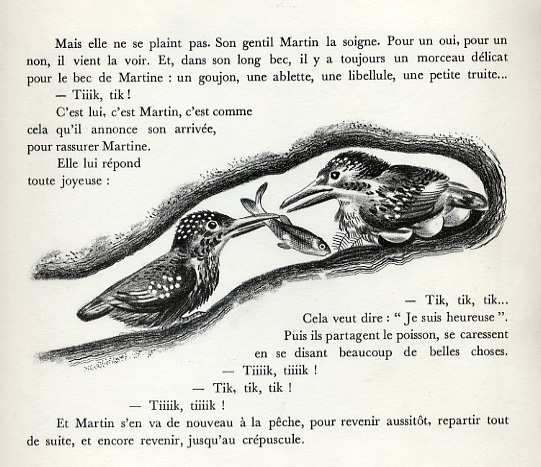
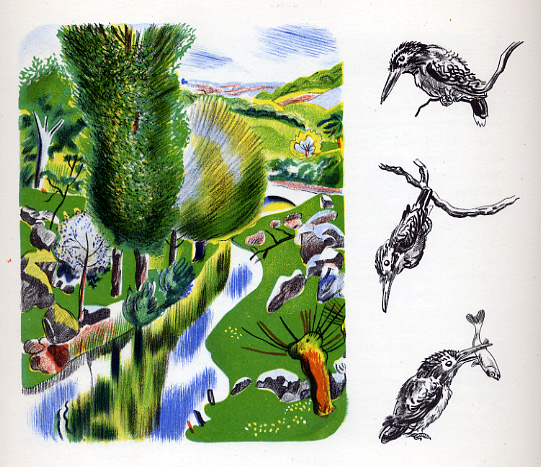











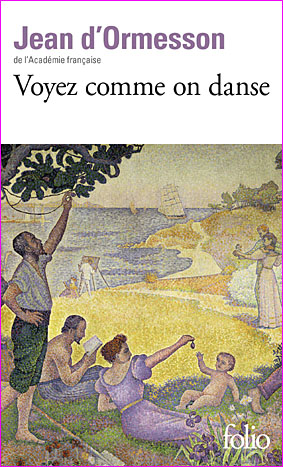







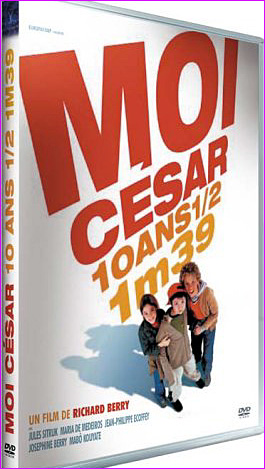












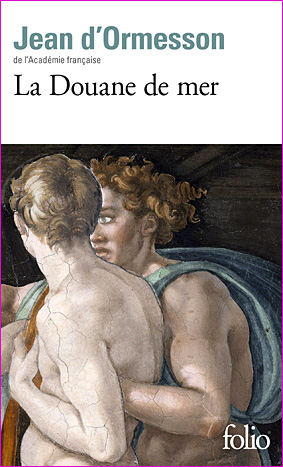






























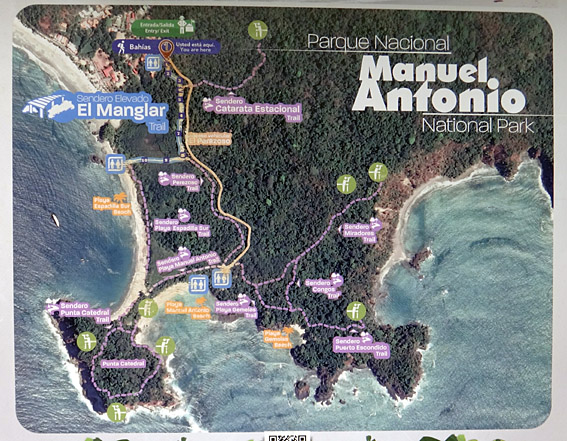










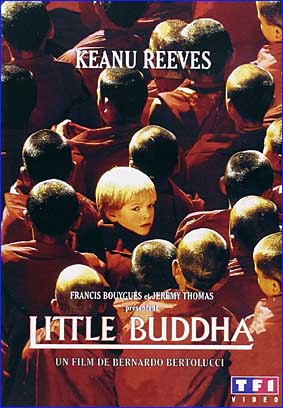






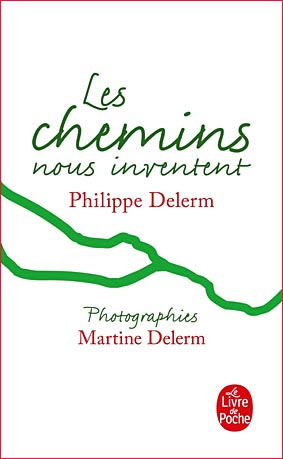







Commentaires récents