Curieux objet que ce livre qui commence par un délire imaginaire comme un trip à l’acide d’où l’auteur revient « fatigué, la tête te tourne » (mais après l’étonnante réminiscence sensuelle d’un village gaulois), et qui se termine dans les envolées philosophiques sur le présentisme en histoire – une thèse ultracontemporaine qui pourrait bien ne pas résister au temps et passer de mode. Entre les deux, peut-être une collection d’articles revus et organisés en plan chronologique pour aboutir à la « mémoire » gauloise.
Les voix du passé rappellent combien « les Gaulois » ont été vus avant tout comme anti Grecs et Romains – donc « barbares » – combattant nus et mettant en avant leurs plus féroces guerriers dans les clameurs fusionnelles des compagnons. Inorganisés, animaux, hâbleurs, bâfreurs et buveurs, « fainéants retors » et « méprisant tout le monde » (p.54), les Gaulois sont devenus l’anti-modèle de « la » civilisation, ce juste milieu du milieu du monde qu’est à l’époque la Méditerranée. « Que manque-t-il donc aux Gaulois ? Tout ce qui fait la force des Romains : la réflexion, la détermination, le courage dans l’adversité, mais aussi la prudence, la fidélité aux institutions et l’obéissance aux lois » p.57. On croirait lire une critique des Gilles et Jeanne de notre temps. En bons bobos écolos, les Romains selon Strabon au début du 1er siècle de notre ère, reprochent aux Gaulois de se nourrir surtout de lait et de viande, délaissant les produits élémentaires de l’agriculture. Mais les Celtes ont évolué en deux millénaires, les Keltoïs évoqués par les premiers historiens grecs comme Hérodote (probablement tous les non-Grecs au nord du pays) ayant peu à voir avec les Galli dépeints par César.
La Gaule sort de terre lorsque les Européens du XVe siècle découvrent les « Indiens » nus d’Amérique et réfléchissent au « bon sauvage ». Nos émotions inhibent notre raison et nous empêchent de chercher la signification des actes que nous observons. Ce qui se produit avec l’Amérique a dû se produire avec les Antiques. C’est alors que les fouilles de hasard commencent à reconnaître la Gaule dans les objets matériels : « nous aussi avons été sauvages » p.102. Mais « jusqu’aux années 1860, on ne sait pas à quoi ressemble la culture matérielle des Gaulois » p.111. Les sources historiques ont conduit à interpréter faussement les vestiges – jusqu’aux découvertes suisses et celles d’Alise (Alésia). Les découvertes se succèdent, y compris celles de tombes ornées : il peut donc exister un art des peuples non civilisés. L’Allemand Jacobsthal, dans les années 1920, reconnait un authentique art celtique, « attirant et repoussant ; il est loin de la primitivité et de la simplicité, il est raffiné en pensée et en technique, élaboré et intelligent, ; pleine de paradoxes, sans cesse en mouvement, curieusement ambigu, rationnel et irrationnel, sombre et étrange – loin de l’humanité aimable et de la transparence de l’art grec » p.138. « C’est fondamentalement qu’ils n’ont pas le goût du réalisme », ajoute Henri Hubert p.139, chargé d’organiser le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain en Laye, le prédécesseur de l’auteur. André Breton récupérera ces « forêts de symboles » de l’art gaulois au profit du surréalisme p.143.
Mais la résurgence du passé n’est pas neutre. Le nationalisme exacerbé des XIXe et XXe siècles a teinté les gauloiseries d’antigermanisme primaire et rejeté le monde anglo-saxon aux marges. « La guerre des Gaules est relue sous l’aspect d’une lutte nationale contre l’oppresseur étranger » p.160. Les Gaulois ne sont qu’une branche des Celtes, coincés entre la Belgique et l’Aquitaine, les Helvètes et la Province (Provence) romaine ; quant aux Germains raciaux de Kossinna, ils sont vus par des préjugés développés en erreurs. Les nazis se prévalent des seconds, les français vaincus des premiers : « Pétain se drape littéralement dans les symboles de la Gaule éternelle » : yeux bleus, moustache fournie, francisque de Vercingétorix (p.165). Car le passé est hybride : « il est simultanément objet (d’investigation, de connaissance) séparé de nous et projection, transfert du plus profond de nous-mêmes » p.209. C’est ainsi que les grands guerriers gaulois ont autour d’eux une cour d’amis proches et de fidèles, les soldures, ne connaissent pas la neutralité de l’Etat mais les liens d’homme à homme – bien qu’élus pour un an et pour la guerre. L’usage de la force est décidé collectivement et la violence personnelle qui a tant frappé Grecs et Romains est déléguée par la collectivité – comme dans l’Iliade. La parole du barde transforme les gestes du roi en prestige, dont le plus grand est de redistribuer les richesses. Cette économie du don n’est pas viable dès lors qu’une économie proche fonctionne sur l’accumulation : « Les fondements d’un échange inégal se mettent donc en place. Plus exactement, une économie marchande étrangère vient se greffer sur une économie indigène du don et de la dette, qu’elle exploite comme une source intarissable de profits » p.257. Aujourd’hui voit rejouer le même écart : socialistes français dépensiers clientélistes contre capitaliste anglo-saxons avisés…
Ce n’est que dans la dernière partie, Mémoire gauloise, que l’auteur se prend enfin à évoquer pour aujourd’hui les Celtes et les Gaulois du passé. La science gauloise est attestée par « les créations des géomètres celtiques », proche des pythagoriciens p.268. Pour l’auteur, l’histoire est composée de traces matérielles, écrites ou conservées sous la terre, en bref une archéologie. Le « passé » est toujours vu avec l’œil d’aujourd’hui, un aujourd’hui qui ne cesse de changer avec le temps qui passe. En bref, « les Gaulois » ne seront jamais figés en une essence immuable mais toujours observés avec un œil neuf – différent – en une « convergence temporelle » p.284. Après « l’histoire nationalisée » de la fin du XIXe et du début du XXe siècle a succédé une « histoire socialisée » dans l’entre-deux guerres ; aujourd’hui verrait « une archéologie de la mémoire historique » – « un présent compressé du présentisme » selon l’auteur (p.293).
Intéressant, inégal, trop long et parfois répétitif sur la « philosophie » de l’histoire, ce livre d’un conservateur du musée des Antiquités nationales incite à revoir les Gaulois parmi les Celtes et les Celtes parmi les Grecs et les Romains. Il incite surtout à sortir des mythes reconstruits et des récupérations régionalistes ou nationalistes qui ne servent pas le savoir.
Laurent Olivier, Le pays des Celtes – Mémoires de la Gaule, 2018, Seuil collection L’univers historique, 334 pages, €23.00 e-book Kindle €16.99
Voir aussi sur ce blog :

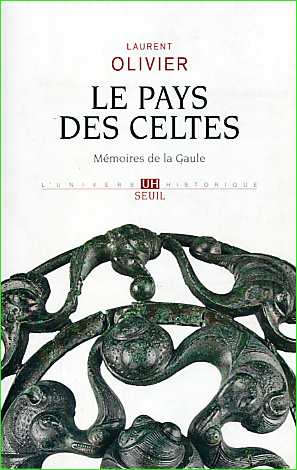






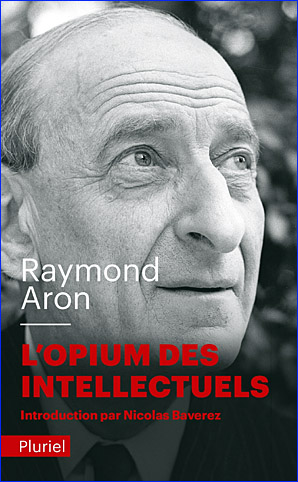



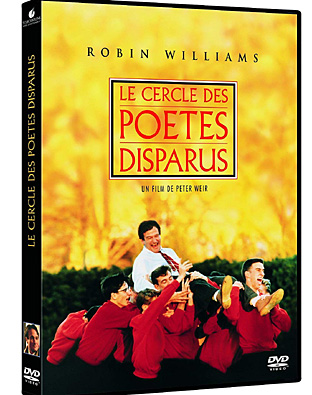

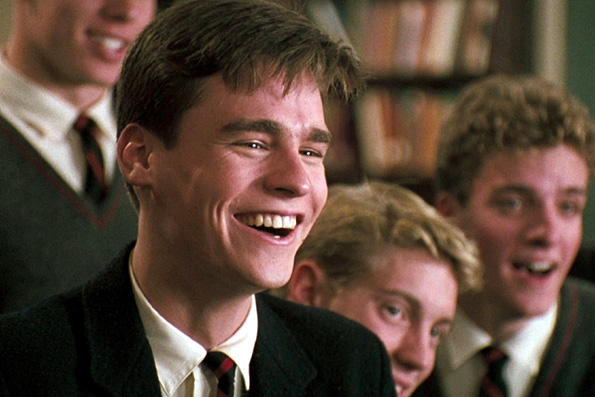





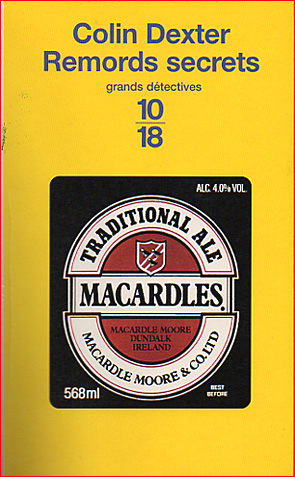


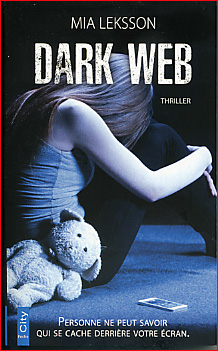


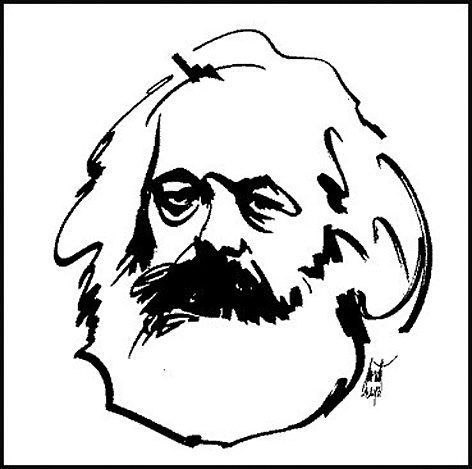
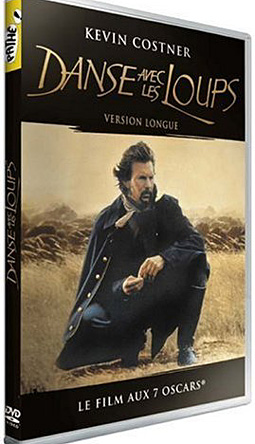





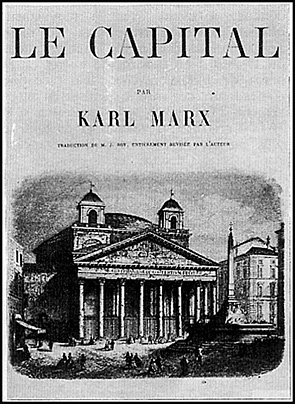
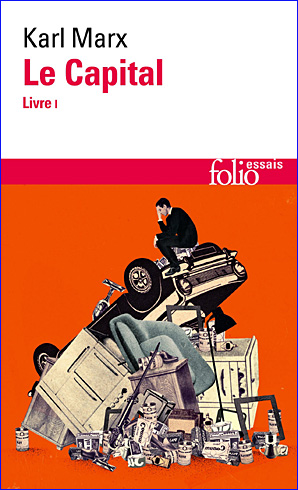

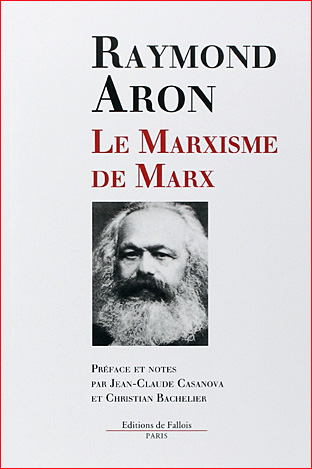

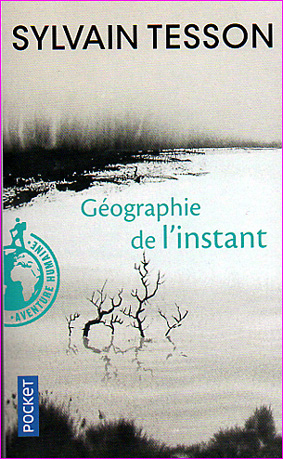



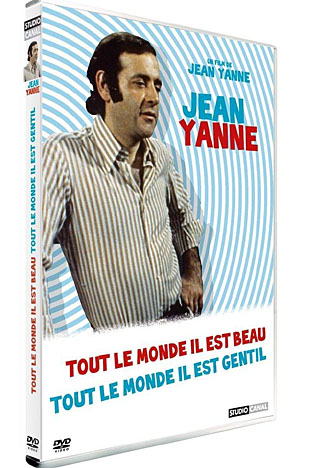



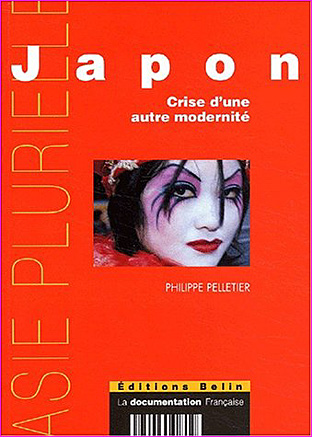
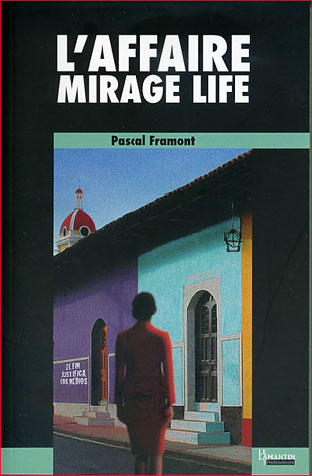

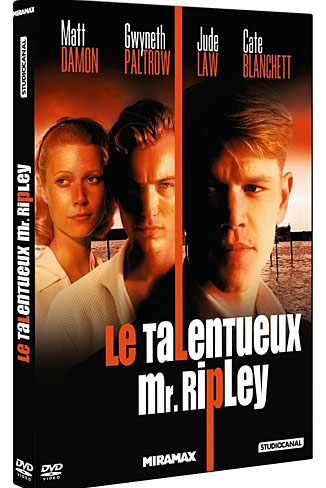
















Commentaires récents