
Il y a un peu plus d’un siècle, voler était encore un rêve industriel. Chacun bricolait dans son coin les plus invraisemblables coucous aptes à s’élever lourdement du sol en poussant des ahans de canard. Mais certains, plus affinés, mettaient déjà des moteurs de plusieurs dizaines de chevaux sur une armature légère en bois, ce qui leur permettait de parcourir de longues distances. C’est ainsi que l’ingénieur français Louis Blériot avait franchi la Manche en 1907 sur un avion prototype de son invention.

Qu’à cela ne tienne : en 1910 l’Angleterre, maîtresse des mers, se doit d’être aussi maîtresse des airs ! L’orgueil britannique, sous l’uniforme rouge d’un jeune officier blond très coincé, Richard Meys (James Fox), stimulé par son espoir de fiancer Patricia (Sarah Miles), entreprend le riche patron de presse et père de la promise lord Rawnsley (Robert Morley) pour qu’il organise une fête de l’aviation afin de réunir tous les prototypes actuels d’avions. Le vieux lord à cigare va donner sa fille au fringuant jeune militaire de la haute société car il a été avec son père à Oxford – cela crée des liens d’entre-soi incestueux tout à fait recommandables. Patricia voudrait bien être la première femme à voler dans les airs mais, à cette époque, il n’en est pas question. Déjà, elle fait de la moto à l’insu du paternel.
Néanmoins, le patron de presse est prêt au scoop. Il lance donc une course aérienne entre Londres et Paris dotée d’un prix de 10 000 livres sterling au vainqueur, ce qui fait à l’époque une belle somme. Les avions auront plusieurs aérodromes de relais pour faire le plein. Les pilotes dans le monde sont enthousiastes. Chacun est renvoyé à la caricature de sa nation par l’époque du film : le milieu des années 60.

L’Américain Orvil Newton (Stuart Whitman) se ruine pour participer avec un prototype de 70 chevaux (le Blériot n’en faisait que 25). Il ose et met de la puissance plutôt que de l’astuce. C’est un lourd et un cascadeur, mais aussi un bulldozer. Sa force et son audace séduisent la belle Patricia, qui le drague éhontément pour pouvoir enfin voler malgré l’interdiction de son père. Ce qu’elle réussira, faisant rayer Orvil de la course, avant d’intercéder pour qu’il puisse quand même participer parce que ce n’est pas de sa faute mais dû à son caprice de fille gâtée.


Le Français Pierre Dubois (Jean-Pierre Cassel), grand amateur du même type de femme – toujours la même malgré les prénoms qui changent (Irina Demick, 29 ans au tournage), est plus astucieux, même s’il n’a pas la puissance. Grand amateur de blagues, il ne tarde pas à se mettre à dos le gros colonel prussien qu’il ridiculise en l’incitant à plonger là où il n’y a pas d’eau, engendrant un duel. Comme il a le choix des armes, il opte pour le tromblon en ballon, ce qui est l’occasion d’une scène cocasse où le lourd teuton se ridiculise une fois de plus en plantant son casque à pointe dans son propre ballon, crevant le duel avec l’engin.
L’Allemand colonel Manfred von Holstein (Gert Fröbe) est mandaté par le Kaiser pour gagner la course. Il organise l’opération avec une rigueur toute militaire, marche au pas, musique martiale, lever des couleurs, obéissance aveugle au Manuel d’instruction de l’avion. Ni lui, ni le capitaine qu’il veut pour pilote n’a jamais touché un tel engin mais « un officier allemand est capable de tout faire ». Obstination et discipline ne lui réussiront pas : il perdra la course en plongeant en pleine Manche parce qu’il se fie trop aux instruction du Manuel et qu’il est incapable de gérer l’avion s’il n’a plus le texte sous les yeux.


Le comte italien Emilio Ponticelli (Alberto Sordi), toujours flanqué de la Mama et des bambini, pas moins de six dont trois garçons en costume marin, est tout dans l’apparence et la gouaille. Il achète n’importe quel prototype, s’il peut voler. Toujours légers, les Italiens… Son inventeur un peu taré lui propose même un modèle qu’il a conçu dans sa baignoire et dont l’hélice est derrière. Heureusement, il choisit un autre avion, qui faillira in extremis, ce qui permettra à l’Américain de faire un beau geste : se retarder – donc perdre – pour sauver le pilote comte.
Le Japonais Yamamoto (Yujiro Ishihara) se conduit comme un samouraï, mais pas kamikaze. On lui colle un modèle copié d’Occident, des ailes américaines sur un moteur français. Son avion n’ira pas jusqu’au bout, saboté par le perfide british Sir Percival aux dents du bonheur.

Les autres concurrents ne comptent pas, sauf la crapule très britannique de Sir Percival Ware-Armitage (Terry-Thomas) flanqué de son âme damnée domestique Courtney (Eric Sykes). Il veut gagner par la triche, faute de pouvoir le faire en fair-play. Il va donc scier le train d’atterrissage de l’avion américain tandis que Courtney va scier la queue de l’avion japonais. Mais il fait plus : il soudoie pour une forte somme un équipage de chalutier pour transporter de nuit son avion de l’autre côté de la Manche, tout en déclarant qu’il poursuit le vol pour la traverser. Le sort lui sera in fine défavorable puisqu’en suivant la voie ferrée (du futur TGV) qui relie Calais à Paris, il sera pris par la fumée du train à vapeur et atterrira sur les wagons, ses roues se bloquant entre deux rames – et un tunnel propice raccourcissant l’avion de ses ailes en moins de deux.


Outre les sketches, le capitaine des pompiers (Benny Hill) et l’auto à échelle qui roule partout mais ne sert à rien, l’amourette intéressée de Patricia avec Orvil et la jalousie de classe de Richard, mettent un peu de piment dans la sauce. Le film fait gagner évidemment les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale encore proche, les Anglais d’abord, les Américains presque ex-æquo, le Français en troisième – Allemand, Italien et Japonais sont éliminés par leurs erreurs, rigidités et impuissance technique.
Malgré un « interlude » interminable sur le DVD, pour singer l’ambiance des films muets de 1910, ce divertissement à propos de l’aviation est agréable à suivre. On rit beaucoup et tout est bon enfant.
DVD Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines (Those Magnificent Men in their Flying Machines, or How I Flew from London to Paris in 25 Hours and 11 Minutes), Ken Annakin, 1965, avec Jean-Pierre Cassel, Stuart Whitman, Benny Hill, Sarah Miles, Alberto Sordi, Terry-Thomas, Yujiro Ishihara, 20th Century Studios 2005, 2h13, €20,05
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)


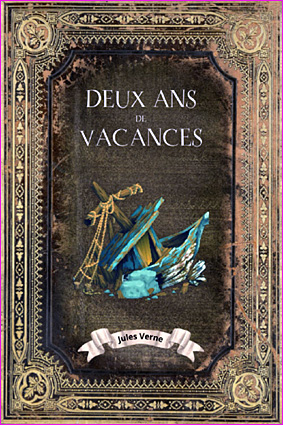

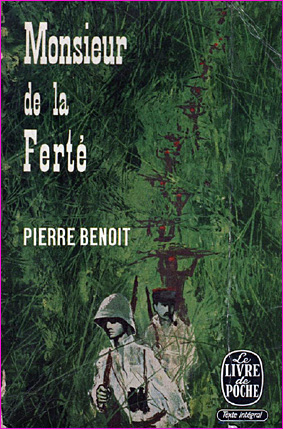

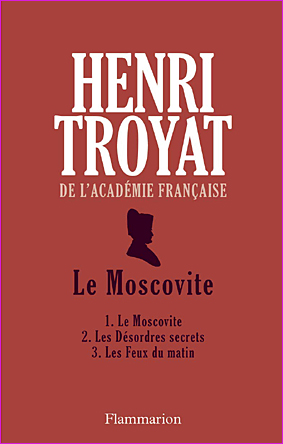

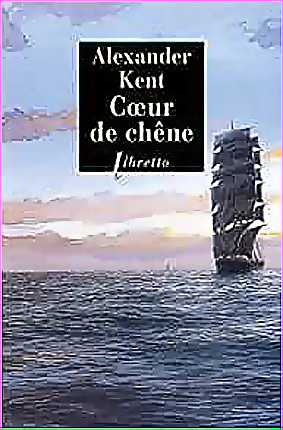
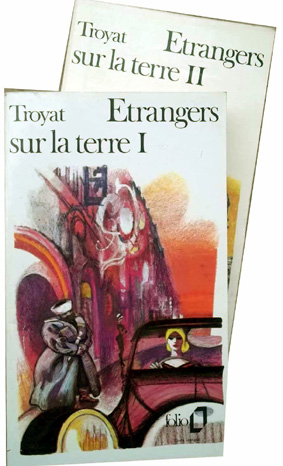












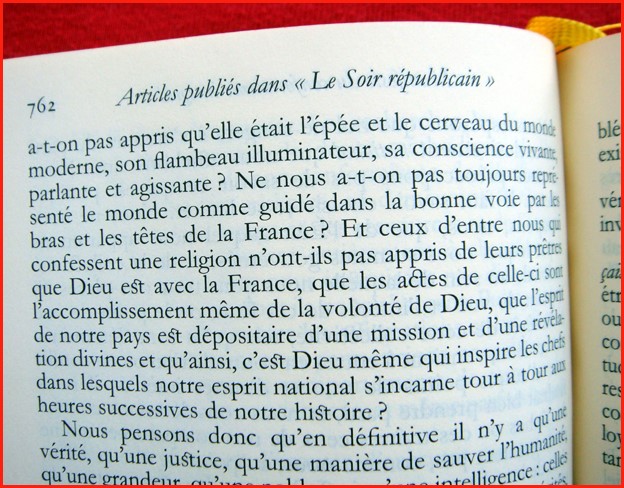

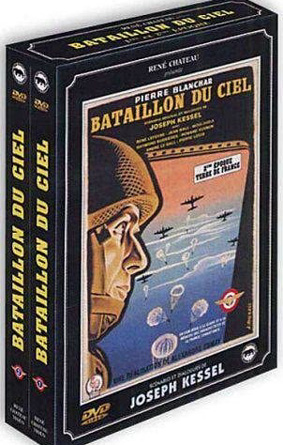




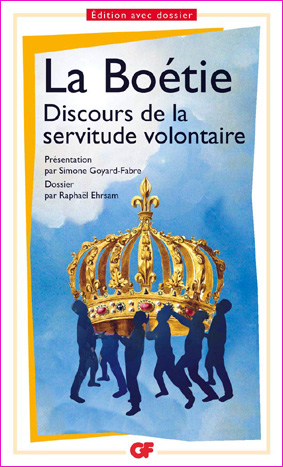


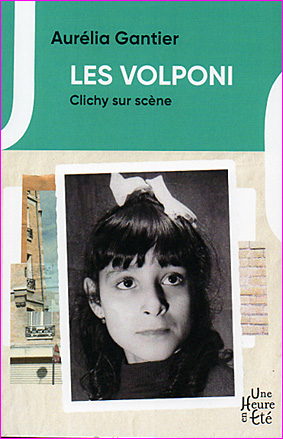
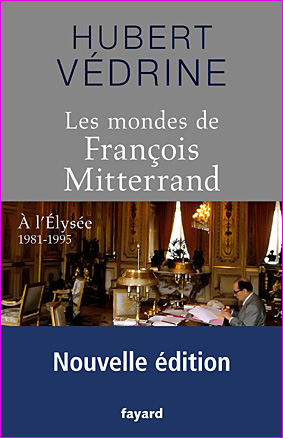




















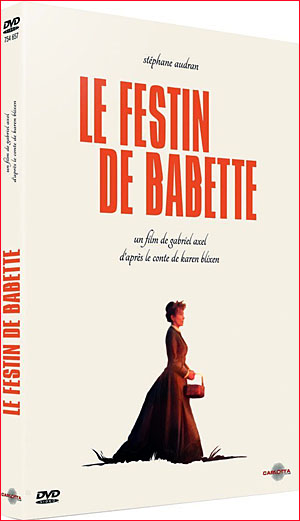







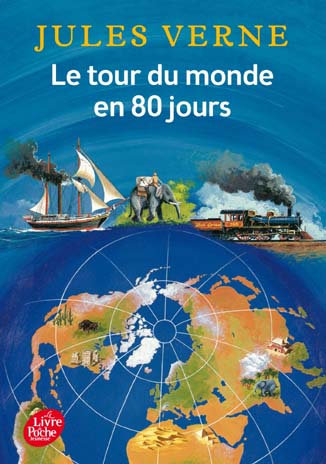

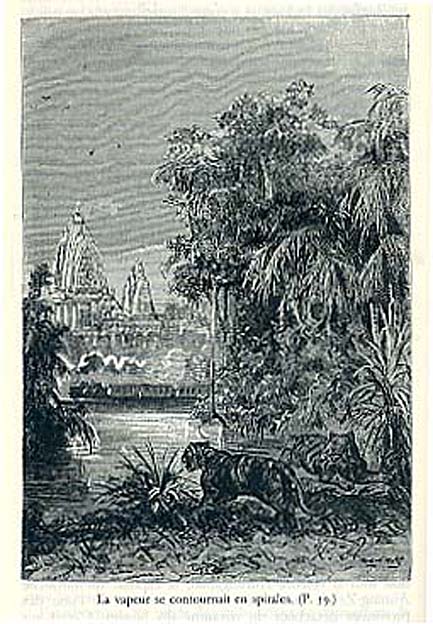
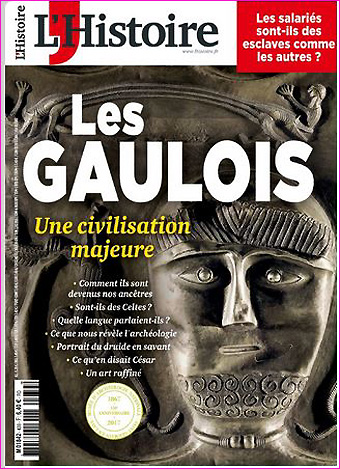


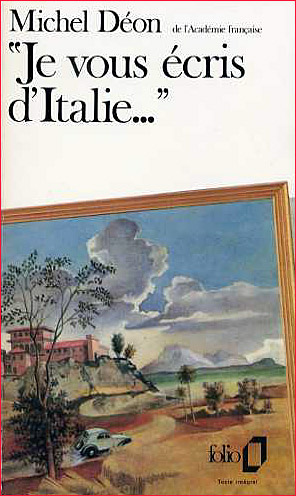











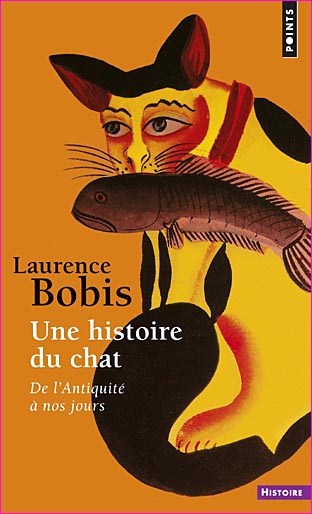




Commentaires récents