J’avais encore 15 ans lorsque je découvris le stoïcisme, en classe de seconde. Je me souviens que cette philosophie nous avait alors enthousiasmés, filles et garçons. Était-ce sa parenté avec la morale chrétienne dont tant d’entre nous étaient nourris ? Était-ce cette fierté tranquille devant l’adversité, et surtout face à tous ceux qui veulent asservir les hommes ? Était-ce l’ascétisme et les difficultés du chemin proposé par ces maîtres antiques qui venaient toucher en nous une passion adolescente de pureté et de dureté ? Toujours est-il que nous en avons discuté passionnément, avec tout le sérieux d’une pensée qui s’éveille, et l’avidité de qui fait l’inventaire d’un trésor. L’envie m’a pris de relire Marc-Aurèle, Épictète et autres textes stoïciens. J’ai retrouvé, par bouffées, le souffle de mes 15 ans. Pour moi, la philosophie stoïcienne restera toujours jeune.
Pour les stoïciens, la philosophie est analogue à un champ dont la logique est la clôture, la physique la terre et la morale le fruit. Ils la comparent également à un animal dont les os et les nerfs sont l’art de penser, la chair est la morale et l’âme la physique. La connaissance de la nature par la logique, ou art de raisonner, fonde la morale.
La logique
La primauté revient aux sens, qui saisissent les sensations. Le choc des représentations sur l’esprit humain modifie la tension de l’âme. Si le choc provient d’un objet réel, s’établit une tension entre le sujet et l’objet : telle est la compréhension, art de prendre par l’esprit comme si l’on prenait à la main. Cette représentation compréhensive n’est ni bonne ni mauvaise. Elle ne le devient que par l’assentiment de la raison, qui créera la science appelée aussi compréhension ferme et assurée. La science porte sur des événements et non sur des concepts. Ces derniers naissent dans l’abstrait, de l’imagination ; ils ne sont pas une représentation mais un mouvement vain de l’âme. La confrontation de la sensation à la raison, qui fonde la connaissance, a pour but de mettre en harmonie l’expérience intérieure et l’expérience qu’on a de l’extérieur. La connaissance est une reconnaissance où la raison découvre sa parenté avec la nature environnante.
D’où l’importance donnée à la dialectique, art de raisonner qui fait saisir le difficile à l’aide du simple, et qui enchaîne les propositions selon les lois du langage. Raisonner justement, c’est à la fois être vertueux (agir en harmonie avec le divin) et découvrir le vrai (mesurer l’harmonie du divin). En découvrant sa fonction intelligente, l’homme découvre le bien-fondé du raisonnement : la mise en ordre des événements et des mots est analogue à la mise en ordre du monde par le destin. L’âme découvre ainsi qu’elle est une part de l’énergie qui meut l’univers.
La logique n’est pas un outil, mais en elle-même une vertu. Elle est la méthode qui permet de ne pas donner son adhésion au faux et trouve donc sa fin en elle-même.
La physique ou science de la nature
Le monde est un vivant animé. Il est formé de deux principes : l’un passif – la matière formée des quatre éléments qui composent tout ce qui existe et en lesquels tout se résout ; l’autre actif – la raison qui agit dans la matière et qui l’ordonne. Cette raison peut être appelée Dieu, qui est un ordre de la matière, une cause première et un architecte qui harmonise tous les biens et tous les maux dans la grande unité. Qualité inséparable de la matière, Dieu est répandu à travers l’univers entier « comme le miel à travers les rayons » (Tertullien). Sa volonté est la Providence, sagesse supérieure qui fait mouvoir les choses. Les lois du mouvement, dans la matière comme dans le monde, sont le destin (nœud de causes que nul ne peut dénouer) et la force qui anime la sympathie universelle dans la durée. La substance totale de l’univers est une : « tout est dans tout » (Sénèque). Une goutte de vin versée dans la mer, disait Chrysippe, se mêlera à tout l’océan et s’étendra au monde entier. Cette sympathie des choses exprime la présence du divin à travers l’univers. L’homme, part de l’univers et part du souffle divin qui l’anime, est citoyen du monde.
La morale
La logique qui permet de découvrir le vrai, et la physique qui est connaissance de la nature et de l’intelligence divine, fondent la morale.
La raison humaine est à la fois partie maîtresse qui commande les sens de chaque individu, et part de l’esprit divin universel. Elle permet donc de connaître le principe directeur de la nature et de distinguer s’il y a accord entre la nature de l’homme et celle de l’univers. La raison permet de saisir le dessein de Dieu « pour gouverner toutes choses avec justice » (Stobée). L’homme peut ainsi comprendre que tout dans le monde est la cause coopérante de tout, ce qui se produit est toujours un enchaînement harmonieusement réglé. Rien ne sert de s’insurger contre l’ordre du destin. L’homme fait partie de la nature et doit conformer son action à la nature.
Seules les choses qui dépendent de nous sont libres. Le reste est la providence, qui arrive avec justice, suivant la loi divine infuse dans l’univers. Éclairé par la raison, le sage acquiesce aux événements du monde sur lesquels il n’a pas prise. Ainsi est-il roi, car « la royauté est un pouvoir qui n’a pas de comptes à rendre, ce qui n’appartient qu’aux seuls sages » (Diogène Laërce).
La seule morale est donc de vivre selon la raison, ce qui veut dire vivre selon la nature, en harmonie avec la volonté suprême qui organise le tout. Le bien est alors ce qui est utile, car l’utile concourt à organiser la nature suivant l’ordre divin. L’homme distingue le bien par la connaissance, puis choisit de s’y conformer parce qu’il sait que ce qui est bien est conforme à la nature. Les vertus, les réflexions, la justice, le courage, la sagesse, sont des biens. Les maux sont le contraire. Mais ce qui n’est ni utile ni inutile, et dont on peut se servir pour le bien et le mal, est indifférent : ainsi la vie ou la mort, la santé ou la maladie, le plaisir ou la douleur, la beauté ou la honte, la force ou la faiblesse, la richesse ou la pauvreté, la gloire ou l’obscurité, la noblesse ou la basse naissance.
Le bonheur se recherche, il n’est pas donné. Il est de vivre en harmonie avec soi, donc en sympathie avec l’univers et avec l’être qui l’anime. La pratique de la vertu s’accompagne de joie, car la vertu est une perfection en commun, un accord avec le tout. Au contraire, la pratique du vice est source de chagrin car l’harmonie est rompue, l’irrationnel et la démesure font naître passions et désirs qui tourmentent.
Certes, le mal est nécessaire à la beauté du monde, il fait ressortir par contraste l’harmonie du bien. Tout mouvement s’accompagne de rupture de l’équilibre, ce qui engendre souffrance durant la transition vers un nouvel équilibre. Le mal n’est pas un péché absolu mais une erreur due au déséquilibre, à la démesure, à la disharmonie, à l’imprudence. Le sage ne supprime pas les désirs, il les contrôle par la raison. Sa volonté n’est pas froide et calculatrice, mais fondée sur le désir et la passion ; encore faut-il que la mesure l’emporte sur l’excès, et que l’irrationnel soit dompté par la raison. Le but est la sagesse comme maîtrise de soi et conscience autant de ses propres possibilités que de ses limites. La science est le départ d’une adhésion consentie : non pas une connaissance pour dominer, mais un savoir pour être conscient.
Se connaître – tel est encore une fois le maître mot.
Aujourd’hui, nous savons à peine ce qu’est la sagesse. Nous savons encore moins ce qu’est la mesure. Quant à la « raison », elle est presque devenue hors mesure, une passion qui s’emballe, un orgueil scientiste, un déséquilibre ravageur des instincts. La raison positiviste n’est pas la raison stoïcienne. Il y a amputation, dessèchement, car le positivisme agit sur des concepts et non sur des événements. La raison y est entendement qui tourne à vide, connaître pour connaître, vendre pour vendre, travailler pour travailler, baiser pour baiser. La raison n’est plus méthode de vertu ni recherche de l’harmonie entre les hommes et avec le monde.
Ce qui me plaît le plus dans la philosophie stoïcienne est justement ce lien profond entre la connaissance, l’action et la passion, entre la science, la spéculation et l’éthique. Le stoïcien veut savoir pour vivre moins follement, et non vivre pour savoir sans autre but. Il veut percer le secret des choses pour conformer ses actions à l’ordre universel. Même si cet ordre n’existe pas aussi rigoureusement que les sages l’ont dit, même si la « divinité » qui ordonne le monde n’est peut-être qu’illusion.
Les Stoïciens, Gallimard Pléiade 1962, direction Pierre-Maxime Schuhl, 1432 pages, €57.00
Les Stoïciens – anthologie, collection Tel Gallimard 1997, tome 1, 668 pages, €13.02 / tome 2, 826 pages, €14.73
Les Stoïciens – textes choisis par Jean Brun, PUF, 182 pages, €11.40
Jean-Baptiste Gourinat, Le stoïcisme, PUF collection Que sais-je ? 2011, 128 pages, €8.55



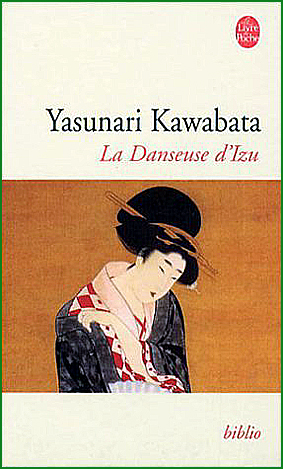












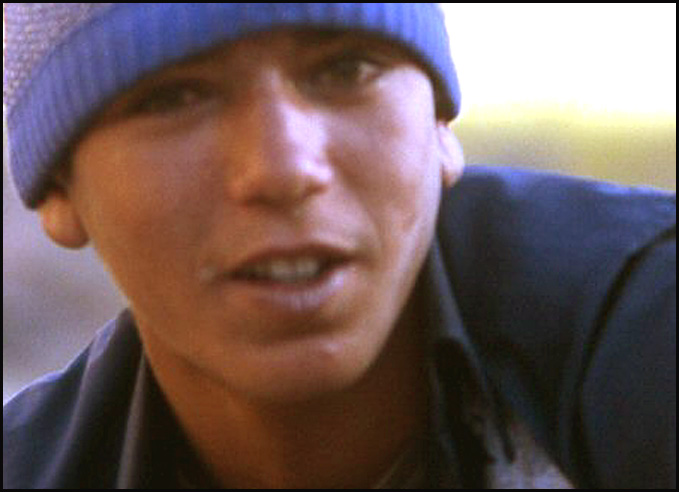








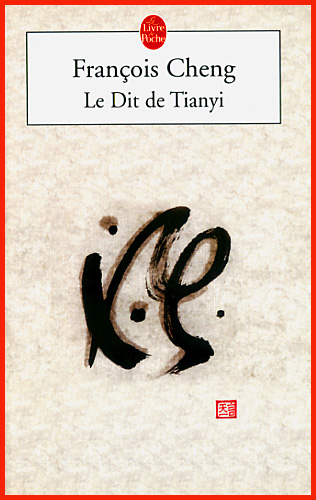


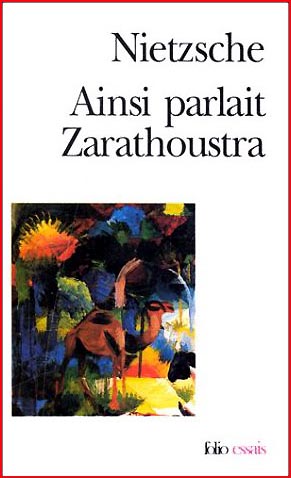

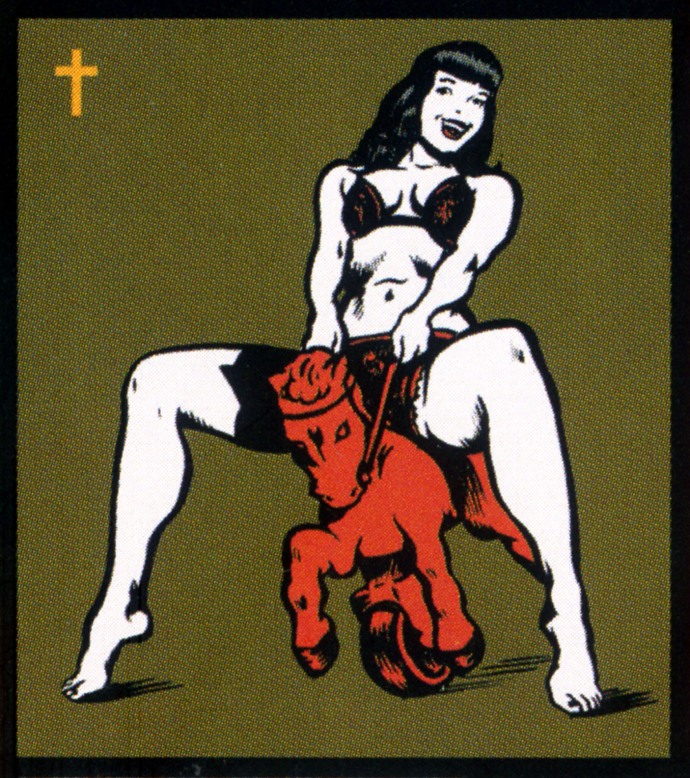





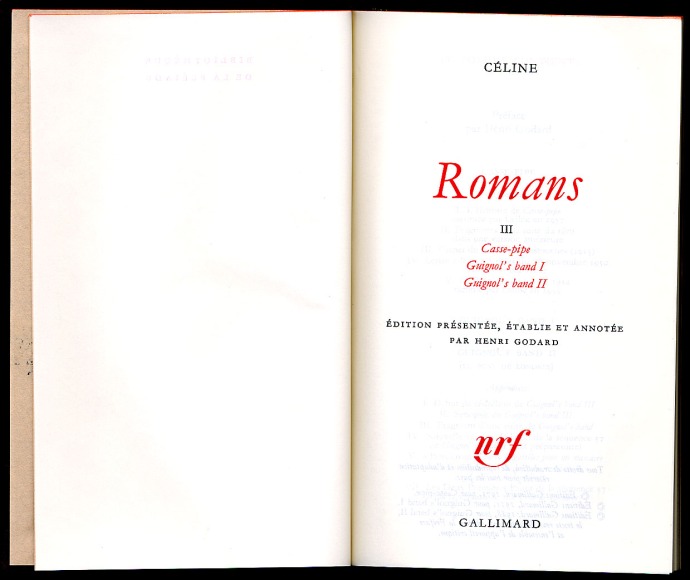

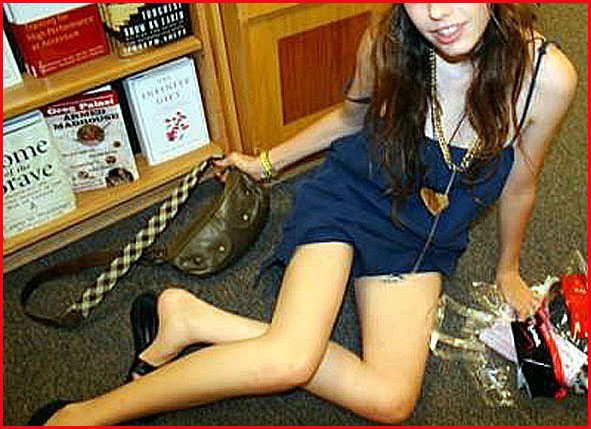
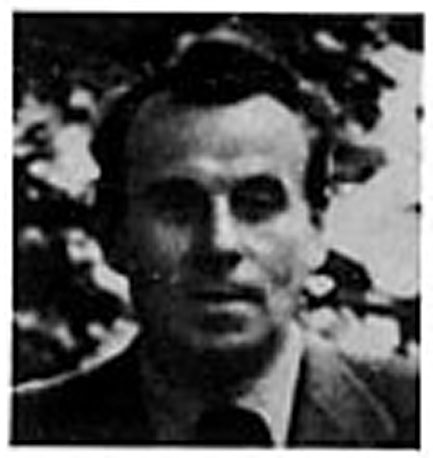
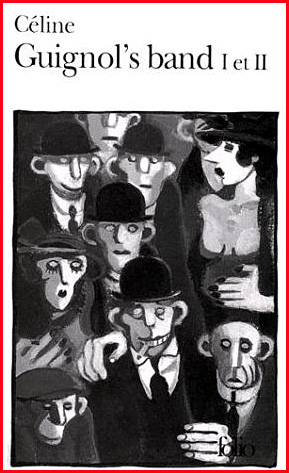
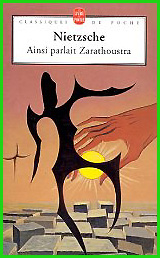

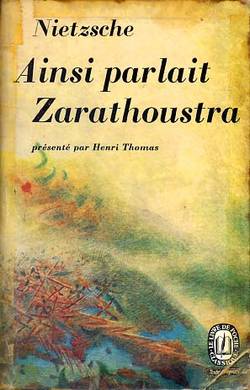


Commentaires récents