
Tout part d’une querelle banale entre frères. Sylvain, 17 ans, brute plutôt fruste, dragouille une meuf maladroitement tandis que son petit frère, Fabien, 11 ans, le tanne pour aller se défoncer aux autos tamponneuses. Une gifle part, retentissante, qui marque la joue encore le lendemain. Tout commence avec ce geste, une rupture tragique due à l’incompréhension réciproque. C’est qu’on ne fait guère attention à l’autre dans ce petit milieu breton ouvrier où les traditions et les convenances comptent plus que l’humain. Fabien est blessé, outré, humilié. Son père défend son fils aîné et trouve normal qu’il le « corrige » comme lui-même a été « dressé » par son père ; sa mère, qui pourrait compatir, se tait, elle préfère le silence des agneaux qu’on mène à l’abattoir, destin des femmes tradis face aux mâles.
Cette injustice absolue fonde la rage au cœur de l’enfant. Brusquement, à un âge où l’adolescence pointe ses hormones, où l’entrée en sixième émancipe de la famille, Fabien décide qu’un jour il se vengera. Cette passion mauvaise incruste en sa chair et en son âme sa « résilience ». Il va quitter le foot, ce jeu de gamins, pour s’inscrire à la musculation et au taekwondo, tout en poursuivant la natation parce que son frère déteste l’eau. Étrange pour un garçon si jeune de vouloir se renforcer, l’envie n’en vient en général que lorsque les muscles poussent, vers 13 ans et qu’alors l’apparence compte. Faut-il détecter en tout trop jeune garçon musclé le symptôme d’un mal intérieur, d’une angoisse qui noue le ventre en dessinant les abdominaux ?
L’histoire suit le destin non écrit de Fabien. Seule sa grand-mère Eugénie l’aime, de la façon inconditionnelle dont les parents devraient aimer leurs enfants. Mais elle est vieille, croyante, et ne remplace pas un père. Elle tente de faire lire quelques livres à Fabien, mais celui-ci est d’un tempérament plutôt pratique, manuel, que toute réflexion intellectuelle rebute. Avec ses handicaps, il n’est pas un héros. Il a du mal à l’école mais, comme au sport de combat, il s’accroche. Il tangente toujours la moyenne, jusqu’au bac. Malgré sa rancœur, il a des amis et, passé 15 ans, des amies. Il se compose peu à peu un carré de fidèles dont deux depuis la maternelle. Il garde un enfant handicapé, Benjamin, voisin de sa grand-mère, pour que Florence sa mère puisse avoir du temps pour elle et une vie de femme. Les parents d’Antoine, rencontré au lycée, vont lui ouvrir l’esprit et l’aider à choisir sa voie ; ils faut dire qu’ils sont de vrais parents, attentifs et aimants. Il fera un IUT de maintenance industrielle, puis une licence, avant de suivre une formation continue pour obtenir le titre d’ingénieur.
Mais ce ne sera pas sans péripéties. Dont la principale intervient tout à la fin du chapitre VIII, page 157. Ne pas en dire plus.
Dans ce premier roman, Christian Brûlard a tenté de mettre toute son expérience, acquise comme Breton d’adoption (à 11 ans), par une inscription très jeune en escrime, par sa vocation d’écrivain « nègre » pour politiciens en mal d’inspiration (ce que l’IA fera désormais plus vite), par sa fréquentation des écoles de commerce et des entreprises. Il s’en est conforté, mais parfois aussi perdu, tant vouloir en faire trop est l’ennemi de faire bien : « TROP, voilà l’accroc » énonce-t-il d’ailleurs p.133. S’il joue avec les mots et a des trouvailles heureuses (fabulette, chimistre, contagionnée), il en est d’inutiles lorsqu’existent déjà des mots précis (renominalisation au lieu de nouveau nom, déplaisance au lieu de déplaisir, extremum au lieu d’extrême…). Quant à certaines expressions, comme « accostent les vacances de Noël », elles sont inadéquates à la langue : n’accostent que des objets matériels (côte, bâtiment, personnage). Des phrases ressortent alambiquées de ne pas faire simple, tout simplement : « Tellement son discours s’alignait à coller aux espérances de l’espérée que l’inévitable rapprochement ultérieur avec l’évidence, créait déception et rancune, toutes dimensions du désarroi qui précède une rupture fraîchement provoquée » p.72 ; ou encore : « Antoine, moins holistique, y lit un espace à géométrie variable [avec des « s » inappropriés] dont les courses variées des pièces engendre une abscisse désordonnée et une ordonnée en forme d’abcès » p.97 ; ou toujours : « Élevée dans l’idée baroque d’une dot endogène prolongée par un mariage prestigieux, la mère de Chantal conclut une union évidée avec un officier de Marine, amèrement contingentée dans sa seule perspective marchande » p.147 (ouf !). Jouer avec les mots ne signifie pas se jouer du lecteur. Flaubert « gueulait » ses phrases avant de les accepter pour publication. Notons quelques erreurs à corriger comme, dans la même page 161, Pôle emploi et ANPE, dont le premier a remplacé l’autre en 2008… avant de devenir France Travail en 2024. Et p.258 le titre de l’ouvrage commis par Napoléon III, Extinction du paupérisme (et pas « de la paupérisation »). Je sais que les auteurs acceptent mal qu’on trouve des défauts à leur « bébé », mais je considère qu’une véritable critique doit être bienveillante, constructive et inciter à faire mieux. Un resserrement sur l’histoire et un toilettage du style assurerait incomparablement plus de puissance au livre.
Car il reste avec Sans excuse un roman puissant avec une histoire qui se tient, des personnages approfondis, des portraits sociologiques précieux à la Balzac – tout ce qui fait un véritable écrivain. Le lecteur est vite captivé, malgré les jeux de mots permanents, touché par le jeune Fabien qui s’accroche et s’endurcit, effaré par cette famille dysfonctionnelle qui produit du tragique par construction, édifié par le jeune adulte enfin stabilisé.
Un livre à lire et à recommander.
Christian Brûlard, Sans excuse, 2025, La route de la soie éditions, 385 pages, €25,00
(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

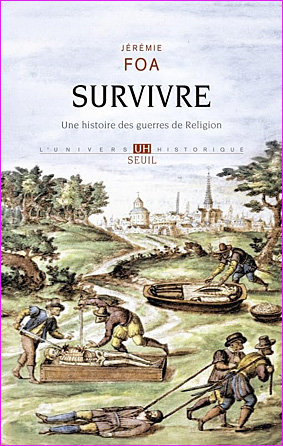
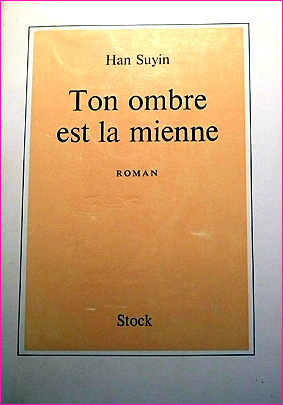
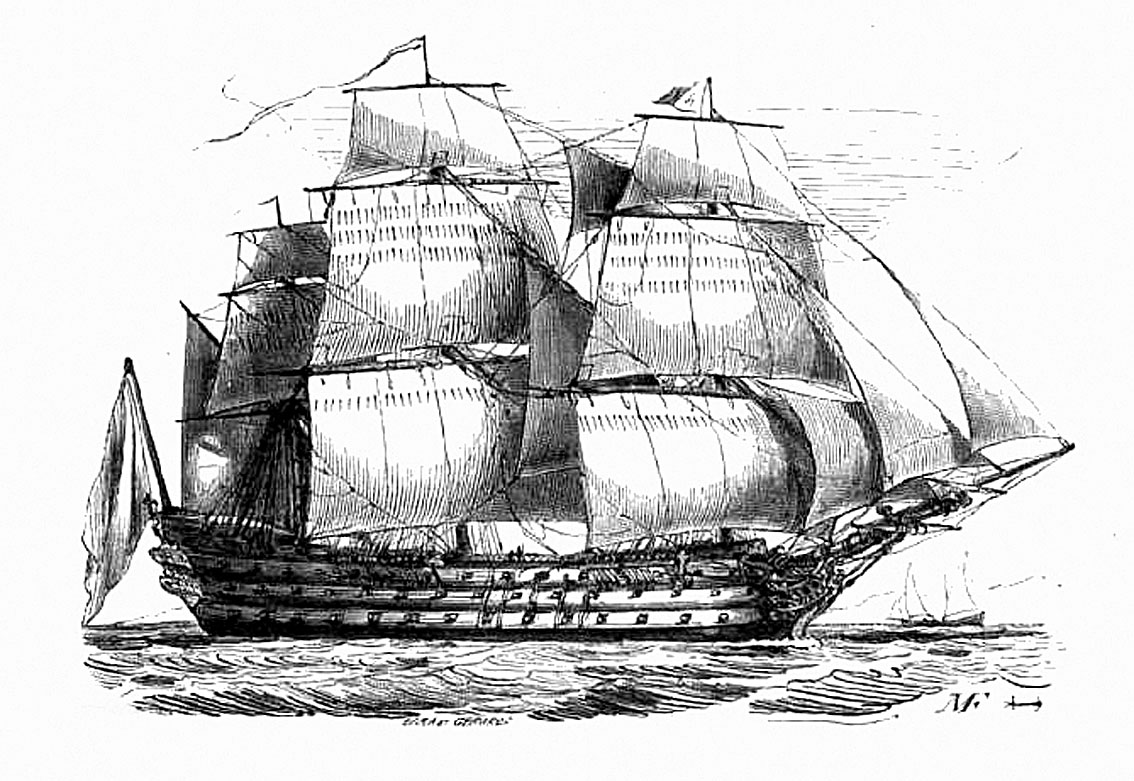

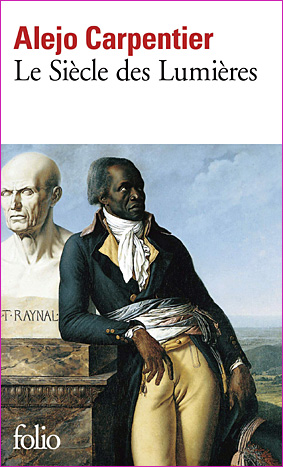
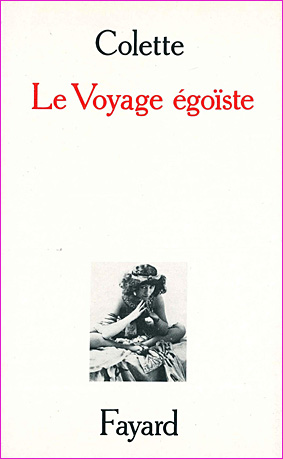







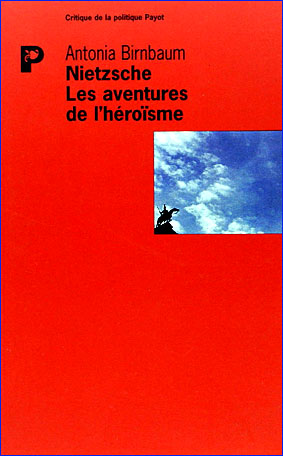
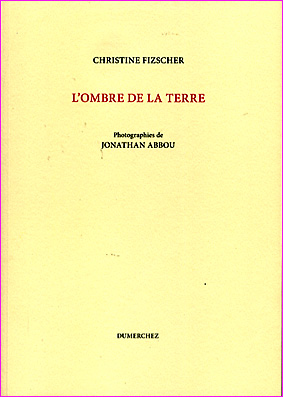
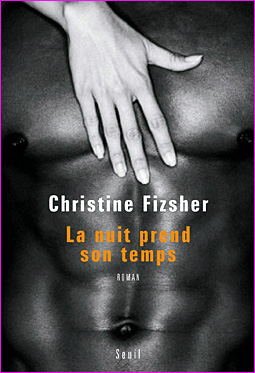
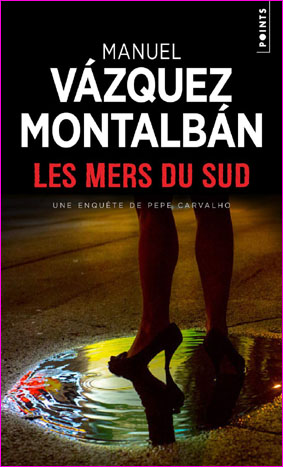























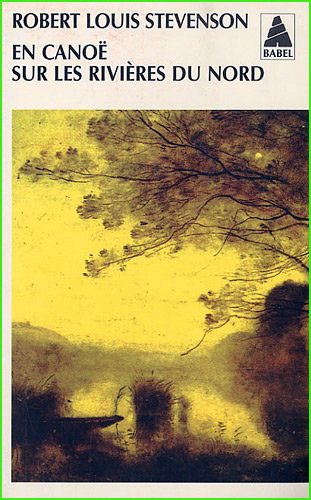




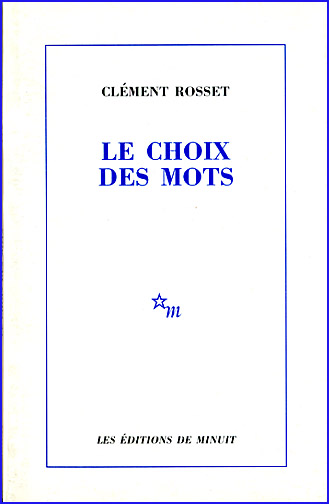


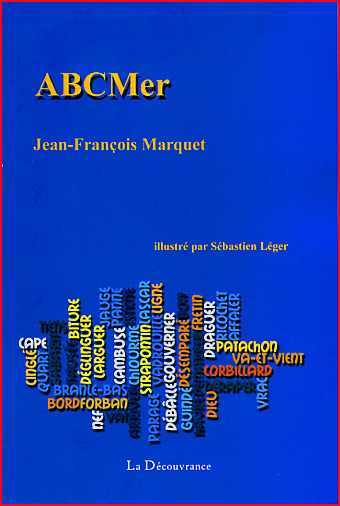



20 ans de blog !
Le mercredi 08 décembre 2004, j’ai ouvert pour la première fois mon blog. Il s’intitulait Fugues et fougue et était hébergé par lemonde.fr. Ce quotidien parisien avait en effet décidé d’offrir gratuitement à ses abonnés la possibilité de créer un blog, hébergé par ses services, en développement avec la plateforme WordPress. L’exemple de l’élection présidentielle de George W. Bush avait montré l’intérêt démocratique de cette nouvelle forme d’expression (avant Facebook et Twitter), et la perspective des élections présidentielles 2007 en France alléchait tout Le Monde. L’anonymat du pseudo était au départ la règle du jeu, demandé par lemonde.fr – d’où « Argoul ». Il a servi ensuite à ne pas mêler la vie professionnelle et l’expression privée dans les métiers sensibles que j’ai pu exercer.
Genèse du blog
J’écrivais dans ma première note (j’étais un brin idéaliste) « J’ai la conviction profonde que tout ce qui est authentiquement ressenti par un être atteint à l’universel. Nous allons parler de tout, montrer beaucoup. Je suis curieux, attentif et grand voyageur. J’aime l’espace, celui des étendues comme celui de l’esprit ou du cœur. Explorons-le. Retenons ce qui fait vivre. »
J’en appelais au dialogue, aux commentaires, aux échanges. Et c’est bien ce qui est advenu un long moment. Surtout que les blogueurs du monde.fr étaient un peu l’élite intellectuelle du pays, aptes à se servir d’un ordinateur, bien avant le mouvement de masse entraîné par les smartphones.
J’écrivais donc : « Je ne conçois pas un blog comme un texte gravé dans le marbre, définitif comme une pierre tombale. Même pas comme un livre. Je ferai des erreurs, je me tromperai, mon expression ne sera pas toujours le reflet exact de ma pensée. Ce pour quoi le blog se doit d’être interactif pour corriger, nuancer, apprécier, compléter. »
Las ! L’euphorie n’a eu qu’un temps. Très vite, comme d’autres, je suis revenu des « commentaires ». Ce sont rarement des enrichissements sur l’agora, plutôt des interjections personnelles. Nous avons affaire plus à des réactionnaires qui « réagissent » (en général par l’indignation), qu’à des lecteurs éclairés qui apportent des arguments pour ou contre. Giuliano di Empoli l’a bien montré !
Je croyais toute opinion recevable, j’ai désormais changé d’avis. Comme responsable (juridiquement « directeur de la publication« ), je dois être attentif à tout ce qui peut passer outre à la loi (insultes nominales, invites sexuelles, propos racistes, spam et physing etc.). Les seuls « commentaires » recevables sont ceux qui sont posés et argumentés, je le dis dans « A propos ».
J’ai été repris sur Agoravox, Naturavox, Medium4You, Paperblog et quelques autres. J’ai surtout fait, grâce aux blogs, plusieurs belles rencontres. Qui ont commencé par le texte et qui se sont poursuivies dans la vie. Certaines (pas toutes) durent encore. La plateforme du monde.fr a déçu : plantage intégral de tous les blogs deux jours entiers sans informations en 2010, perte des photos et illustrations, dérive gaucho-écolo-bobo devenue de moins en moins supportable, avec censure implicite par mots-clés, avertissements par mél de retirer une illustration ou un propos – en bref de la dérive autoritaire idéologique. Exit Le Monde, ses blogs et son journal. WordPress restait, facile d’usage, avec abonnement très abordable.
Dons 6 ans de monde.fr plus 14 ans de WordPress, cela fait 20 ans.
Pourquoi j’aime le blog – plus que Facebook, Instagram ou X
Un blog oblige à écrire souvent, voire quotidiennement. Cet exercice a pour effet de préciser la pensée, de vérifier les sources et de choisir les mots, évitant de rester dans la généralité et le flou pour toutes ces opinions qui font notre responsabilité d’individu, de parent, de professionnel et de citoyen.
Écrire exige un autre regard sur ce qui arrive, dans l’actualité, l’humanité et les pays traversés. Mettre en mots rend attentif aux détails comme aux liens avec l’ensemble.
Un blog offre l’occasion de rencontres : littéraires (avec les livres qu’on m’envoie à chroniquer), de témoignages (serais-je allé à cette réunion ou à cet événement s’il n’y avait pas le blog ?), mais aussi personnelles (entre blogueurs et invités).
Il permet surtout de transmettre une expérience, une vision de l’existence, une perspective historique (je commence à accumuler les ans). Il vise à donner aux lecteurs ce qu’ils recherchent sur les moteurs (images, lectures, méthode, idées).
Bilan
2 446 040 visiteurs sur fugues & fougue en 6 ans + 6 138 000 visites au 7 décembre sur Argoul.com en 14 ans = 8 584 040 visites. Ce blog est multimillionnaire.
Les meilleurs jours sont le dimanche ou le lundi, les meilleures heures le soir vers 18h.
Les requêtes via les moteurs de recherche ont évolué. Les moteurs ont établi une censure des images, donc des textes qui les contiennent, les associations de profs et autres éducateurs se méfient des blogs généralistes qui débordent les programmes et les opinions admises et déréférencent facilement « au cas où », le sectarisme croissant des citoyens sur la politique inhibe tout débat constructif. Et puis les images, les vidéos, les interjections en 140 signes sont tellement plus ludiques ! Lire ennuie, surtout sur le petit écran du téléphone. Injurier, agonir, ravit l’anonyme qui déverse sa haine ou son ego en direct sur les réseaux.
Je ne vais pas changer de personnalité pour suivre la foule. Mon blog reste élitiste, réservé à ceux qui aiment lire, qui savent lire, et qui lisent avec un œil critique, faisant leur miel de ce qu’ils trouvent. Le jeu de la performance et du nombre de clics, en vogue dans les débuts, n’a plus court.
Dans les catégories de notes, les livres arrivent en premier avec 2707 chroniques, suivis des voyages avec 1925 notes, puis le cinéma avec 605 compte-rendus de films, la politique (559), la philosophie (408) avec notamment une chronique chapitre après chapitre d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche (111 notes) et des Essais de Montaigne (109 notes, une lecture pas encore achevée) – et des thèmes de métiers exercés : l’économie (225), la géopolitique (196) et l’archéologie (61).
Mais les désirs des lecteurs ne sont pas représentatifs des articles publiés. Les statistiques du système « depuis le premier jour » donnent comme les articles les plus « vus » :
La vie est passée, les kids sont désormais adultes et l’adolescence est un thème moins présent aujourd’hui, je n’exerce plus de métier, ayant pris – au-delà de l’âge légal – ma retraite. Sur un an, les thèmes sont donc plus diversifiés :
Parmi les pays lecteurs, la France arrive évidemment en tête de façon écrasante 4 077 968 au 1er décembre, suivie des États-Unis 331 747, puis des pays francophones Belgique 226 623, Canada 206 649, Polynésie française 125 795, Suisse 114 189, Algérie 81 283, Maroc 51 353, Tunisie 33 133, La Réunion 25 273, Nouvelle-Calédonie 19 332, Guyane française 5 134.
Chez les Européens, ce sont dans l’ordre Allemagne 86 777, Italie 41 783, Royaume-Uni 40 254 (notons le peu d’intérêt de ce grand pays), Espagne 37 917, Pays-Bas 33 903, Pologne 15 228.
Dans le reste du monde, les plus peuplés : Brésil 27 858, Russie 20 738, Mexique 11 915, Australie 11 558, Japon 10 823, Turquie 7 722, Ukraine 6 637, Inde 6 527 (seulement), R.A.S. chinoise de Hong Kong 3 450, Arabie saoudite 3 207, Corée du Sud 3 064, Chine 2 120 – le plus probablement les expatriés.
Vais-je poursuivre ?
Probablement. Peut-être pas tous les jours, prenant une semi-retraite si nécessaire.
Et si la survenue d’une moraline intolérante ou d’un gouvernement traditionaliste autoritaire ne vient pas remettre en question la liberté de s’exprimer.
Donc, pour le moment, à demain !