Le phénomène social de la « Grande peur » agite périodiquement le peuple dans l’histoire. Il suffit d’observer aujourd’hui les attitudes de répulsion des autres quand vous les croisez dans la rue (en-deçà de deux mètres), le foulard intégral remis au goût du jour en dépit de la loi de 2009 sur le voile dans l’espace public (avec Marine Le Pen en femme voilée allant reflorer la Jeanne !). Certains portent en outre lunettes, capuche et gants au cas où vous auriez la peste en sus du Covid. Je suis persuadé que certains mâles ont même enfilé une capote (on ne sait jamais !) : « sortez couverts », ils se souviennent.

Les masques pour tous ont immédiatement (et en France seulement !) provoqué l’ire des « syndicats » d’infirmières et autres « soignants » qui se voient d’un coup dévalorisés dans la rue parce qu’ils ne portent plus leur signe distinctif de Héros : le masque comme un cimier glorieux. Une sorte de marque d’honneur qui leur était jusqu’ici exclusivement réservée et qui les distinguait du vulgum pecus réduit à subir. Mais oui, le masque pour tous, c’est démocratique ! Et très utile à la santé… de tous ! Ces ignares hors de leur domaine, éduqués par Mélenchon en économie, confondent allègrement flux et stocks, commandes qui arrivent enfin et complot d’accapareurs ! Les mythes éculés de la Révolution ont la vie dure. Le gouvernement devrait penser à leur accorder un badge bien reconnaissable marqué « soignant » en lettres d’or de cinq centimètres de haut sur un fond rouge sang pour panser leur vanité blessée. Les sociétés égalitaires ont toujours retrouvé à un moment ou à un autre le sens des « distinctions » : héros de l’Union soviétique, pins à l’effigie du Grand timonier, médailles militaires, badges scouts… Les privilèges, au fond, chacun aime ça.
Quand aux névrosées obsessionnelles (je l’ai vu surtout chez les femmes), elles ne cessent de passer de la lingette alcoolisée sur tout ce qu’elles touchent, du chariot de supermarché à l’emballage des pommes et aux touches de l’appareil à cartes : pourquoi ne portent-elles pas plutôt, comme moi, des gants jetables ? Je songe aux gestes « barrière » des nobles de Pékin, dans la Chine impériale, qui portaient d’immenses chapeaux garnis de tiges pour éviter que quiconque n’ose les approcher de trop près. Le barrage sanitaire devient vite un barrage social, engendrant méfiance, prophylaxie et soupçons. Rien de tel que le mépris pour engendrer une révolte.
La Grande peur de la Bête (Satan lui-même, invention d’église), aurait donné paniques et croisades autour de l’an mille de l’ère chrétienne. Mais il s’agit de l’interprétation millénariste de l’Apocalypse par saint Augustin car Jean de Patmos lançait un message d’espoir selon Jean Delumeau (L’Express 23.09.1999) : le retour du Christ sur la terre pour un règne de justice de mille ans. C’est Michelet qui en fit le mythe de la Grande peur qui nous reste à l’esprit, alors même que les neuf dixièmes de la population médiévale ne savaient pas lire et qu’ils ne connaissaient ni l’année, ni la date du jour, ni celle de leur naissance. « L’an mille » était donc un temps nébuleux, pas un événement précis ou marquant – sauf peut-être chez les clercs, volontiers enfiévrés de continence et confinés à macérer entre eux. L’Apocalypse de Jean n’est d’ailleurs devenue livre canonique chrétien qu’au XIVe siècle…
Le terme de Grande Peur a été donné en priorité aux insurrections paysannes de 1789 par les historiens marxistes qui faisaient commencer la France sociale moderne à ce moment – en oubliant, comme aurait dit Marc Bloch, le sacre de Reims. Tout vient alors des campagnes, comme aujourd’hui les gilets jaunes. Les mauvaises récoltes (les mauvais salaires et prestations) engendrent la pénurie, donc les théories du Complot. Des racailles (appelés jadis « vagabonds ») sont grossies et déformées par l’imagination pop en « armées » de brigands. Il se propage la rumeur (par les réseaux sociaux d’époque) qu’à Paris une « Saint-Barthélemy des patriotes » a lieu : un grand massacre CRS de gilets jaunes, dirait-on sur Twitter. L’alarme se répand et naissent les inévitables dommages collatéraux (pas perdus pour tout le monde, resquilleurs, détrousseurs et Black Blocs de l’époque) : pillages, émeutes, attentats, incendies, viols. Les symboles du pouvoir social, alors châteaux et abbayes, aujourd’hui préfectures, palais de la République, avenues prestigieuses, banques et grands magasins, sont envahis et dévastés.
La Grande peur du « Boche » en 40 (qui a engendré l’Exode) a été suivie (aux Etats-Unis surtout) de la Grande peur de l’apocalypse nucléaire après-guerre, tandis que l’envolée des cours du pétrole à la fin des années 70, suivie de la récession occidentale et son chômage chronique dont les délocalisations mondialisées ne sont qu’un avatar, ont engendré une Grande peur du déclin inexorable de l’Occident. L’immigration arabe, touchant à la bite et au couteau – ces instruments vitaux du viril – a créé chez les Blancs déclassés, divorcés et en manque d’enfants (combien de gosses chez Renaud Camus ?), la Grande peur hantée d’un Grand remplacement. Plus récemment, avec les tempêtes, les ouragans, les incendies, les catastrophes industrielles (dont Tchernobyl et Fukushima), la Grande peur est celle du climat et de « la Terre qui se venge » dans une Apocalypse prédite par les textes bibliques – jusqu’au virus grippal issu des coucheries incestueuses des hommes et des bêtes en Chine qui a fait jusqu’ici autant de morts que la grippe de 1957 sans engendrer alors de Grande peur (on avait d’autres soucis, à commencer par la guerre civile en Algérie, département français qui allait encourager le putsch des généraux). Même le Sida n’était censé toucher que les déviants (« juste » châtiment divin pour avoir bafoué les Commandements du Père fouettard Jéhovah de ne coucher qu’avec l’unique femme sacralisée devant Lui par le curé).

Aujourd’hui est différent : on joue à se faire peur. Le confinement rend con, finement. Ressasser entre soi les mêmes rengaines paranoïaques n’améliore pas le jugement. Au contraire : la raison se perd au profit de la croyance en tout et n’importe quoi. L’imagination, laissée à elle-même la plupart du temps par le chômage partiel (ou intégral pour les fonctionnaires, payés à rester chez eux jusqu’au dernier centime), travaille (elle) : « on » l’avait bien dit, « on » nous cache des choses, « on » aurait fait mieux, oh, là ! là !
Or, si l’empire inca s’est effondré à cause de la variole et l’empire des Yuan au profit des Ming en Chine à cause d’une épidémie, les différentes pestes et choléras en Europe n’ont rien changé au monde du temps. Le commerce avant tout : la santé, c’est bien, mais celle de l’économie, c’est-à-dire de toute la société dans sa survie, c’est mieux. L’être humain est social et a besoin vital d’échanges. Le commerce en est un, celui des marchandises, et la culture un autre, qui se diffuse aujourd’hui par l’industrie (de la presse, du livre, des concerts, des raves, des spectacles, des réseaux), tout comme les lieux de sociabilité que sont les bars, café, restaurants, théâtres et stades – ou le tourisme. La frénésie de purification ne dure qu’un temps. Une fois éradiqués les boucs émissaires dans la panique, la promiscuité entre égaux retrouve ses droits, parfois entre sectes du même gourou : « le monde ne peut que penser comme moi ». Quitte à bâtir une maison de pierre plutôt que de paille, pour résister au loup méchant, comme dans les Trois petits cochons – ce que Trump entreprend, tonitruant, en fermant les frontières.
La peur, selon le sociologue historien Norbert Elias, est le mécanisme qui permet aux structures élémentaires de la société d’être transmises aux psychologies individuelles. Les peurs sont intériorisées pour que chaque personne se trouve en phase avec sa société dans sa culture. Selon les biologistes, les souvenirs des traumatismes se transmettent de génération en génération par l’épigénétique (Brian Dias, université Emory d’Atlanta, in La Recherche, janvier 2015) ! Dès lors, la Révolution de 1789, la Grande guerre de 14-18, la honteuse Défaite de 40 et son Exode rural, les guerres perdues coloniales, les attentats islamistes, sont des marqueurs français plus profonds qu’une épidémie : ils viennent des humains, pas du destin; des élites défaillantes ou de la lâcheté du peuple. Car d’autres pandémies, nous en auront dans le futur.
Mais la vie continue, elle continue toujours, et il faudra reprendre le collier comme avant, même si quelque chose aura changé (peut-être) dans les mentalités. Un recentrage sur les vrais métiers (alimentaire, santé, artisanat, communications numériques ?) au détriment des futilités (foot surévalué et surpayé, « spectacles » sans intérêt, spéculation financière vide ?), retour aux vrais amis et aux proches (bien oubliés jusqu’ici dans le « virtuel » et les EHPAD ?), bifurcation politique (plus de souverainisme, plus d’achat français et local, cesser de jargonner globish, aspiration à plus de participation, de décentralisation, de parler franc ? de « solidarité » réelle peut-être ?), désurbanisation possible (pour les nantis qui peuvent financer deux résidences ou travailler à distance ?), voire retour à la terre, sinon à « la nature » (concept flou) ?
Une Grande peur marque toujours ; mais elle n’a pas forcément de conséquences directes. Juste une cristallisation des tendances sous-jacentes peut-être, une accélération des remises en causes restées jusqu’ici latentes. Le monde de demain ressemblera à celui d’hier, malgré les utopistes ; le capitalisme restera cette technique inégalée d’efficacité économique applicable en tout, malgré ceux qui annoncent sa chute… depuis deux siècles ; la mondialisation se poursuivra, un peu différente sur certaines chaînes de valeurs, mais inexorable malgré les écolos qui chantent déjà victoire ; les particularismes nationalistes et identitaires s’exacerberont en réaction, malgré les incantations à « gauche ». Il est fort probable que les clowns qui gouvernent soient réélus car ils racontent la « belle histoire » que la majorité veut entendre, même si le conte a souvent peu à voir avec la réalité ; il est fort probable que les oppositions, aujourd’hui nulles, restent dans leur nullité et leur opposition, ici ou ailleurs – pour cause de nullité sans remède à échéance connue et d’opposition systématique qui déconsidère leur soi-disant projet.
Mais nous aurons vécu quelque chose, une période inédite dans l’histoire ; nous nous serons recentrés sur nous-mêmes et nos proches, forcés à confiner, ce qui peut inciter à penser par soi-même au lieu de suivre les hordes ou les modes. Qui sait ?
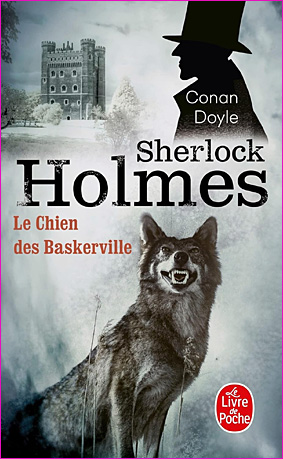

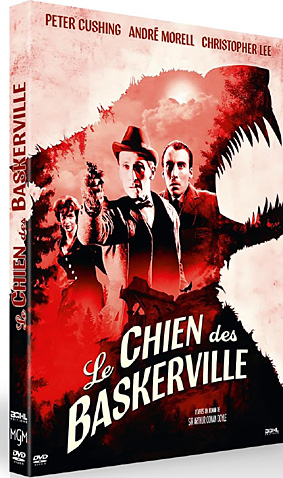










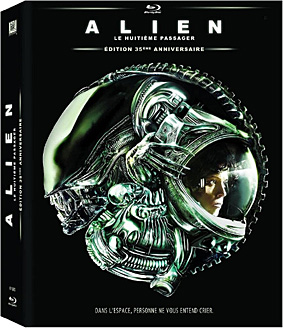












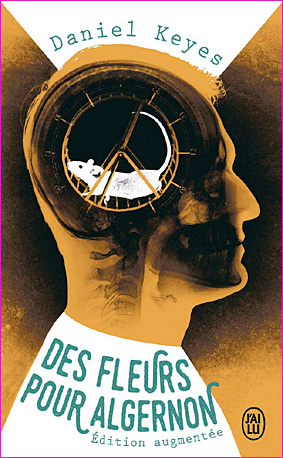
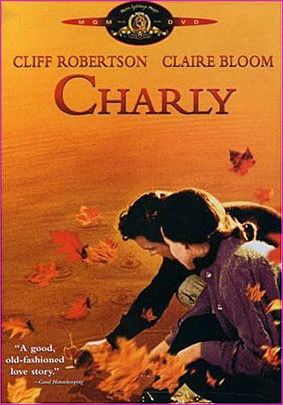

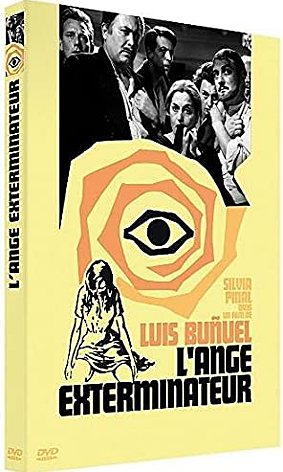











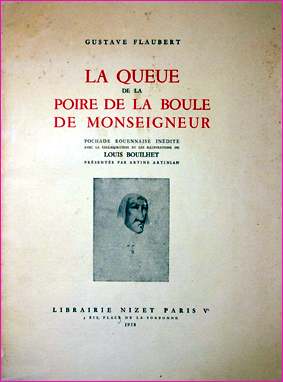

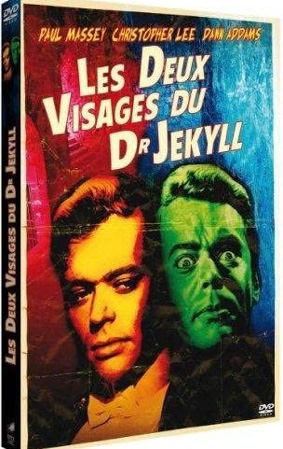








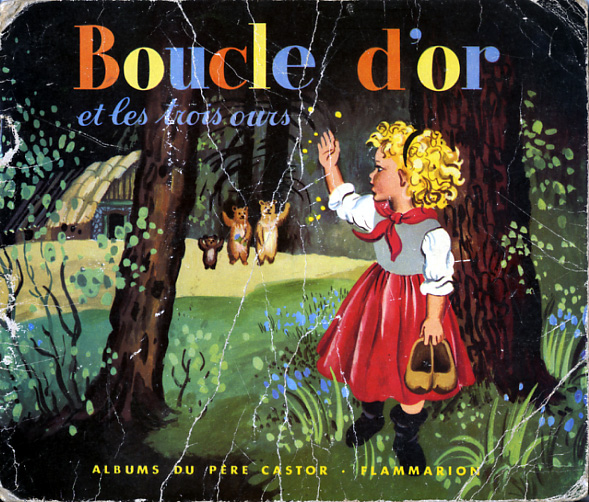







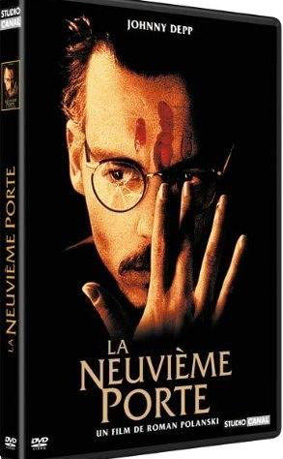



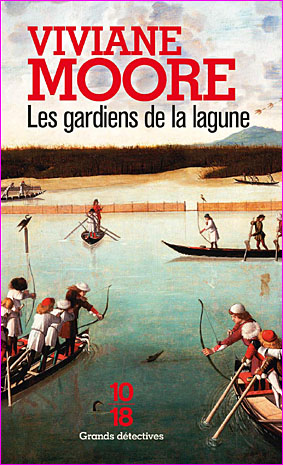














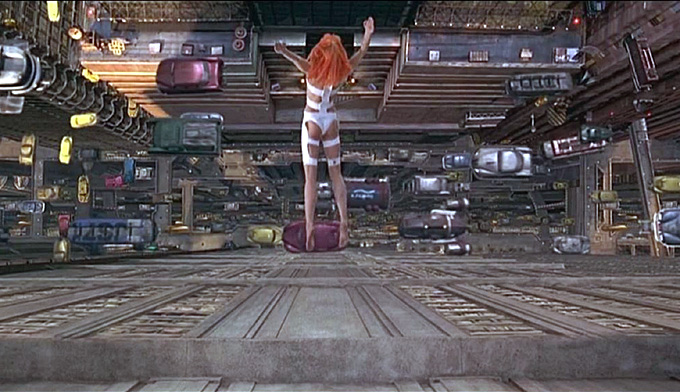




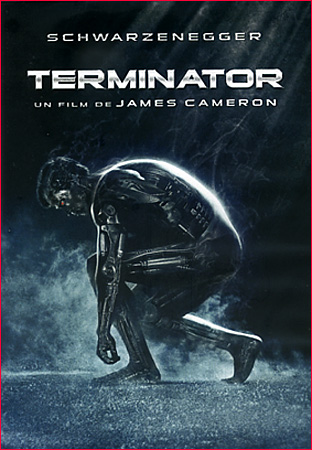
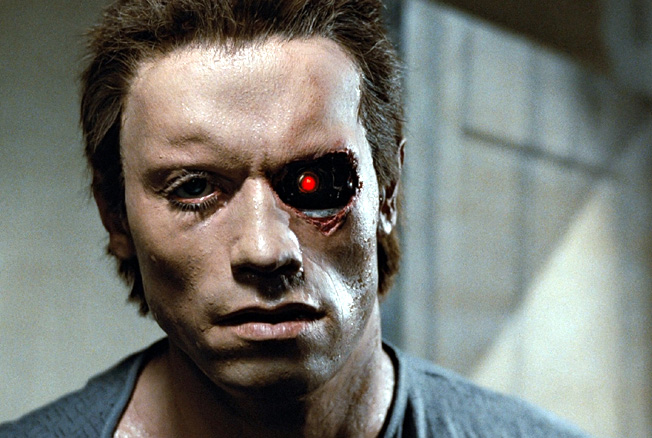

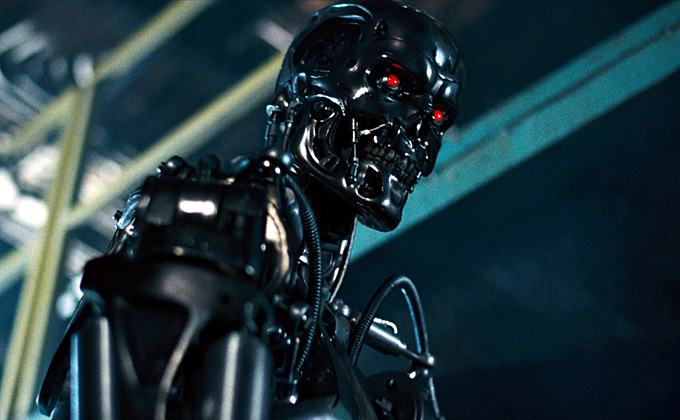
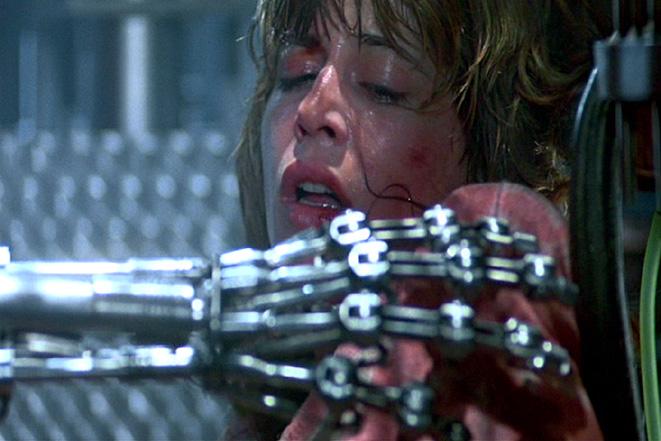

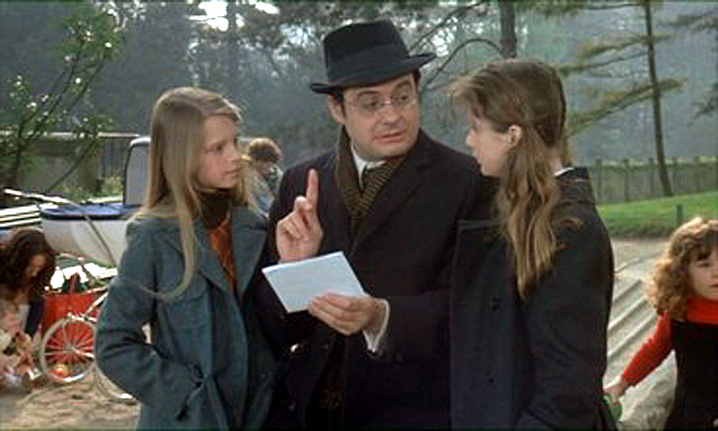









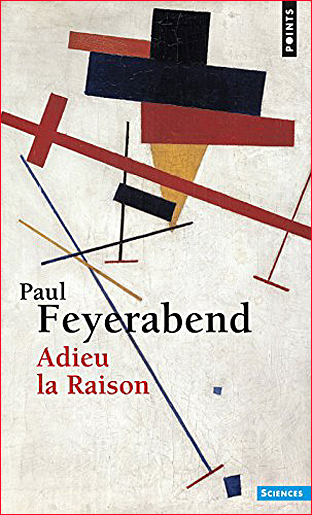
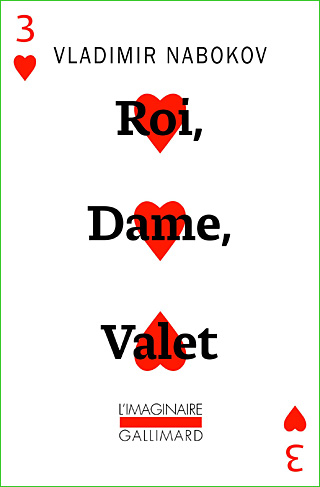
Commentaires récents