Sorti en 1984 d’après le célèbre roman d’anticipation Nineteen Eighty-Four (1984) de George Orwell (pseudonyme d’Eric Blair), ce film sonne comme un avertissement : il n’y a qu’un pas entre notre société aux apparences démocratiques et un régime totalitaire. La différence ? Tomber amoureux et penser par soi-même. Supprimez par décret ces deux attitudes du cœur et de l’esprit et vous ne garderez que les bas instincts, soumis au parti.
C’est ce qui arrive dans le pays imaginaire d’Oceania (métaphore transparente du monde anglo-saxon), en lutte avec Eurasia (d’obédience soviéto-nazie) et Estasia (clairement maoïste) – tous totalitaires comme en vrai. Le reste du monde est le quart-monde où conquérir des matières premières et des territoires. Le roman d’Orwell est paru en 1949, en réminiscence du Nous autres de Zamiatine, publié en 1920 (et interdit dès 1923 par Staline). Le roman d’Orwell surgit en 1949 à l’heure d’un Staline triomphant, d’un Mao vainqueur, et du premier recul de l’Amérique avec la bombe A désormais aux mains des soviétiques.
Il imagine un parti totalitaire stalino-hitlérien, arrivé au pouvoir trente ans auparavant en 1954, embrigadant tous les âges dans l’AngSoc, le (national) « socialisme anglais », dominé par Grand frère – Big Brother (Bob Flag dans le film). Les individus ne s’appellent plus entre eux monsieur ou citoyen, ni encore camarade, mais « frère ». Le secrétaire général des frères est le « Grand » frère, selon le tropisme constant de gauche à surnommer « grand » tout ce qui émane d’elle. La société est uniforme mais hiérarchisée : les apparatchiks en costume à la tête (membres du cercle restreint du Parti intérieur), les employés en bleu de travail au milieu (n’appartenant qu’au Parti extérieur) et le prolétariat relégué dans des ghettos et des taudis, tout en bas. Pour éradiquer le « vieil homme » qui jouit, aime et pense, la propagande est omniprésente, télévisuelle, répétant en boucle les slogans et les informations aménagées par le pouvoir (tout comme en Chine de Mao).
« Big Brother is watching you ! » n’est pas un vain mot. Le Grand frère vous regarde constamment car les écrans ont aussi des caméras qui permettent à la monitrice de gym du matin de vous apostropher personnellement pour rectifier la position, ou à la police politique d’observer avec qui vous baisez et ce que vous dites entre deux étreintes. Il y a bien une résistance, elle réussit même à faire sauter un pylône ou deux, mais le principal de la police est la pensée. Le « crime de pensée » se rapproche tellement de ce que nous connaissons comme le « politiquement correct » de la « gauche morale » du « catho de gauche » moralisant ou de l’islamiste sourcilleux que c’en est confondant. Même les gamins vous soupçonnent, enrôlés dans des mouvements disciplinaires style BrotherJugend ou Pionniers staliniens. Ils sont les pires, car façonnés depuis la crèche à penser formaté. Quant à désigner les choses, le dictionnaire approuvé se réduit d’année en année au profit d’une Novlangue de 800 mots, tout comme le russe s’est abâtardi avec la langue de bois du proletcult. Tout mot est euphémisé, simplifié et doit servir le parti. Il comprend peu de syllabes afin d’être prononcé vite et sans réflexion, une sorte de mot-réflexe à la Pavlov permettant de susciter immédiatement la réaction voulue. « L’ignorance, c’est la force ! ».
Winston Smith (John Hurt) est un employé banal, chargé d’un travail inutile à l’humanité mais vital pour le parti : rectifier pour le ministère de la Vérité (Miniver) les archives du Times selon la « vérité » en vogue au présent. Car le passé n’est pas histoire, il n’est qu’un souvenir dans la mémoire. Winston « éradique » ainsi un membre du parti en disgrâce et le remplace par un quidam, tout comme Staline faisait recouper les photos avec Trotski (pseudonyme pour Bronstein). Ce dernier, en Oceania, s’appelle d’ailleurs du nom juif de Goldstein, bouc émissaire commode stalino-hitlérien.
Seul le parti définit ce qui est « vrai » ou pas, selon la doublepensée novlangue, aujourd’hui la bonne maxime de Trump, reprise de Goebbels, qu’un mensonge affirmé avec force et répété en boucle finit par devenir une croyance de groupe, donc votre vérité personnelle. « La liberté, c’est le mensonge ! » clame la propagande – et la CGT reprend l’idée à chaque manif, quel qu’en soit le sujet. On le voit, 1984, ce n’était pas seulement hier mais c’est en partie aujourd’hui et ce pourrait être pleinement demain. Car « qui possède le passé possède le présent ; et qui possède le présent détermine le futur », dit encore Big Brother.
Winston, qui a osé aller en zone interdite se faire une pute du prolétariat (pour 2$), se sent observé par Julia, une fraîche jeune fille de la Ligue anti-sexe (Suzanna Hamilton, 24 ans au tournage) qui milite pour le parti afin de décourager les relations sexuelles et l’amour – tout comme les féministes hystériques américaines de nos jours, adeptes de la PMA et de l’enfantement sans mâle (donc sans mal). Car le sexe isole du collectif et l’affect amoureux rend indisponible au parti. Chacun n’a le droit d’aimer que le Grand leader, tout comme les chrétiens n’ont à aimer que Dieu. Où le spectateur pense par lui-même que ces partis collectivistes ont tout de la religion, fonctionnant comme elle, réclamant la même soumission inconditionnelle et totale, repoussant tout amour terrestre et toute vie bonne au profit du but unique qu’est le Pouvoir du parti. Quand l’orgasme aura été éradiqué scientifiquement, selon le projet du parti, les humains seront les parfaits robots fonctionnels du social. L’individualisme, le capitalisme, la pensée personnelle seront des vestiges animaux dépassés par l’Evolution créatrice du parti.
Sauf que Julia tombe amoureuse de Winston ; il n’est pourtant pas très beau ni jeune (44 ans au tournage)… Mais elle aime coucher et jouir, elle le dit crûment, comme les premières égéries « libérées » autour de Lénine jadis. Cet exercice physique serait sain s’il n’entraînait pas l’amour, donc le désir de faire nid, donc de préférer les « membres » du parti au parti lui-même. « Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (Matthieu 22:37) est le mantra de toute religion despotique, et la police de la pensée doit y mettre bon ordre. Ce qui fournit quelques scènes cocasses où Julia porte sa combinaison de travail sans jamais rien dessous, se promène nue dans la chambre louée, où les flics casqués, sanglés et bottés arrêtent le couple entièrement nu sans même un battement de cil.
Julia soupçonne Goldstein de ne pas plus exister que la guerre contre Eastasia car on ne maintient le peuple dans l’obéissance que lorsqu’il est au bord de la survie, lorsqu’une ration de 25 g de chocolat par semaine au lieu de 20 g suffit à rendre heureux et que « la géniale stratégie » du Grand frère a permis aux fils partis à l’armée obligatoire de « tuer 25 000 ennemis en un jour ». Winston, qui ose aussi penser tout seul dans un cahier où il tient un journal de ses opinions et fixe ses souvenirs, est poussé à basculer par son supérieur O’Brien (Richard Burton) qui lui confie un exemplaire pilote du nouveau dictionnaire de Novlangue, dixième édition. Entre les pages sont collées celles d’un Traité que l’on entrevoit brièvement comme Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Son auteur serait Goldstein (alias de Trotski) mais O’Brien, après l’arrestation de Winston et Julia, déclarera qu’il en est lui-même l’auteur. Selon Machiavel, tout prince doit susciter sa propre opposition pour se valoriser et contrôler le ressentiment. Mais la théorie politique qu’il contient est une science des révolutions : seule la classe moyenne peut remplacer la classe dirigeante, jamais « le peuple » qui est toujours manipulé. D’où l’emprise que les dominants maintiennent par des techniques de publicité et de manipulation psychologique dont la Minute de la Haine où la foule en délire lynche le bouc Goldstein virtuellement devant l’écran.
Winston est torturé (Julia aussi probablement), avec pour fonction d’annihiler totalement sa personnalité. Il renie Julia, révoque ses opinions, écrase ses souvenirs ; Julia lui avouera avoir fait de même car trahir l’autre, c’est se montrer repentant. Le corps, le cœur et l’esprit de chacun ne doit appartenir qu’au parti. La terreur comme anesthésiant de la raison a été pratiquée avec le succès qu’on connait par Staline, Hitler, Mao et Pol Pot, et se poursuit en Chine où les camps de « rééducation politique » subsistent toujours en grand nombre. Chez Poutine, c’est la prison en premier avertissement et l’assassinat par une mafia parallèle impunie en cas de récidive.
Winston, relâché après avoir « avoué » que quatre doigts sont cinq si le parti le dit, que la mémoire doit être vidée de tout souvenir s’ils contredisent le présent du parti, en bref que le chef a toujours raison. Il est dénoncé comme traître repenti et la litanie de ses crimes aussi imaginaires qu’absurdes (comme durant les procès de Moscou) s’étale sur les télécrans : « j’ai trahi le parti, j’ai suivi le traître Goldstein, j’ai saboté la production industrielle du pays (lui qui n’avait accès qu’aux archives du Times !), j’ai couché avec les deux sexes, j’ai… ». Le Confiteor chrétien ne dit-il pas : « j’ai gravement péché par orgueil contre la loi de mon Dieu, en pensée, délectation, omission, consentement, regard, parole et action » ? Au parti comme en religion, il s’agit de se purger de tout péché, d’éradiquer à la racine sa « nature humaine » pour redevenir blanc comme neige aux yeux de Dieu, pure créature-miroir de Lui-même, et être accueilli dans le paradis socialiste où l’on vous dit ce qu’est le vrai bonheur… qui est au fond la mort : Winston, une fois converti, sera exécuté.
Prix du meilleur film et du meilleur acteur 1985 pour John Hurt aux Evening Standard British Film Awards.
DVD 1984, Michael Radford, 1984, MGM United Artists 2005, 1h46, avec John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, Bob Flag, standard €5.14 blu-ray €10.99









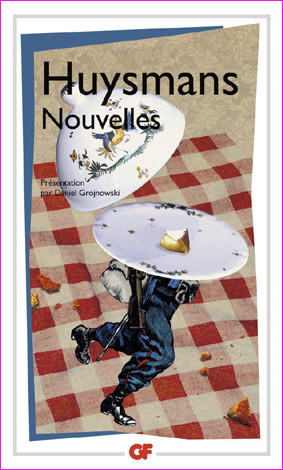
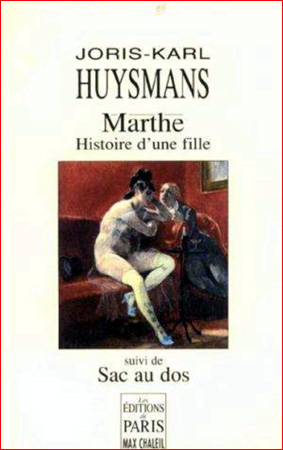
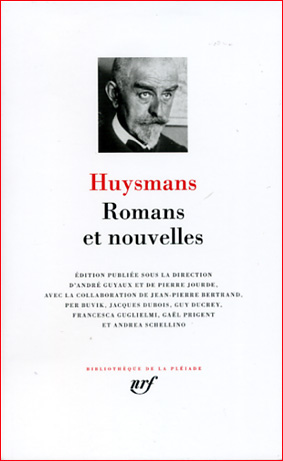

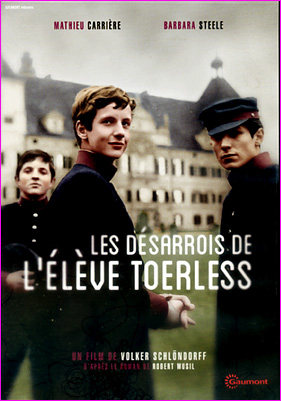



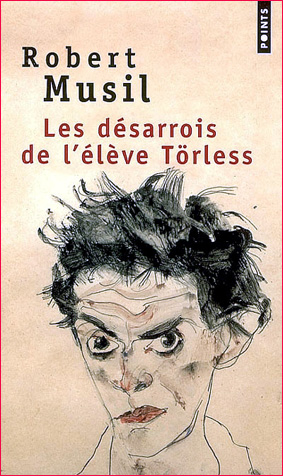
















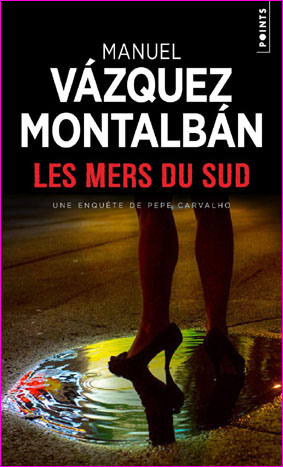
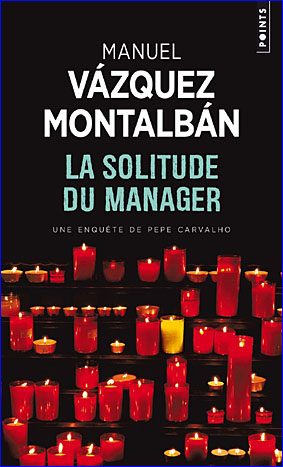






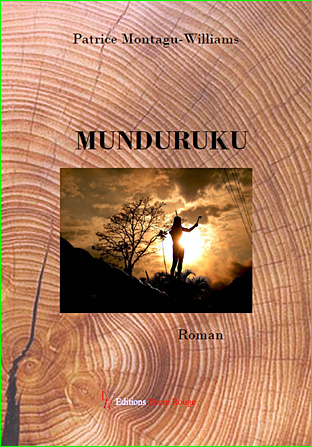






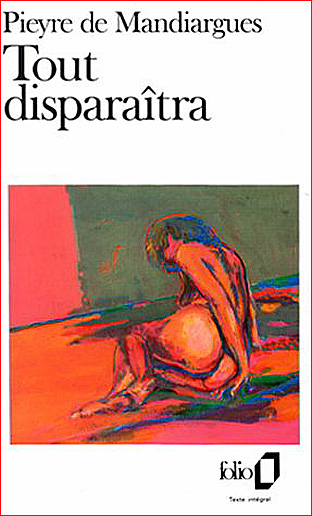
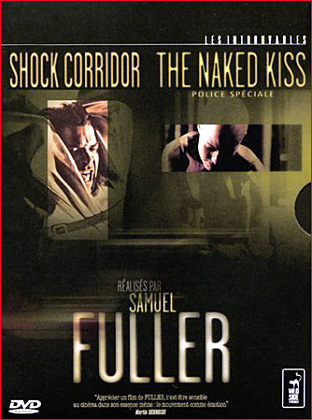
















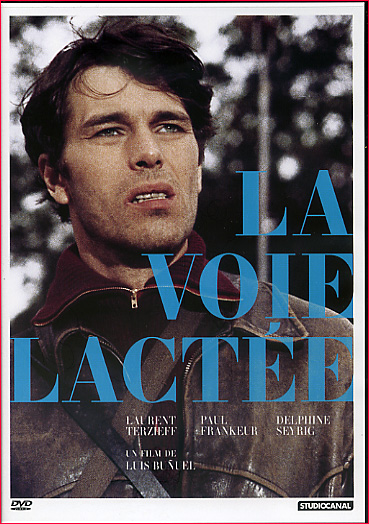





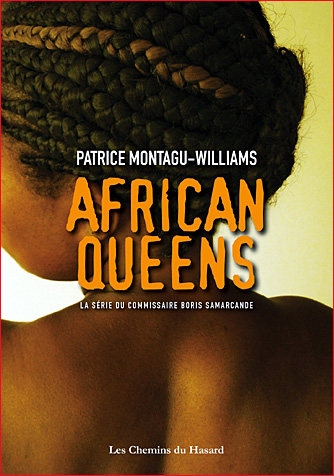
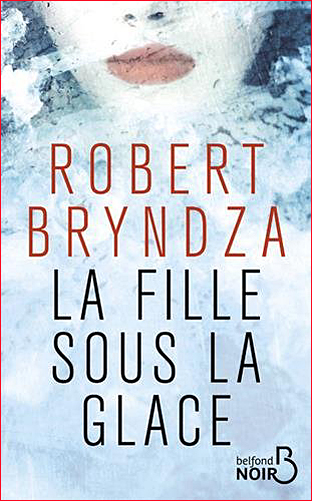








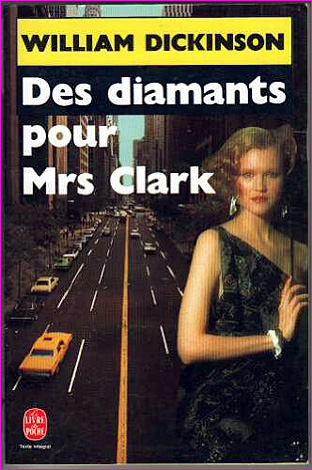
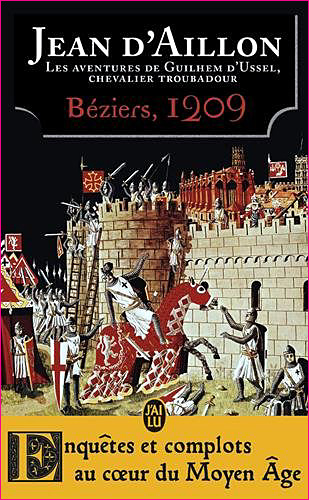

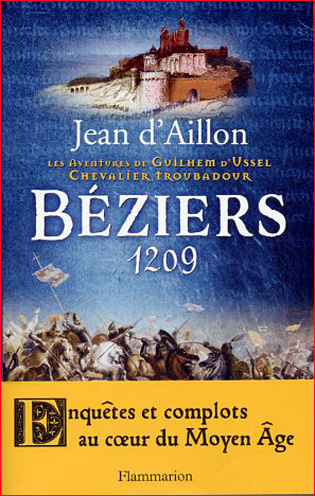
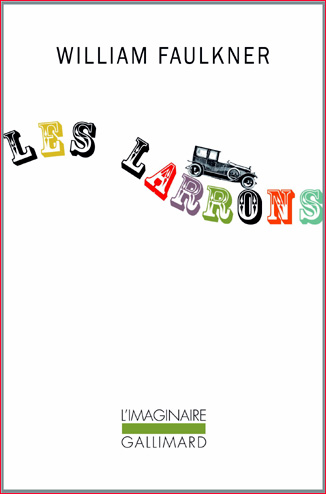
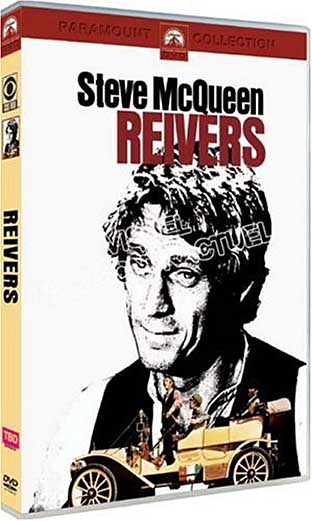
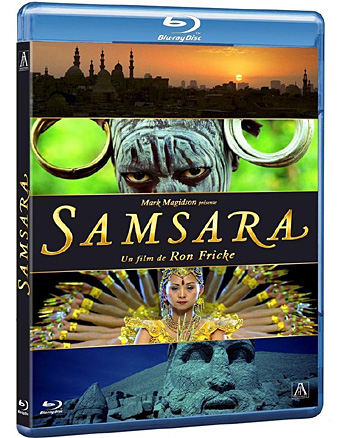





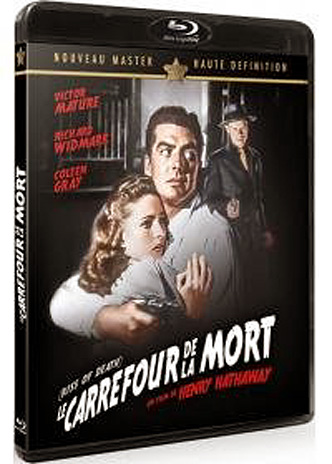




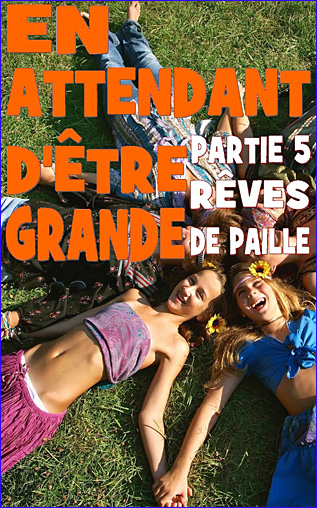

Commentaires récents