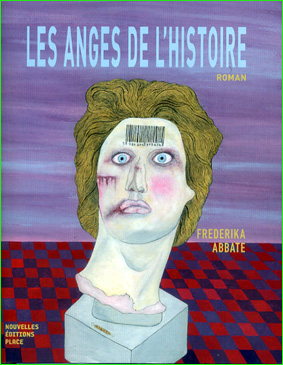
Sixième roman étrange d’une autrice de 60 ans née à Tunis quatre ans après l’indépendance, Les anges de l’histoire sont une fiction à la Philip K. Dick. Nous sommes dans notre monde mais en parallèle, dans une dystopie possible d’ici quelques décennies. C’est ce qui fait le charme de ce roman de réalité anticipée, nourri d’art, de sexe et de cybernétique.
Premier point : la cybernétique est désormais intégrée au monde humain avec le progrès de la vitesse et de la miniaturisation des puces ; chacun manipule du code ou est manipulé par lui, en direct ou via des algorithmes. Second point : l’art est plus que jamais indispensable pour penser le monde et se le concilier – une sorte de nouvelle « religion » selon Malraux (du religere latin : qui relie). Troisième point : l’art et la vie sont indissolublement mêlés, et la vie est avant tout sexe, acte social et génésique, jouissance suprême qui fait entrevoir la fusion avec le cosmos.
Vous l’aurez compris, ce roman met en scène tout cela dans des descriptions torrides d’unions sexuelles orgiaques entre individus, entre genres, entre espèces, la cybernétique permettant la manipulation (génétique et psychologique) de façon à démultiplier les occasions d’« art ».
Malgré un récit d’enfance un brin étriqué sur quelques pages – mais la limite légale des 15 ans est indispensable à notre société puritaine volontiers réactionnaire en ce qui concerne l’enfance – le personnage principal du livre, Soledad (qui est un garçon malgré ce prénom), parvient vite à sa maturité. Orphelin né en Lorraine mais adopté à Dieppe, il ne sait pas aimer même s’il tombe amoureux. Le lien n’est pour lui que sexuel ou informatique depuis qu’à l’âge de 15 ans cette carcasse « préhistorique » s’est retrouvé empalée sur une fille plutôt en marge qui créait des formes sur ordinateur. Cela lui révèle que « l’amour » est un langage codé.
Tout alors se précipite : le dérèglement irraisonné de tous les sens, la fugue du domicile pour vivre sous les ponts, la drogue et la baise, la philosophie de chambrée universitaire où il squatte par curiosité pour l’informatique, la rencontre d’une femme riche qui le sauve de la déchéance et lui permet de s’exprimer par la sculpture, le voyage initiatique en Thaïlande avec le frère de cette femme et sa découverte chamanique de l’amour tantrique où il le sodomise pour faire une expérience, une Faustine archéologue qu’il sauve des marais, sa première exposition de sculptures dans une galerie de Bangkok qui le fait connaître, la commande d’une œuvre par un Russe qui l’invite dans sa datcha sur une île au nord de Saint-Pétersbourg, et puis…
… sa révélation d’un Paris devenu en quelques années en proie au chacun pour soi du fric, où l’hyper-capitalisme à la Trump fracture durablement la société entre riches qui peuvent tout et pauvres à jamais soumis. Des tanks sur les boulevards tirent carrément sur une manifestation d’« Ombres », sortes de Gilets jaunes en capuches noires qui se disent oubliés. Soledad le solitaire rencontre des résistants au Système. Ils agissent dans la canopée d’une forêt qui a poussé anarchiquement sur les ruines du quartier de Saint-Germain qui retrouve son nom des Prés. La forêt comme signe de la vie qui toujours va. Il rencontre Laura aux cheveux bleus qui jouit magnifiquement, Markus le géant expert informatique, Dov l’hermaphrodite qui gère un bordel spécialisé. Il sauve Ariel, un enfant aux bras piqués, à l’esprit déstructuré par ce que ses parents puis la société lui ont fait subir.
Car dans le nouveau monde du chacun pour soi égoïste, la morale a volé en éclats. Seuls comptent les désirs et la réalisation des fantasmes. Toutes les barrières tombent, entre âges et entre espèces, des hybrides d’humains et d’animaux se vendant en bordels exotiques pour le plaisir et la douleur des pervertis par l’absence de tout cadre social, des enfants étant enlevés ou vendus pour viols, torture ou prélèvement de sang où se baigner en jouvence. Les vices humains alliés à la puissance de l’informatique et du pouvoir de l’argent vont très loin. Il s’agit moins d’un « complot » que d’une dérive systémique, le transhumanisme transgressant tout sens via le dérèglement raisonné de tous les sens. Ce qui est vérité n’est pas dans le fait mais dans ce que l’on croit ou ce que l’on désire. La vérité appartient à ceux qui ont le pouvoir, les moyens, l’audace. Tout le reste n’est que vie appauvrie de looser, « des humains transformés en automates » p.210, conditionnés au travail, aux transports, à la consommation – à la reproduction en masse de la masse – « la conspiration des endormis », disait Soledad à 15 ans.
De l’Initiation à l’Hadès via la Canopée Soledad, l’abandonné solitaire, va trouver en trois parties le sens de sa vie et une identité dans la résistance. Le sexe conduit à l’art qui conduit au décryptage des codes – c’est aussi simple que cela. Au fond, s’il n’y avait pas la mort, y aurait-il la vie ? Si nous ne devions pas mourir un jour, vivre aurait-il un quelconque prix ? Dès lors, remplacer l’homme par l’être cybernétique a-t-il un sens ? « Dans l’amour (…) se réalise l’union du charnel, du mental et de l’affectif. Nous faisant vivre des moments exquis, exceptionnels. Baignant dans l’harmonie du charnel et de l’invisible, nous éprouvons alors très fortement le sentiment d’exister » p.163. Soledad se veut le créateur d’un art sous forme de code qui fera se rejoindre l’âme et le corps. Il ne peut que réprouver ceux qui créent un code pour les séparer en niant le corps !
Un roman étrange et jouissif, très prenant, qui évoque Philip K. Dick avec sa puissance d’anticipation par l’imaginaire. Puritains et conformes s’abstenir.
Frederika Abbate, Les anges de l’histoire, 2020, Nouvelles éditions Place, 308 pages, €23.00
Site officiel de l’autrice
Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

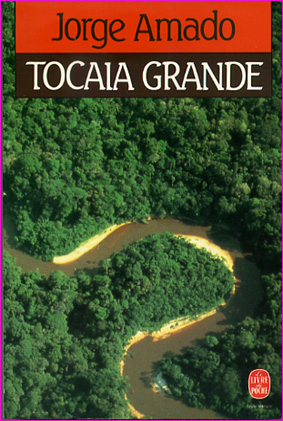


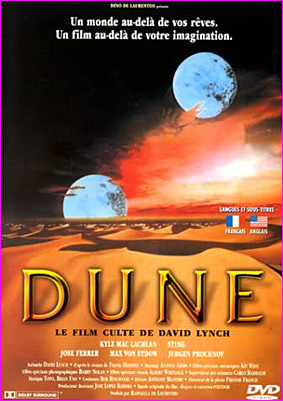
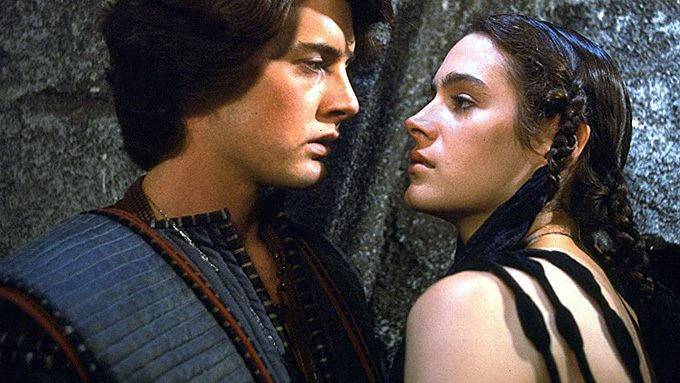
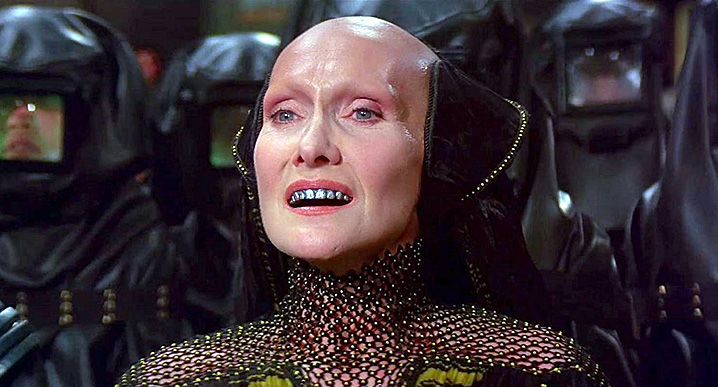






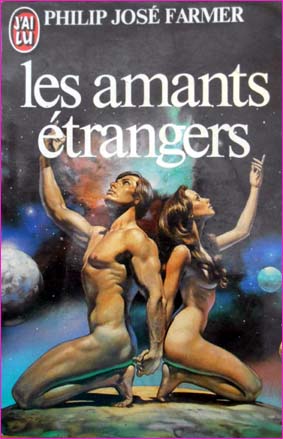

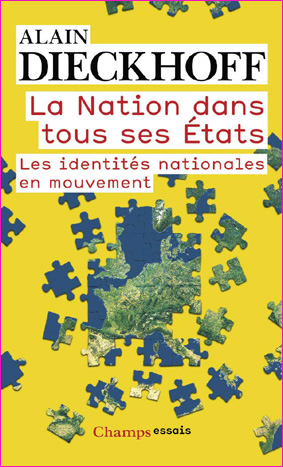






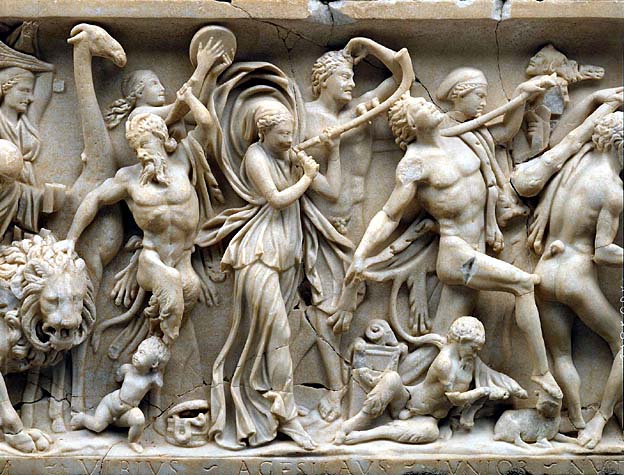










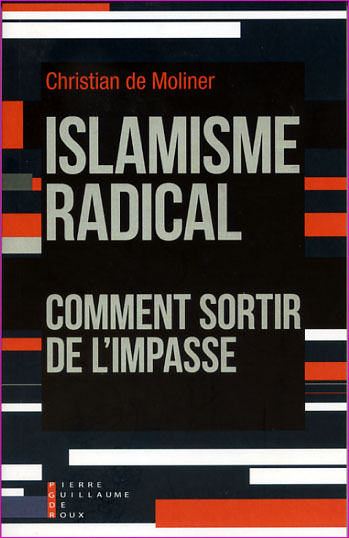
















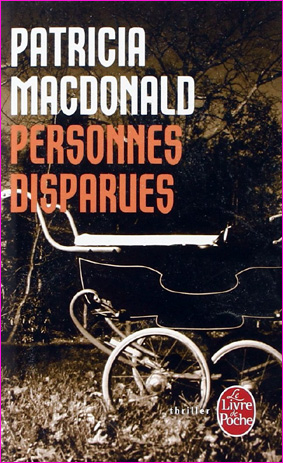


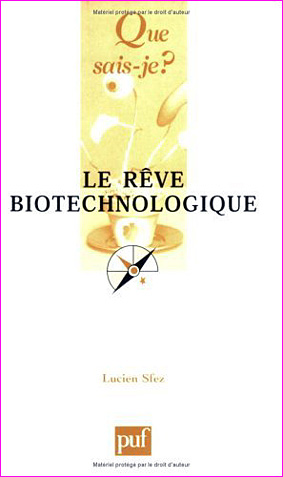








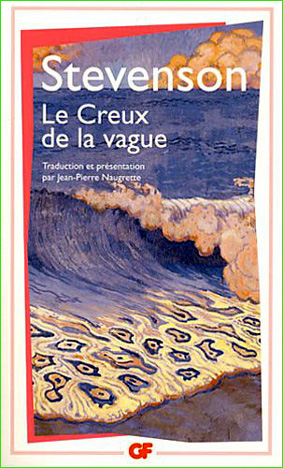






Voltaire, la raison et les injures
A propos du Contrat Social de Rousseau – brûlé à Genève – François Marie Arouet – dit Voltaire – écrit :
« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit » (Idées républicaines, 1762).
Il y aurait tant à dire de notre époque contemporaine, dans le style de Voltaire !
« Nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre » s’applique évidemment aux cléricaux de toutes religions et de toutes idéologies, et aux imbus d’eux-mêmes (ou d’elles-mêmes). Plus particulièrement en France aux politiciens, aux histrions des médias, aux auteurs qui veulent faire leur pub mais n’acceptent pas la critique, aux blogueurs qui ne « commentent » que pour dire leur réaction. Et tant d’autres.
« Pas assez d’esprit », pensez-y ! Voltaire faisait de la raison, cette faculté d’intelligence, le « bon » sens au-dessus des cinq que sont le regard, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût.
Nous le voyons sans peine, cette faculté de penser est bien rare parmi les politiciens, les histrions des médias et les blogueurs qui « commentent ». Bien sûr elle existe, mais elle est bien trop rare, mise en sommeil, effacée pour « ne pas avoir l’air », dans le désir d’être conforme à la masse, au plus petit con des nominateurs qui écoutent, lisent ou regardent.
Car il s’agit (séquelles de mai 68 ?) d’être dans le spontané, l’immédiat, le réactif, en ado attardé mû par son seul désir du moment, corps excité, cœur léger, esprit frivole.
« Si ce livre était dangereux, il fallait le réfuter. Brûler un livre de raisonnement, c’est dire : nous n’avons pas assez d’esprit pour lui répondre. Ce sont les livres d’injures qu’il faut brûler et dont il faut punir sévèrement les auteurs, parce qu’une injure est un délit. » Mais tout mot bizarre qui n’est pas dans le répertoire des 400 mots usuels est considéré comme injure. Evoquez le « grotesque » et on se sentira blessé : le mot signifie pourtant simplement « qui fait rire par son extravagance » – lequel dernier mot veut dire « hors de l’ordinaire, du convenu, celui qui vague en-dehors ».
Il est piquant que dans la langue de Voltaire les mots soient imprécis, qu’au pays de Voltaire les propos de Voltaire soient ignorés, les idées de Voltaire soient inappliquées et que le tempérament libéral de Voltaire soit honni par ceux qui prétendent « libérer » les hommes.