Mort à 26 ans d’un accident de voiture, Jean-René Huguenin (Je rends heureux » selon l’un de ses amis), est un écrivain en herbe devenu célèbre par son premier – et seul – roman : La côte sauvage, publié en 1960. Il écrit parallèlement des articles dans Arts et La Table ronde, poursuit des études à Science Po Paris et en licence de philosophie, prépare l’ENA. Parisien du XVIe arrondissement, habitant la même rue que Mauriac, il fonde avec Philippe Sollers et Jean-Edern Hallier la revue Tel quel. Mais, à l’inverse du premier, il n’est ni froid ni calculateur : « sa passion se contemple trop elle-même » p.198. A l’inverse du second, ni mégalomane ni paranoïaque : « J-E H ne pourra jamais faire une grande œuvre, parce que son désir de créer s’arrête au mensonge. Le mensonge est impuissance » p.66. De fait, le fou Hallier n’est pas resté dans la mémoire.
C’est un jeune homme tourmenté du passage de l’adolescence à l’âge adulte, se raidissant de discipline et de virilité, cherchant l’amour des femmes sans que cela soit réciproque. La dernière, Marianne, aurait pu être la bonne, bien qu’égoïste et narcissique, mais la vitesse l’a fauché sur la route. Prémonitoire lorsqu’il écrivait, deux semaines avant sa mort : « J’imagine l’impression que donnerait à un étranger la lecture de ce journal depuis janvier dernier : un velléitaire, qui tour à tour se brûle et s’adore, se vante et s’accuse, un emphatique dont les cris de gloire et de détresse expriment toujours la même faiblesse, la même vulnérabilité aux changements, de temps, de lieu, de lune, d’humeur, de santé, de chance et de circonstances » p.407.
Je n’avais pas vraiment aimé, à 16 ans, son seul roman conseillé par ma prof de français de seconde. Je n’ai guère apprécié son Journal aujourd’hui. Jean-René était prometteur mais pas fini. L’élan de sa jeunesse est sympathique, mais trop court. Son époque n’est pas la nôtre, lui coincé entre ses pères issus de la Résistance et l’ennui baby-boomer qui mettra le feu à mai 68. Ses mots les plus courants sont passion, folie, insolence, impossible, sacrifice, honneur, grandeur, douleur… Ils ne signifient plus guère de nos jours.
S’il est lu encore avec autant de passion c’est que, sans cesse, jeunesse se cherche. Mais il n’apporte pas de réponse, sinon travailler, restreindre ses sorties et se plonger dans l’écriture. Pas sûr qu’un jeune d’aujourd’hui puisse souscrire à un tel programme monastique ! « Je ne sais pas trop où mettre la sensualité dans ma vie, je sens bien qu’elle ne sollicite, mais je ne vois pas comment l’accorder avec les valeurs auxquelles je crois » p.51. C’est simple : la génération suivante a balancé les « valeurs » avec ses slips et culottes. « Il me croit pédéraste : c’est étonnant comme ces gens-là ne peuvent pas imaginer le monde fait autrement qu’à leur image » p.63. Arriver, aujourd’hui, c’est coucher. Si possible avec les femmes couguars qui tiennent le haut de certaine édition, à défaut avec les invertis qui tiennent le haut des autres. Mais, depuis 68, pas question de ne pas sacrifier son corps. Tout l’inverse du début des années 60 où un jeune homme pouvait tranquillement écrire : « Je n’ai pas envie de femmes, mais d’elle. La femme, avec sa poitrine repue et ses cuisses pliées, béantes, restera sans doute pour moi un objet d’un autre monde, animal un peu répugnant, et dont je ne songe plus qu’à m’écarter après le plaisir. Mais d’elle, de son corps mat, enfantin et nerveux, je ne suis jamais rassasié » p.380.
Mais il recèle quelques recettes pour écrire : « Bien comprendre qu’un roman n’offre aucune difficulté, aucun piège particulier ; que sa seule loi est le naturel, et qu’on peut l’écrire comme une lettre, un journal, ou comme un rêve… » p.135. État qui demande non pas de sommeiller dans la vie, mais de vivre à propos : « Moins vivre pour rêver mieux, et mieux rêver pour vivre plus » p.203.
Et quelques traits sur ses contemporains qui restent d’une brûlante actualité : « Raisonneurs sans être logiques, traditionalistes sans être fidèles et sentimentaux sans passion, les Français d’aujourd’hui [1959] sont décidément un peuple d’une dégoûtante médiocrité » p.207. Il y trouve remède dans la lecture du livre de Clément Rosset : La philosophie tragique. Il se donne pour mission d’être sans cesse stimulé : « Découvrir, pour soi-même et pour les autres, des milieux réactifs : paysages, spectacles, langages – dépaysants » p.318. En bref tout ce qui déplaît à ceux qui ont peur de changer ou de s’adapter, à commencer par les intellectuels « de gauche » !
Jean-René Huguenin, Journal 1955-1962, 1964, Points Seuil 2010, 410 pages, €7.22







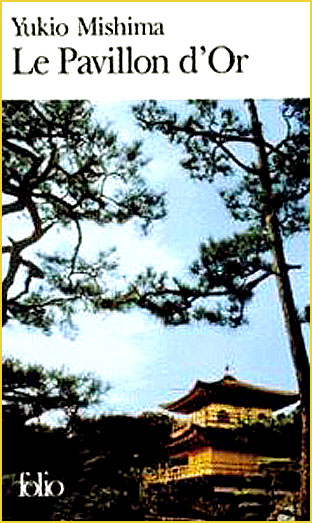

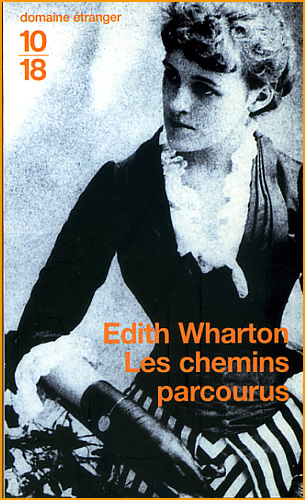



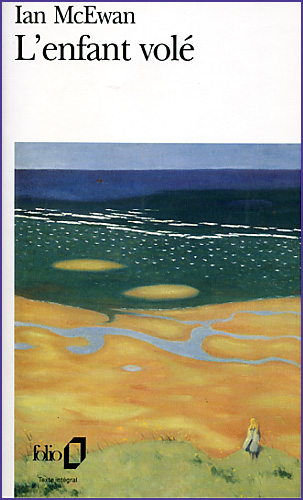





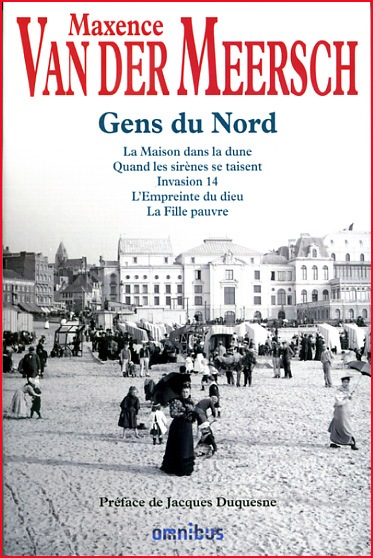


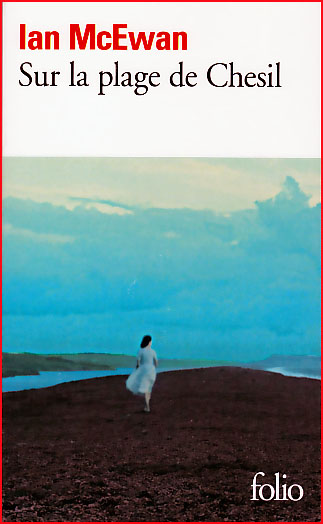
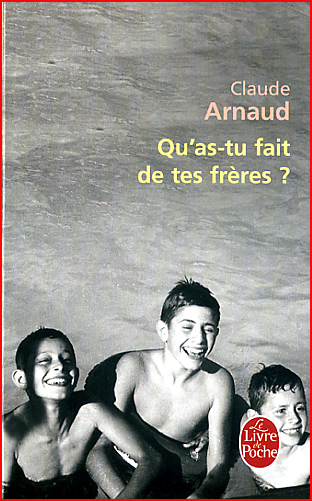
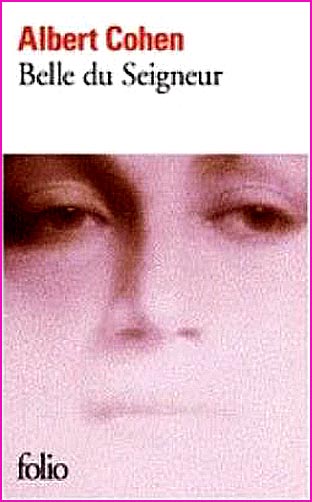




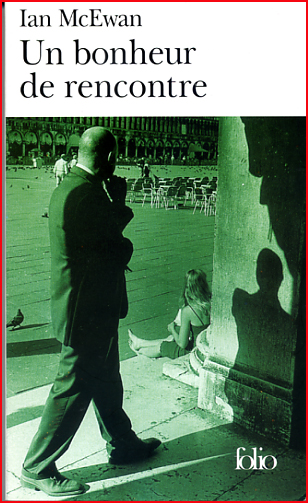


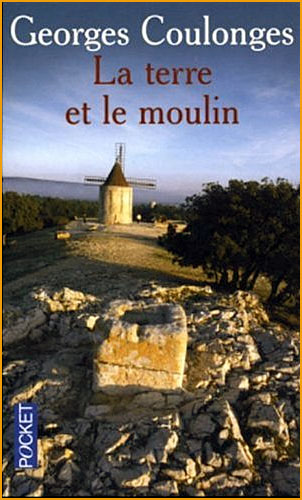




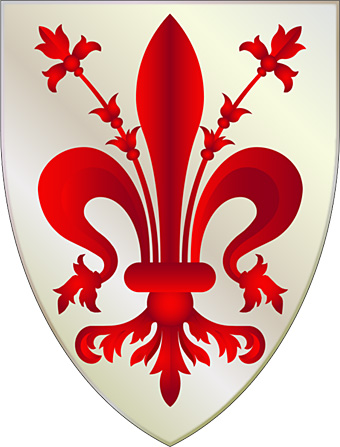

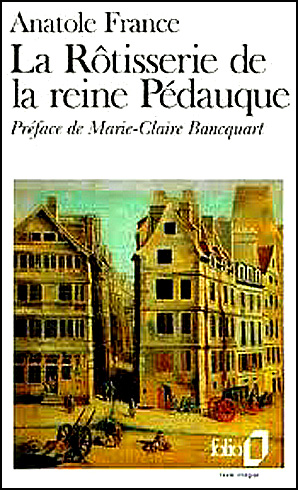


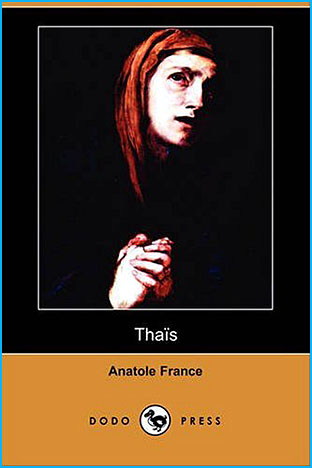
Commentaires récents