En 2004 s’est trouvé édité un manuscrit inachevé datant de 1942. Les deux filles rescapées d’Irène Némirovsky, née à Kiev dans une famille juive exilée par la révolution bolchevique, l’ont publié en hommage à leur mère, arrêtée par la police française comme apatride en juillet 1942 et livrée au camp d’Auschwitz, où elle meurt un mois plus tard. Suite française, rédigé entre 1939 et 1942, devait comprendre cinq parties ; les deux premières sont à peu près achevées, sous le signe technique de Tourgeniev (approfondir la psychologie de chaque personnage avant de commencer d’écrire), de Balzac (pour l’acuité de la description sociale) et pour Tolstoï (l’enchevêtrement des destins lors du bouleversement de la guerre). Irène Némirosky avait pour ambition d’écrire son Guerre et Paix. Il ne reste que les premiers tableaux, tout frais. Plus qu’un roman achevé, ils donnent aujourd’hui un éclat particulier au témoignage.
Une « suite » est ce qui accompagne pour faire honneur ; c’est aussi une série de pièces instrumentales dans le même ton ; enfin un enchaînement de faits qui se suivent. Ce titre, intello au premier regard, se comprend mieux une fois la lecture des 573 pages achevées. Il s’agit de vérités sociales françaises, observées et rendues avec une objectivité sans ressentiment, qui se développent dans un engrenage de destin. Tempête en juin est un docu-fiction, le récit de l’Exode sur les routes de France en cet été 39 torride, sous l’avance imprévue des Allemands. Toute la société se délite, trop vieille, trop frileuse, trop attachée à sa force tranquille fantasmée plutôt que préparée. Pour décrire cet état de fait, Némirovsky crée des personnages emblématiques.
Les Péricand sont bourgeois catholiques bien-pensants, issus de riches industriels lyonnais, serviteurs de l’État ou de l’Église, « ils ne tenaient pas à l’argent mais l’argent tenait à eux. » Un père conservateur de musée, le fils aîné prêtre « scout », seul le second fils Hubert, 18 ans, « joufflu et rose », garde une volonté de se battre grâce à sa jeunesse. Gabriel Corte est le Grand-Écrivain-Français, Intellectuel à majuscule se voulant guide de l’esprit depuis les Lumières ; il est beau, sensuel, fortuné, à maîtresse et relations. Ce qui le préoccupe n’est pas son pays mais son moi narcissique : « que sera l’esprit demain ? » Dans les parties non écrites, l’auteur en fait un laudateur du nouveau pouvoir, trouvant « des formules décentes pour parer les vérités désagréables ». La langue de la Ve République (voir LQR d’Eric Hazan) a utilisé depuis ce genre de talent avec profit, transformant par exemple les pauvres en « exclus » et les balayeurs en « techniciens de surface ». Les Michaud sont employés de banque, petit-bourgeois dignes, ils surnagent dans l’océan des lâchetés ; leur fils unique Jean-Marie, mobilisé puis blessé, prépare l’espoir de la Résistance future. Charles Langelet, parisien, est ce prototype du vieux garçon maniaque et décadent qui ne rêve que de « beauté » civilisée mais ne fera jamais rien pour la défendre ; « frileux, dédaigneux, il n’aimait au monde que son appartement et les objets… ».
Aline et Jules, prolétaires, usent de violence pour voler le dîner (fin) de l’écrivain Corte et de son arrogante pétasse car « ils nous verraient crever pire que des chiens ». Eux, les gens du peuple, ressentent non pas l’égoïsme du nanti qui perd ses biens, mais « colère, chagrin, honte » de la Défaite. Pour Irène Némirovsky, « tout ce qui se fait en France dans une certaine classe sociale depuis quelques années n’a qu’un mobile : la peur. Elle a causé la guerre, la défaite et la paix actuelle. » Mais « il y a un abîme entre cette caste qui est celle de nos dirigeants actuels et le reste de la Nation. » (p.523) Possédant moins, le peuple a moins peur et la lâcheté étouffe moins ses bons sentiments.
Ces personnages, introduits chapitre après chapitre, vont voir leur destin se nouer dans la seconde partie qui décrit l’Occupation dans un village inspiré d’Issy-L’évêque en Saône-et-Loire, où Irène Némirovsky et ses enfants s’étaient réfugiés. L’on y retrouve les classes, la vicomtesse de Montmort, catholique militante, « chargée par la nature d’éclairer ces bourgeois et ces paysans », les Angellier, belle-mère âpre au gain et belle-fille délaissée, les paysans vivant de la terre, Madeleine et Benoît Labarie. Le rustre Benoît, par fierté paysanne, tuera un Allemand et devra se cacher avant d’entrer, par engrenage du destin, dans la Résistance. Point de haine envers les vainqueurs – jeunes, robustes, parfois cultivés et souvent beaux torse nu – mais le désir de s’en servir : les femmes pour « arriver », les hommes pour accumuler provisions, terres et or. « Aux habitants des pays occupés, les Allemands inspiraient de la peur, du respect, de l’aversion et le désir taquin de les rouler, de profiter d’eux, de s’emparer de leur argent ».
Irène Némirovsky ne s’aime pas. De son enfance solitaire entre un père trop occupé par ses affaires et une mère qui lui en voulait de la faire vieillir, elle s’est réfugiée dans la lecture. Elle pourfend d’une plume acerbe la vanité qui lui a pris sa mère et l’accumulation sans fin qui lui a dévoré son père et tout le peuple juif auquel elle appartient par le sang et le destin. Elle se croyait intégrée à la France, elle découvre le chacun-pour-soi des périodes de crainte. « Mon Dieu ! Que me fait ce pays ? Puisqu’il me rejette, considérons-le froidement. » (Notes p.521)
Elle distingue la masse, mue par des courants profonds, des individus, mus par une morale : « Je fais ici serment de ne jamais plus reporter ma rancune, si justifiée soit-elle, sur une masse d’hommes quels que soient race, religion, convictions, préjugés, erreurs. Je plains ces pauvres enfants. Mais je ne puis pardonner aux individus, ceux qui me repoussent, ceux qui froidement nous laissent tomber, ceux qui sont prêts à vous donner un coup en vache. » (p.522)
Elle reproche aux Français leurs postures théâtrales plutôt que l’efficace préparation d’un objectif fixé par une volonté (ce qui est le cas des Allemands en 39 et le sera des Anglais dès 40). « Il y avait dans le patriotisme et la germanophobie, comme d’ailleurs dans l’antisémitisme et, plus tard, dans la dévotion au maréchal Pétain, quelque chose de théâtral qui la faisait vibrer » (p.380). Cette attitude subsiste dans l’intelligentsia française : elle est aujourd’hui tournée contre les Américains ou les Allemands mais c’est bien la même arrogante et vaine posture de cocotte vieillissante, qui préfère la facilité des poses à la difficile réalité des actes. « 1942. Les Français étaient las de la République comme d’une vieille épouse » (p.522). Ces temps pourraient bien revenir…
Irène Némirovsky, Suite française, 2004, Prix Renaudot, Folio 2006 567 pages, €8.93


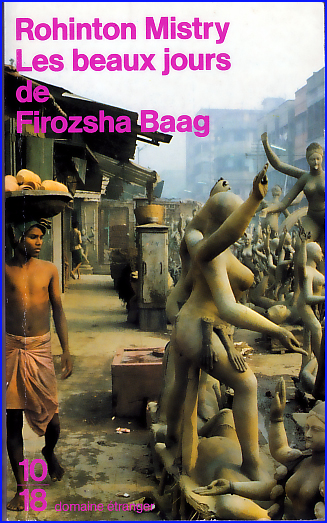



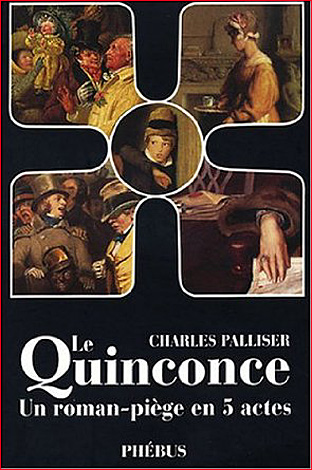


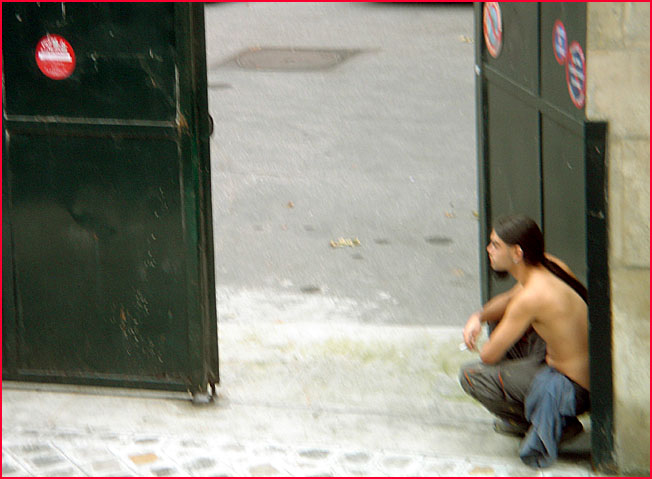






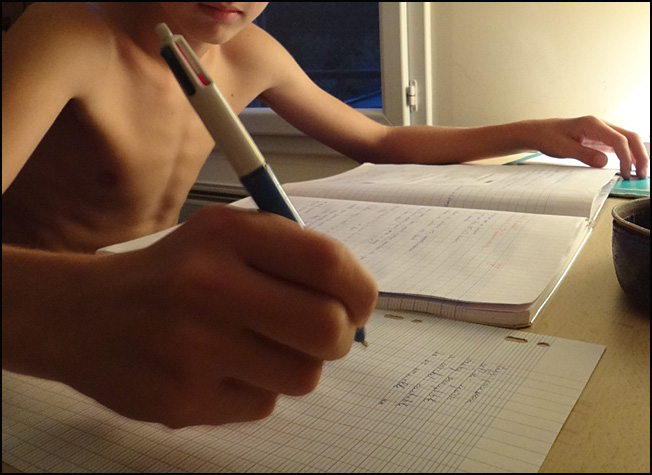
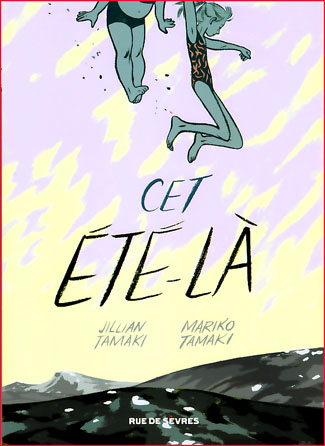
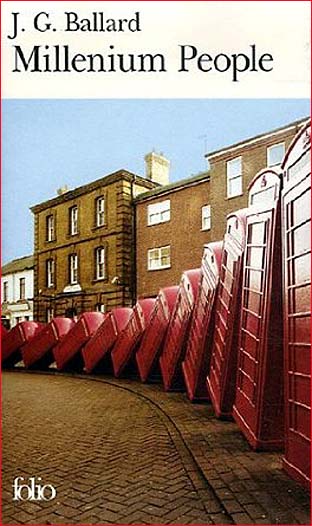

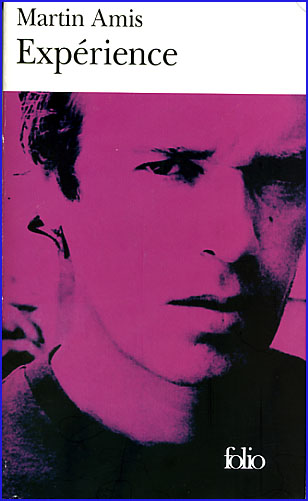


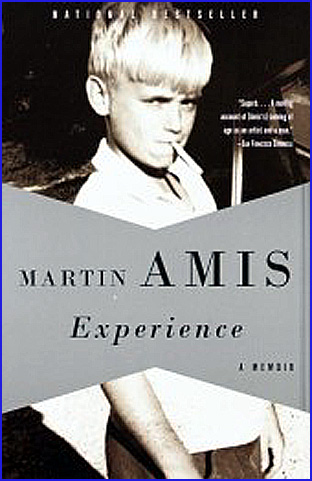







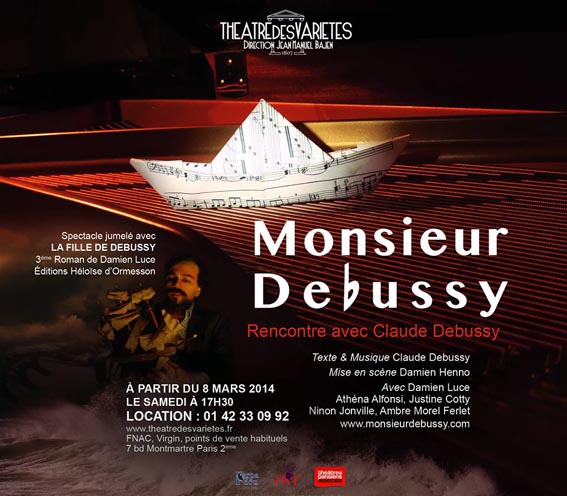


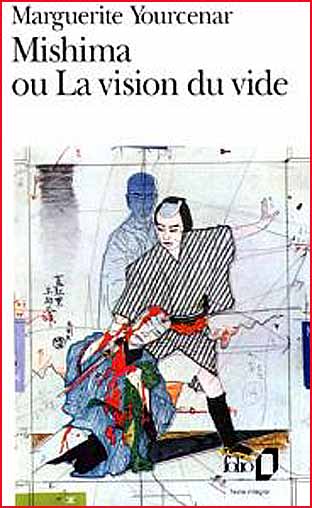





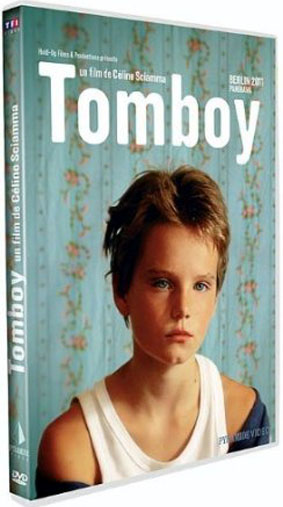








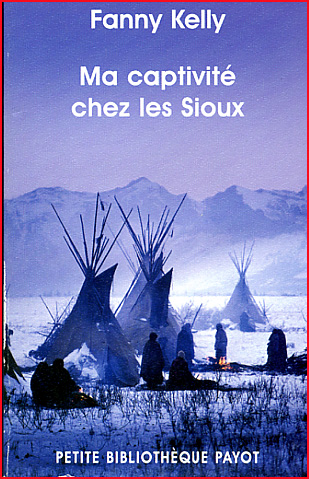

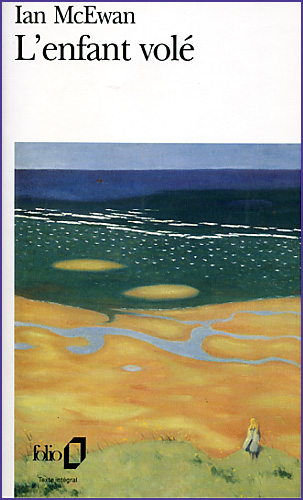

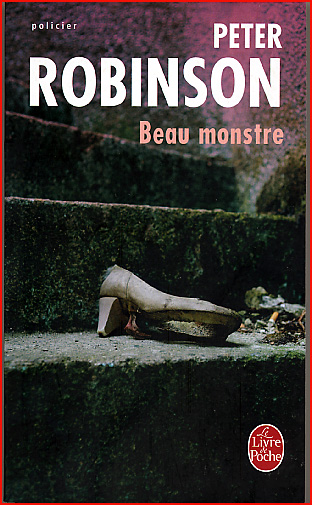

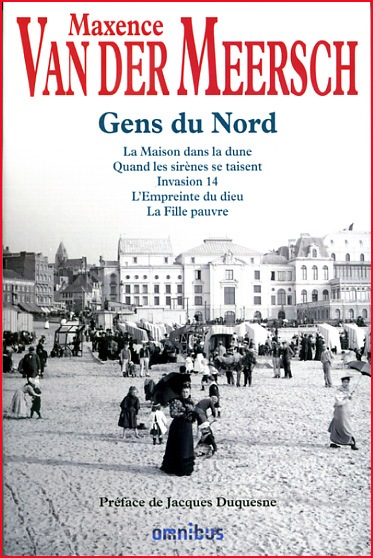

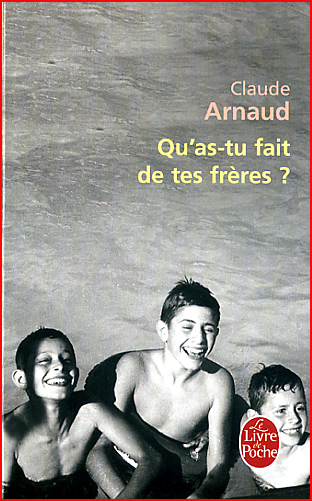


Commentaires récents