Pepe est de retour avec la politesse du désespoir. Car l’Espagne post-franquiste se trouve vulnérable, en proie aux démons de la toute neuve démocratie qui a ouvert toutes grandes les vannes de la liberté, permettant aux prédateurs d’en user les premiers, aux dépends des autres. Lorsqu’il était encore instructeur pour la CIA, Pepe Carvalho le Galicien ayant élu domicile en Catalogne, a rencontré en avion pour Las Vegas un Espagnol et un Allemand, tous deux travaillant dans une multinationale.
Jauma est l’Espagnol, il a fondé la succursale à Barcelone. Rhomberg est l’Allemand, inspecteur pour la firme. Pepe ne les côtoie que trois jours, dînant de façon succulente avec eux avant de jouer vaguement sur les machines à sous. Puis les années passent…
Un jour, la police retrouve Jauma assassiné en Espagne, sans slip et une petite culotte de femme dans la poche. Sa veuve mandate Carvalho, devenu détective privé, pour en savoir plus sur les causes de la mort. La version officielle veut qu’un mac ait fait son affaire à l’homme d’affaires parce qu’il avait un peu trop abusé d’une fille. Mais la petite culotte est neuve et n’a jamais été portée – Carvalho conclut donc à un montage.
A qui le crime profite-t-il ? A la multinationale ? Pepe renoue avec ses anciens condisciples de fac, au temps où ils étaient de gauche avant de bourgeoisement se ranger. Un banquier l’aide à comprendre les ramifications de la firme et les Espagnols aux conseils d’administration des diverses filiales. Jauma, ayant gardé de solides habitudes de province, faisait contrôle sa comptabilité par un ami de son père ; il a découvert quelques trous dans les comptes, dont le dernier très élevé. Est-ce pour cela qu’il a été éliminé ?
La veuve, confortablement pensionnée par la firme et ayant quatre orphelins à charge, se rétracte et veut clore l’affaire, tout comme la police sur laquelle « on » fait pression – « d’en haut » ajoute un policier. De quoi allécher Carvalho qui n’aime pas le travail mal fini. Il n’aura de cesse de découvrir qui est derrière tout cela et pourquoi, n’hésitant pas à mettre en danger ses amis, sa pute favorite Charco dont on torture les seins et l’ex-taulard ancien de la division Azul Biscuter, rencontré en prison et à qui il a appris la bonne cuisine. Il livre d’ailleurs une recette sophistiquée de salmis de canard p.164 que chacun peut suivre, tout en allumant le feu avec Critique de la raison dialectique de Sartre p.76. Car il s’agit, comme tant de livres d’intellos, d’une fausse culture qui se glose mais ne se vit pas, « une orthopédie verbale ou écrite » p.247 –autrement dit un redressement de pensée dont chacun peut se passer s’il veut garder sa liberté.
Montalbán explique la politique à la faction cultivée qui lit ses livres à la fin des années soixante-dix : « Franco nous a donné une grande leçon. C’est à coup de pied au cul qu’on fait produire un pays. La démocratie ne peut pas employer de telles méthodes, mais elle a besoin d’une certaine terreur parallèle, sale, qui pousse les gens dans les bras des forces rééquilibrantes, propres » p.279. Le centre fait apparaître la violence des ultras comme un moindre mal ; la gauche s’en sert comme alibi car elle ne peut renverser les centristes sans que le vide du pouvoir ne soit occupé par les sauvages ; les ultras sont contents car ils peuvent casser et même tuer à l’occasion, ce qui maintient la gauche à distance et conforte les centristes. Au fond, cet équilibre machiavélien va à tout le monde sans qu’un quelconque « complot » soit utile. Il a été pratiqué dans l’Italie des années de plomb et renaît, de nos jours en France avec les black-bloc et les jaunes-gilets. En politique politicienne, rien ne change – et relire Montalbán permet de s’en rendre compte.
L’action est pimentée par ces considérations de stratégie civiques et par des observations sociologiques qui valent leur pesant de pâte humaine. Tel ce bar où « des cadres moyens de gauche puritains disposés à voir de près l’espace d’une nuit le spectacle décadent et sans doute scandaleux de la gauche noctambule » p.69. Ou la philosophie du bourgeois arrivé Argemi : « Lorsqu’on découvre qu’on ne vit qu’une fois, alors on a atteint la maturité. Et de deux choses l’une : soit on décide de vivre matériellement le mieux possible, soit on se drogue de transcendance et on devient mystique » p.141. Pas bête, si l’on y pense. Garder son idéal tout en vivant bien est cependant la balance précaire à laquelle se contraint Pepe Carvalho, ce pessimiste tendre.
Car il veut finir l’enquête par la vérité, pour l’avenir du fils encore enfant de Rhomberg qui a lui aussi été tué. Il y parviendra, renonçant à tout le fric qu’il pourrait se faire et à ce grand vin de France dont on lui propose un verre et qui finit sur le tapis.
Manuel Vasquez Montalbán, La solitude du manager (La Soledad del Manager), 1977, Points policier 2014, 320 pages, €7.50
Les pages indiquées dans le texte sont celles de l’édition 10-18 1996

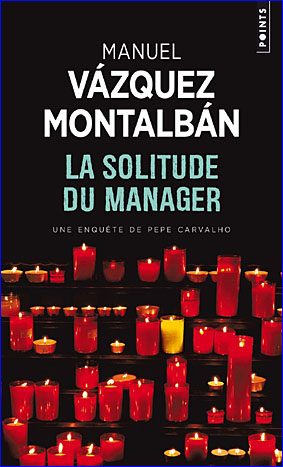
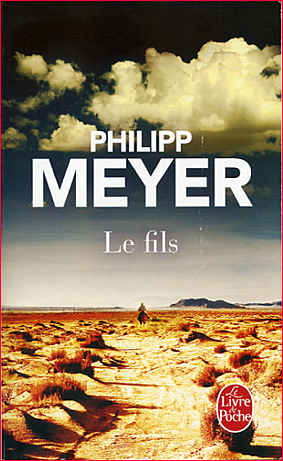

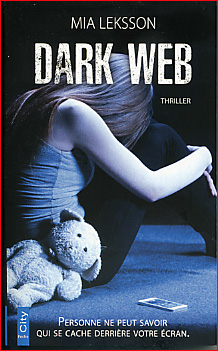







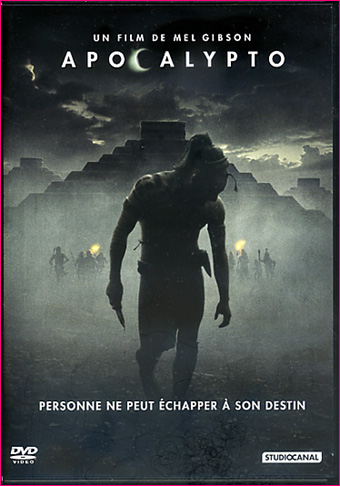






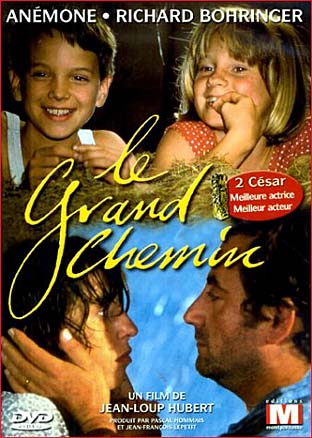



















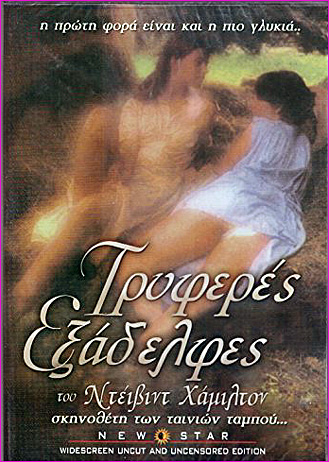










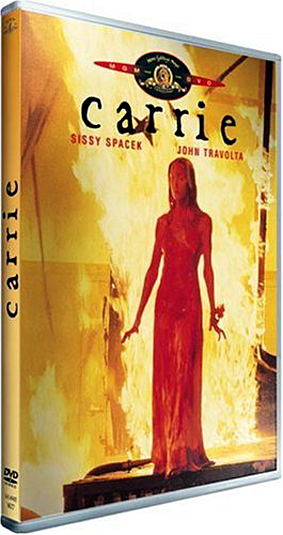



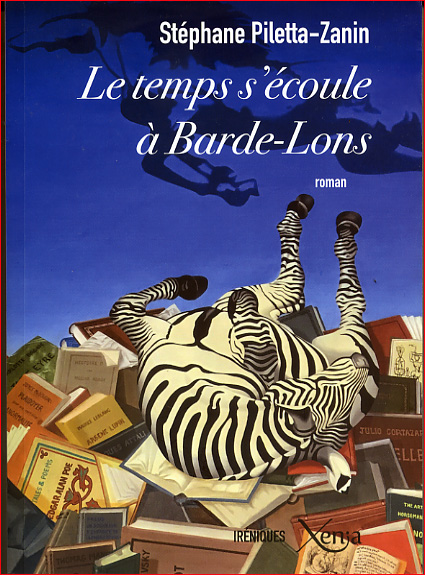
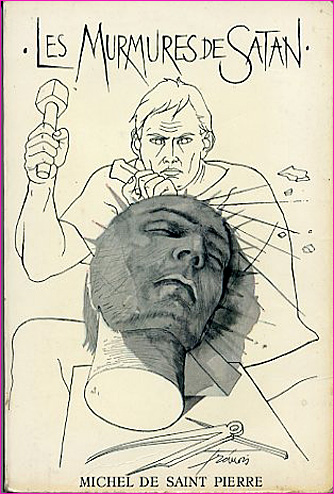








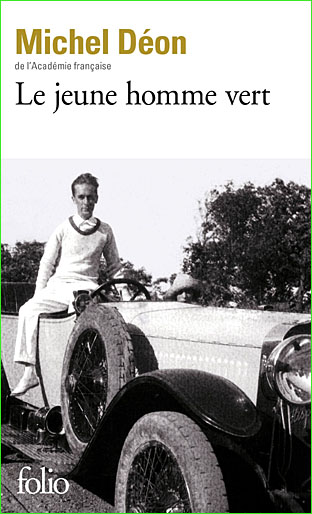




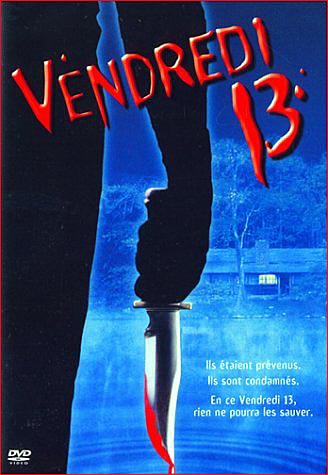








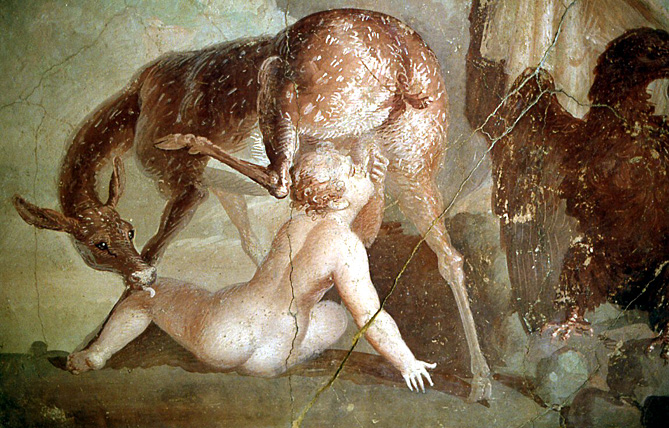
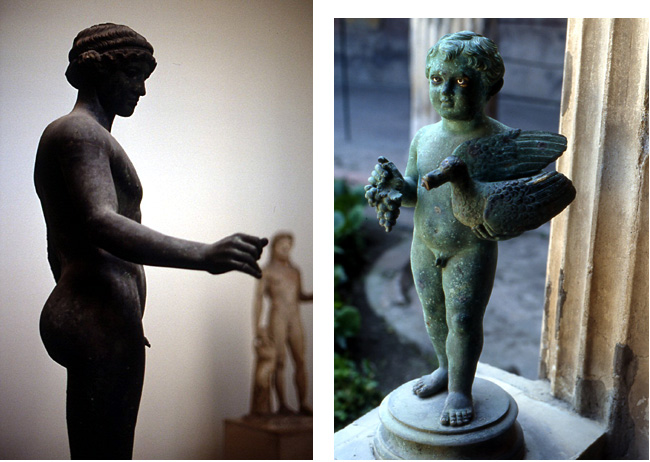






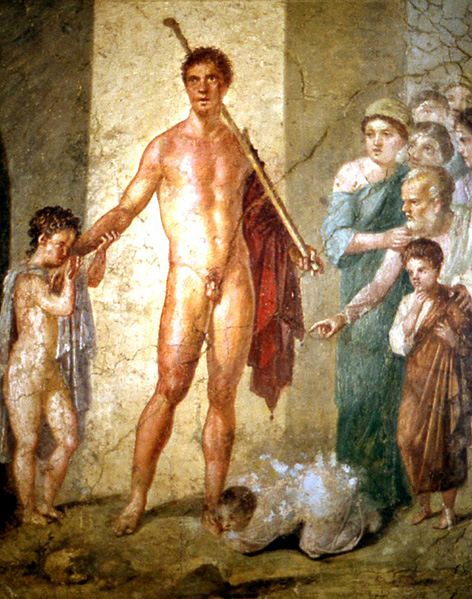












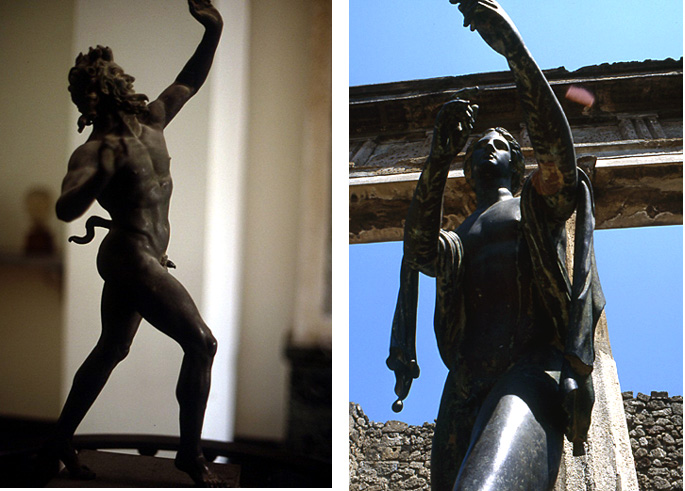




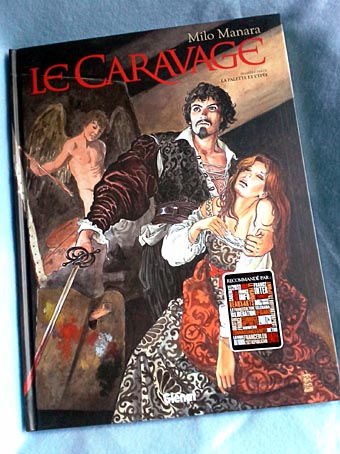





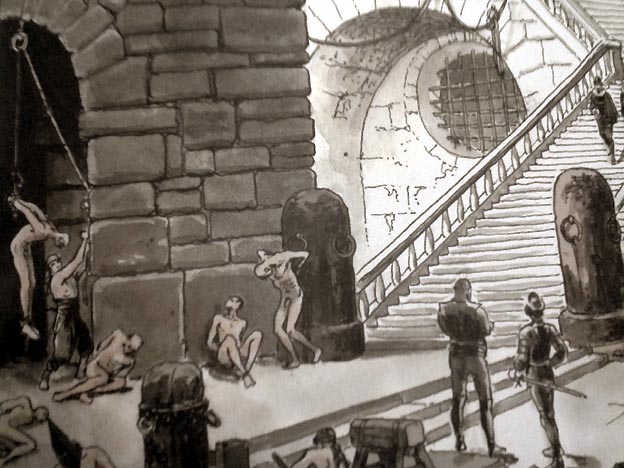


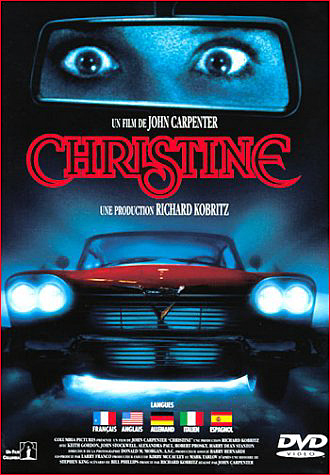





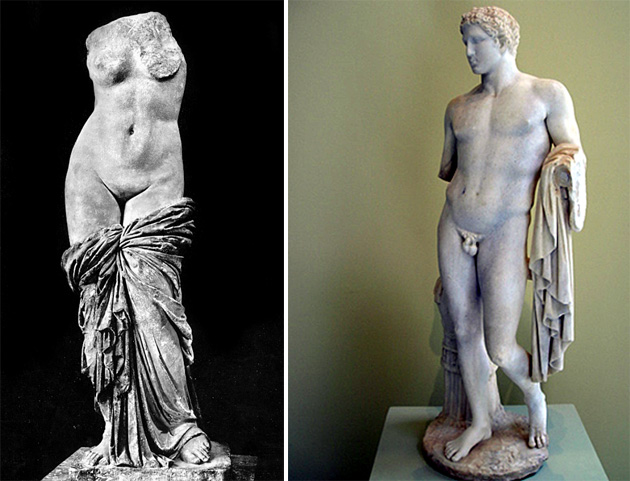








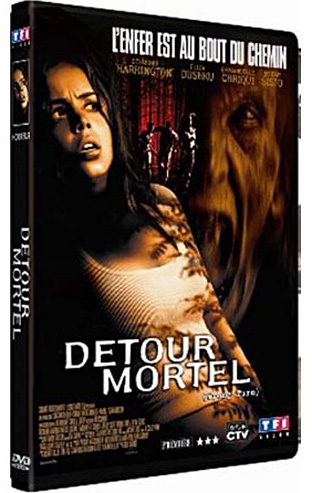






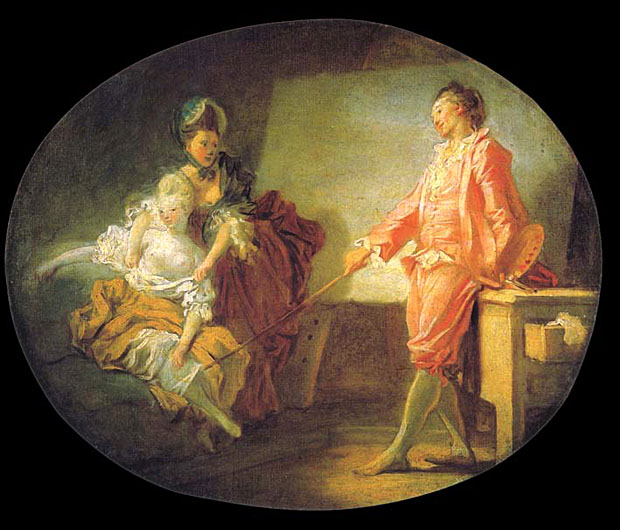

















































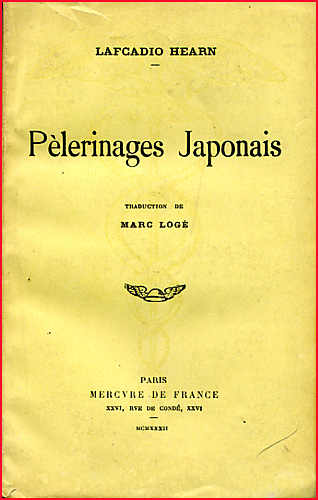

Commentaires récents