Le feuilleton catho sur Arte le jeudi soir qui vient de diffuser ses derniers épisodes, sponsorisé par Le Monde et Allociné, m’a laissé dubitatif. Certes, j’ai « fait une croix sur mes jeudis soirs », comme il est dit dans la pub. Mais la série commence bien et termine mal. Elle débute par la quête sympathique de cinq jeunes apprentis prêtres, réunis au séminaire parisien des Capucins ; elle s’achève par le chaos intégral, disons-le même, par la bouffonnerie. Le catholicisme n’est peut-être pas reluisant, mais une spiritualité existe. Force est de constater qu’elle est totalement absente de ce feuilleton.
Construit à la manière brouillonne d’aujourd’hui (on essaye « l’écriture » et on compose au montage), la série est mieux inventée et mieux créée que Plus belle la vie, mais en garde tous les défauts : le superficiel, le zapping permanent, l’absence de profondeur des acteurs, même mis dans des situations invraisemblables. L’acteur venu direct de FR3, Emmanuel (David Baiot), est d’ailleurs le plus inconsistant des cinq personnages. On se demande pourquoi il a choisi le catholicisme, alors qu’il est d’une famille adoptante « normale » ; on se demande pourquoi il est effaré de se découvrir pédé comme un phoque alors que c’est tellement tendance ; on se demande pourquoi il a choisi l’archéologie alors qu’il « désire » tant les autres (du même sexe). Son amant sans père, Guillaume (Clément Manuel), à la mère soixuitattardée, ne « choisit » la prêtrise que pour fuir les bonnes femmes et la vie normale de couple.
 Le trio plus consistant offre une belle brochette de naïfs, séduits par l’aspect social dans les ors et les pompes, sans voir plus loin que le bout de leur nez. Il y a un millénaire et demi que l’Église catholique a choisi clairement la voie du pouvoir et de la politique, au détriment de l’entraide et de la spiritualité. Il suffit d’ouvrir un livre d’histoire… Yann (Julien Bouanich) émerge à peine de son village breton, sorte de lande archaïque si l’on en croit les scénaristes, où mère au foyer et père au conseil municipal font vivre un catholicisme de tradition coincée et sans histoire. Raphael (Clément Roussier) est dégoûté de son milieu haut-bourgeois, de la veulerie de son père dans la finance et des magouilles au nom du fric ; de plus, son meilleur copain lui a piqué la fille qu’il aimait – vous parlez de motivations pour devenir prêtre ! José (Samuel Jouy) a tué un homme dans la sordide banlieue de Toulouse (si connue depuis Merah…) et fait de la prison ; il veut expier au service des autres car il connaît la vraie misère – lui est probablement le plus véridique du lot.
Le trio plus consistant offre une belle brochette de naïfs, séduits par l’aspect social dans les ors et les pompes, sans voir plus loin que le bout de leur nez. Il y a un millénaire et demi que l’Église catholique a choisi clairement la voie du pouvoir et de la politique, au détriment de l’entraide et de la spiritualité. Il suffit d’ouvrir un livre d’histoire… Yann (Julien Bouanich) émerge à peine de son village breton, sorte de lande archaïque si l’on en croit les scénaristes, où mère au foyer et père au conseil municipal font vivre un catholicisme de tradition coincée et sans histoire. Raphael (Clément Roussier) est dégoûté de son milieu haut-bourgeois, de la veulerie de son père dans la finance et des magouilles au nom du fric ; de plus, son meilleur copain lui a piqué la fille qu’il aimait – vous parlez de motivations pour devenir prêtre ! José (Samuel Jouy) a tué un homme dans la sordide banlieue de Toulouse (si connue depuis Merah…) et fait de la prison ; il veut expier au service des autres car il connaît la vraie misère – lui est probablement le plus véridique du lot.
Mais au final, il en reste trois. José se fait descendre (quoi que « même pas mort », si l’on en juge par les derniers soubresauts des dernières images…). Emmanuel retourne à l’archéologie, mais sans vouloir même renouer avec un ancien condisciple (comprenne qui pourra…). Raphael choisit l’église contre le monde, et l’on prévoit qu’il sera aussi arriviste que les évêques et cardinaux en place. Guillaume reste dans l’Église parce que son éducation l’a rendu moralement invertébré et qu’il a besoin d’un carcan pour se construire. Yann, déçu que son ex-copine scoute envisage de faire sa vie avec un autre (à qui la faute, hein ?…), sera prêtre par dépit, pour ne pas recommencer l’existence terne de ses parents conventionnels.
Où est donc l’Appel de la foi ? Cela existe-t-il encore ? Ou bien la brochette de scénaristes, metteurs en scène, monteurs et producteurs du générique dont beaucoup ne paraissent pas catholiques est-elle laïcarde, acharnée à gommer par idéologie toute trace d’élévation ? En guise d’appels, nous avons l’appel de la camomille, l’appel de la chatte et l’appel du chef. Ce sont les trois moments désopilants de l’ensemble des épisodes, on les croirait écrit par Audiard…
- L’appel de la camomille est celui d’un pape sénile qui préfère les ordres maternants de sa nonne de service à une décision diplomatique avec la Chine.
- L’appel de la chatte est celui de Yann, qui croit avoir « trouvé Dieu » dans une église fraîche, alors qu’il revient d’une marche scoute avec sa cheftaine Fabienne, qui prie avec lui. Yann : « C’est là que, soudain, j’ai entendu l’appel de Dieu. » La chanteuse droguée qui l’a dépucelé entre deux cours du séminaire : « Ça va, j’ai compris, c’est l’appel de la chatte, pas compliqué à comprendre ! Elle était à côté de toi, vous étiez heureux, elle était en short comme toi… »
- L’appel du chef est résumé par Yann encore, le naïf sympathique du feuilleton avec son air de Tintin. Face à l’un des policiers appelés au séminaire pour déloger les sans-abris que José a accueilli par charité chrétienne, il lui lance « écoute ton cœur ! », puis il précise : « mais il a préféré écouter son chef et je m’en suis pris une ». L’appel du chef est aussi celui de Dom Bosco (Thierry Gimenez), le Dominique ébahi d’admiration devant son supérieur Fromanger (Jean-Luc Bideau), puis abasourdi de s’apercevoir qu’il bidouille la comptabilité, donc prêt à servir avec rigueur et discipline l’ordure de cardinal Roman (Michel Duchaussoy) qui le nomme calife à la place du calife.
 Certes, les séminaristes sont dans le siècle, avec tentations de la chair, avortement, drogue, misère du monde et obstacles politiques. La scène à l’université, où une secte gauchiste « au nom de la liberté d’expression » veut empêcher ces étudiants catholiques affirmés d’avoir cours en même temps qu’eux est un moment d’anthologie sur l’intolérance de gauche, toute maquillée de grands mots humanistes. Mais l’Église apparaît confite dans la tradition millénaire, fonctionnant en cercle fermé, autoritaire et hiérarchique, mentalement archaïque, où les femmes sont considérées comme des nonnes à tout faire.
Certes, les séminaristes sont dans le siècle, avec tentations de la chair, avortement, drogue, misère du monde et obstacles politiques. La scène à l’université, où une secte gauchiste « au nom de la liberté d’expression » veut empêcher ces étudiants catholiques affirmés d’avoir cours en même temps qu’eux est un moment d’anthologie sur l’intolérance de gauche, toute maquillée de grands mots humanistes. Mais l’Église apparaît confite dans la tradition millénaire, fonctionnant en cercle fermé, autoritaire et hiérarchique, mentalement archaïque, où les femmes sont considérées comme des nonnes à tout faire.
Seul Jean-Luc Bideau en charismatique supérieur du séminaire des Capucins s’élève au-dessus des élèves, des pères suiveurs comme des cardinaux. Il est venu à la calligraphie chinoise par la mystique, dit-il (tout à la fin…). Las ! Il détourne de l’argent, sans qu’on sache pourquoi. Peut-être est-ce pour le bien ? Par blocage de la bureaucratie d’église ? Pour pallier aux déficiences d’entretien des bâtiments ?
Il y a de beaux moments d’émotion dans les premiers épisodes, des confrontations aiguës avec la réalité, la mise en lumière exemplaire des faiblesses de chacun. Mais le dernier épisode clownesque gâche un peu l’ensemble. On dit qu’une Saison 2 est en préparation, souhaitons qu’elle tombe moins dans le « message » Grand-Guignol et qu’elle laisse un peu la place à la vérité des vrais catholiques eux-mêmes. Pourquoi les créateurs ne prendraient-ils pas conseil – non de l’institution Église – mais des pratiquants au ras du terrain ?
Ainsi soient-ils sur Arte TV
Ainsi soient-ils – Saison 1, DVD Arte Video, 24 octobre 2012, 8 épisodes de 55 mn, €27.99

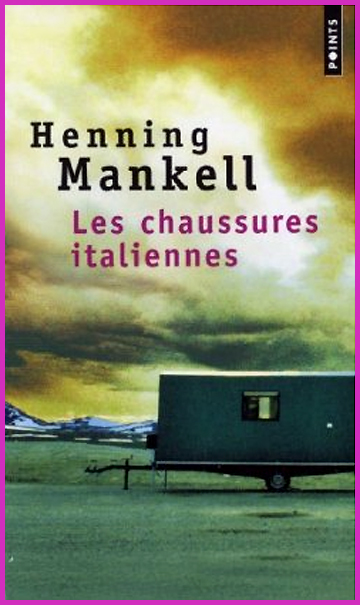












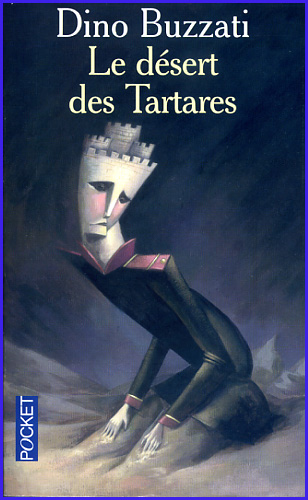
































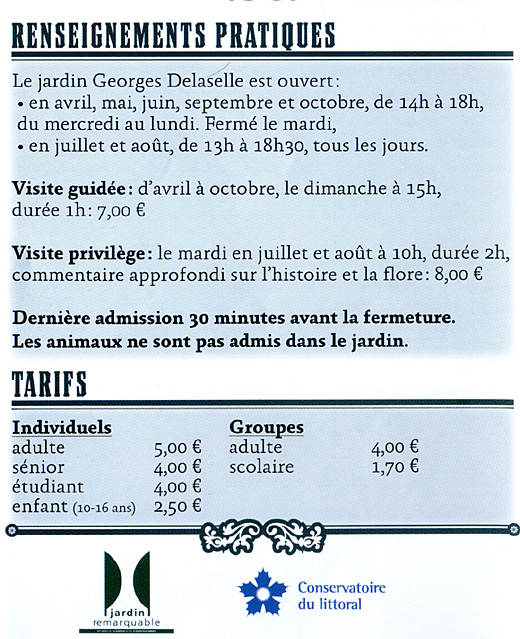
























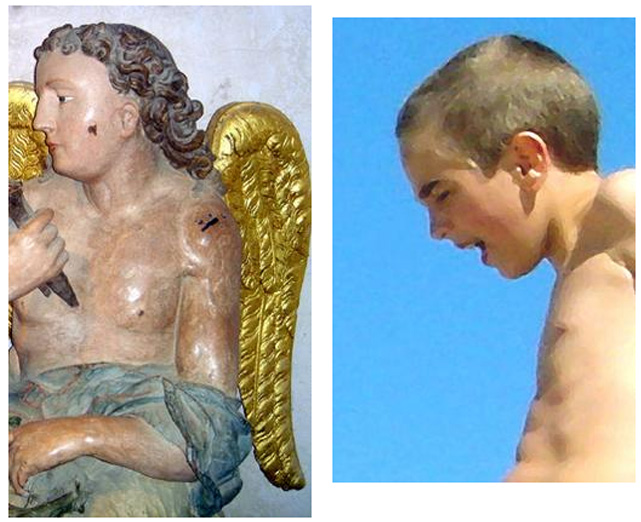






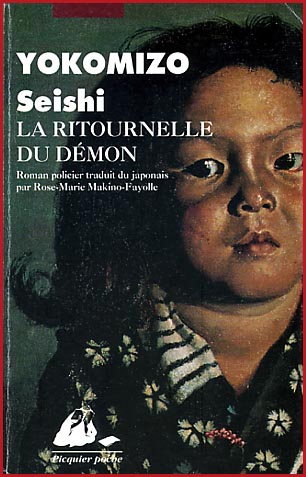
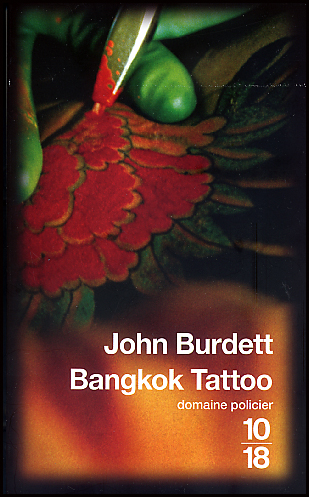

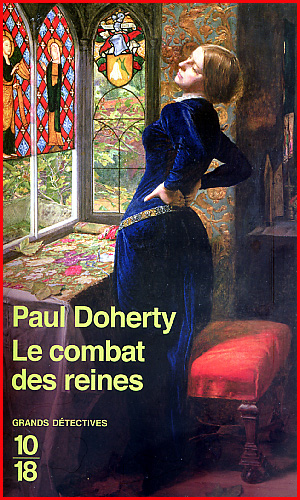





































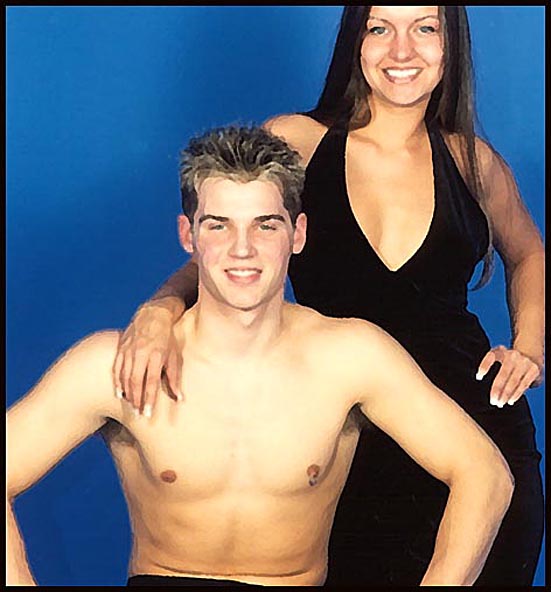
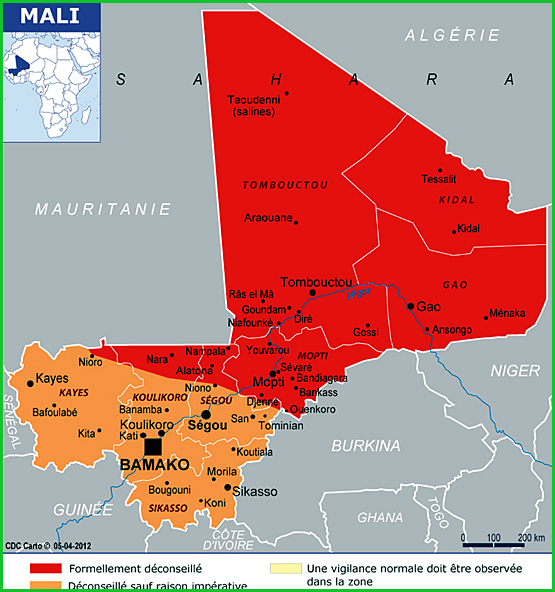





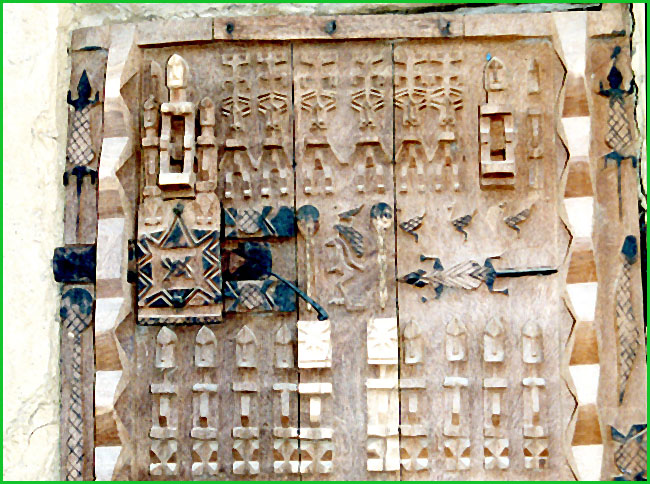
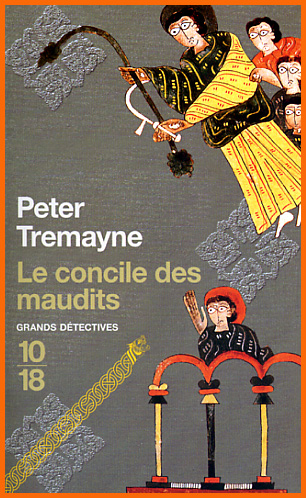



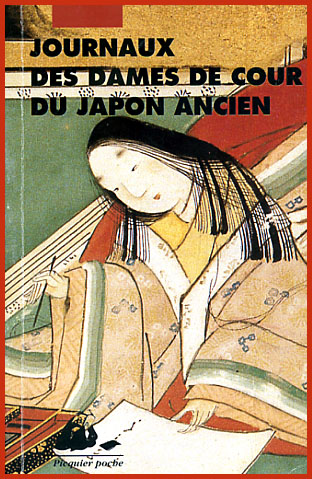













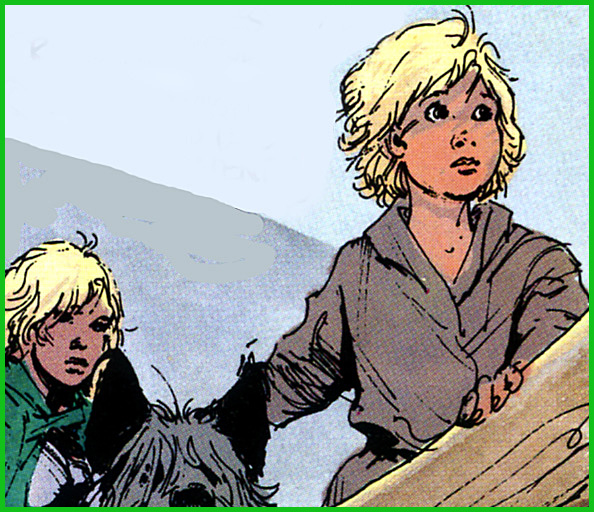

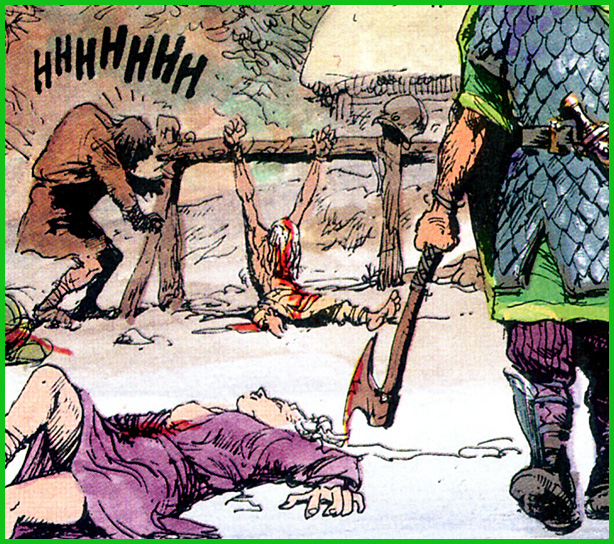




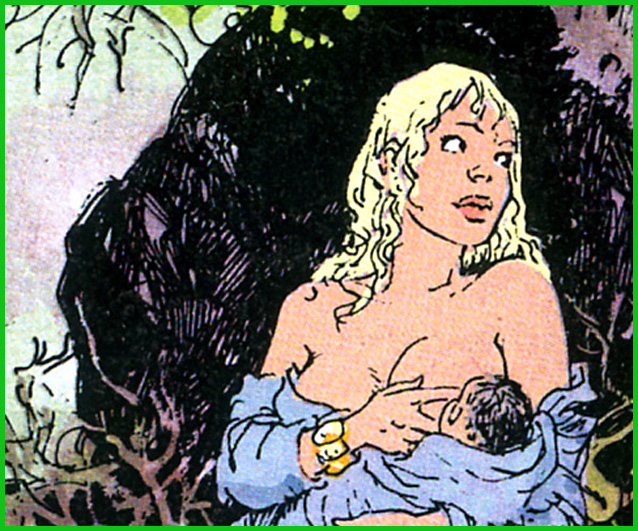
Commentaires récents