Pour se délasser de son Histoire contemporaine emportée par l’Affaire, qu’il publie en même temps, Anatole France classe divers textes parus entre 1884 et 1887 en un recueil sous le signe d’un double de lui-même : Pierre Nozière. C’était l’usage en ce temps-là, et il n’a pas disparu. Il y conte en trois parties des scènes d’enfance, des pensées en marge de Plutarque, et des promenades en Picardie, Normandie et Bretagne. C’est agréable, excellemment écrit, avec la simplicité des « dictées » d’enfance. Anatole France a inspiré Philippe Delerm dans ses textes courts et ciblés – mais France a la fluidité en plus et le guindé en moins.
Car rien de meilleur en français que la langue d’Anatole France. La simplicité fait passer l’érudition, le rythme les élans poétiques, l’enchaînement la complexité des récits. France est moderne : direct, accessible, précis.
En sa partie enfance, l’auteur reprend des histoires déjà contées dans Le livre de mon ami, avec quelques ajouts. La nostalgie nimbe d’une ombre de poésie ces petites choses intimes ressenties par sa personnalité enfant : l’imagination, la compassion, la honte. L’âge mûr le fait s’intéresser surtout aux gens : le marchand de lunettes sur les quais de Paris, Madame Mathias sa gouvernante, l’écrivain public, les deux tailleurs (de pierre), Madame Planchonnet, et d’autres encore.
En sa partie pensées, l’auteur a quelques mots bien sentis sur les cuistres – ceux qui sévissent encore, surtout dans l’enseignement. « Je tiens pour un malheur public qu’il y ait des grammaires françaises. Apprendre dans un livre aux écoliers leur langue natale est quelque chose de monstrueux, quand on y pense. Étudier comme une langue morte la langue vivante : quel contresens ! Notre langue, c’est notre mère et notre nourrice, il faut boire à même » p.556. Lorsque l’on constate combien – après 7 ans de langue « vivante » ! – nos bacheliers savent à peine ânonner l’anglais, on comprend pourquoi il serait plus utile de les immerger dans le bain plutôt que de leur faire apprendre par cœur des règles de grammaire livresque. Mais la pédanterie prof est sans limites, ils croient se hausser du col en pratiquant l’abstraction ; ils ne fabriquent que des crétins qui sont la risée du monde et que sanctionnent sans pitié les tests PISA.
En sa partie voyages, l’auteur explore la province, sa profondeur historique inscrite dans le paysage et dans les coutumes encore marquées des habitants (avant que la guerre de 14 puis la télé nivellent tout cela). Le christianisme encore païen le ravit ; il voit toujours les nymphes dans les sources et les faunes dans les bois, surtout lorsqu’une jeunesse conduisant ses moutons surgit au coin d’un fourré, ou une chapelle moussue d’un bosquet. C’est pittoresque, coloré, bienveillant.
L’unité du livre réside en la personnalité de l’auteur : enfant, penseur ou promeneur, il est bien lui-même à chaque instant. Curieux, sceptique, historien, il goûte de tous ses sens avant de se prendre de passions qu’il dompte et raisonne. Il aime le patrimoine, les légendes et traditions ; mais il les voit avec le recul de la science et de la république, sans superstition. Inlassablement les générations recommencent, elles renaissent toujours. Pourquoi donc le présent serait-il plus important ? C’est là le charme France – celui d’un caractère qu’on aimerait accoler au pays, le meilleur produit des Lumières.
Anatole France, Pierre Nozière, 1899, Œuvres tome 3, édition Marie-Claire Bancquart, Gallimard Pléiade 1991, 1527 pages, €61.75
Broché €7.09
Le reste du tome 3 des Œuvres en Pléiade ne mérite pas qu’on le lise aujourd’hui, aussi, je n’en parlerai pas. Sous l’invocation de Clio est une suite de contes historiques à la manière romantique, sans le souffle hélas, avec la vision faussée du temps sur les Gaulois. Crainquebille est un conte lourdement moral sur les préjugés de la justice. Histoire comique est une bluette entre cocotte, amant et spectre assez « fin de siècle ». Sur la pierre blanche, son « utopie socialiste » 1903 composée de bouts d’articles remaniés et contredits, est triste à mourir, une bavasserie d’intello (à son époque on aurait dit un dialogue entre érudits)… Rien qui vaille d’être lu encore, sauf pour les amateurs de la prose Anatole France. Car c’est toujours admirablement écrit



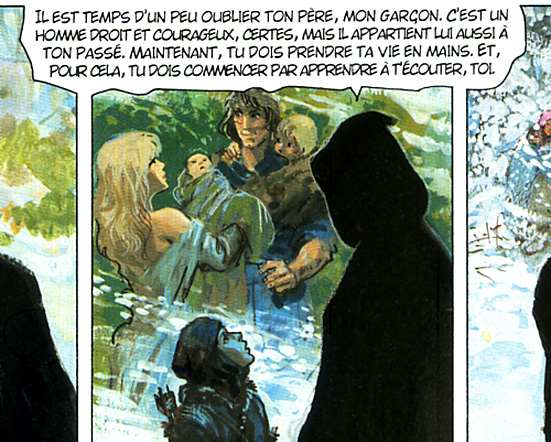


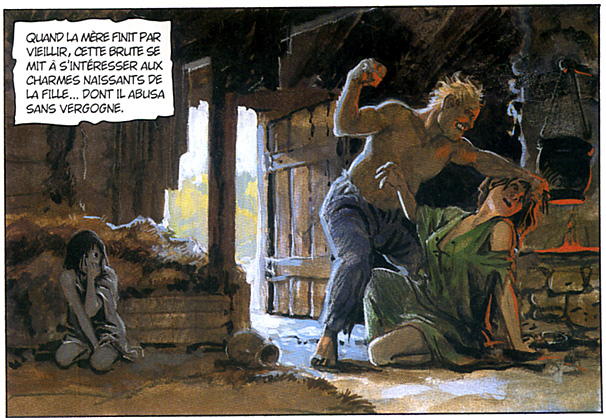


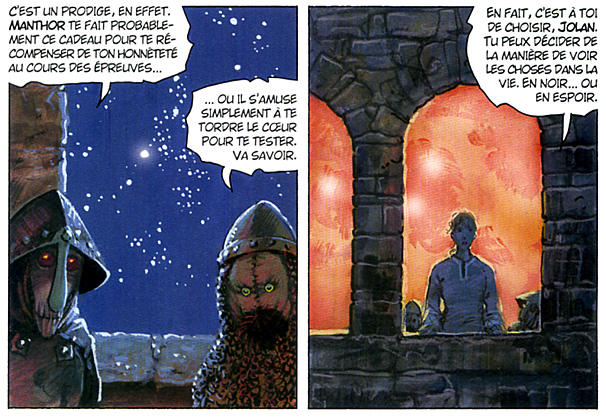



































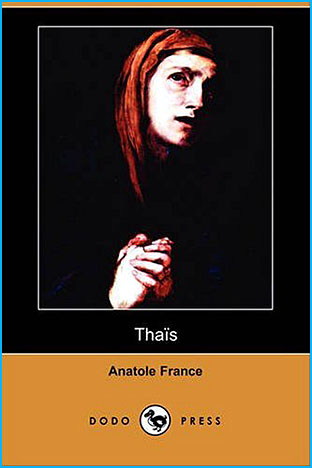

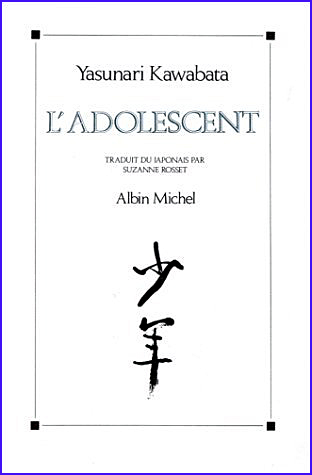














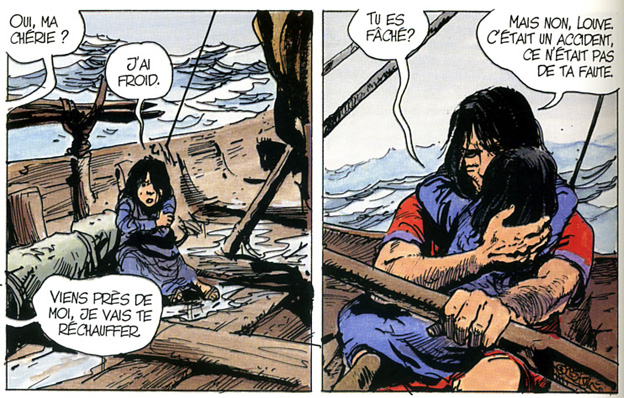

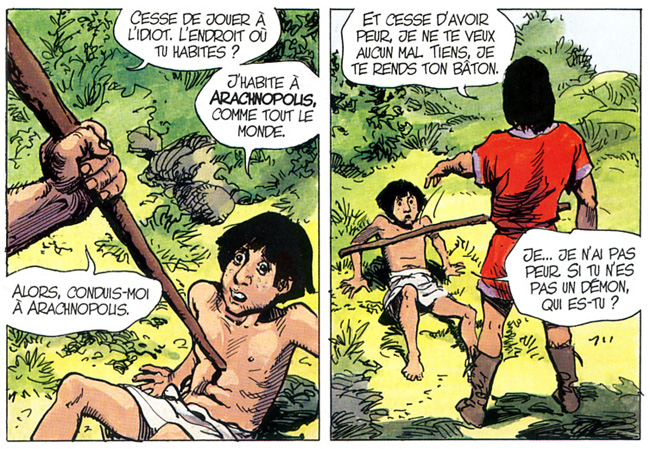







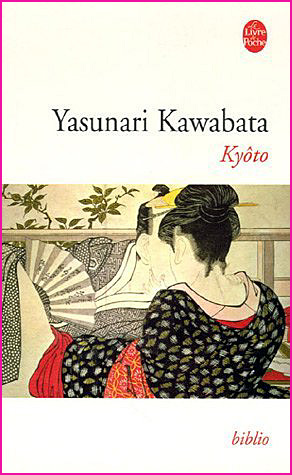





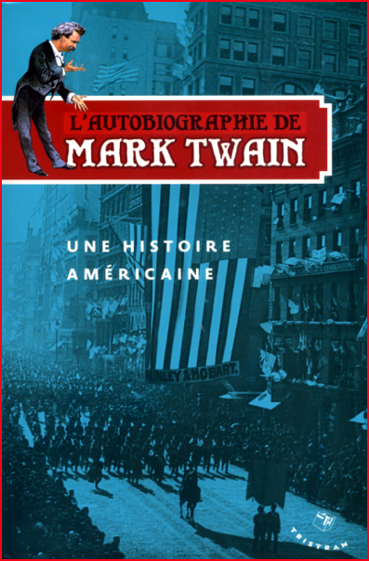


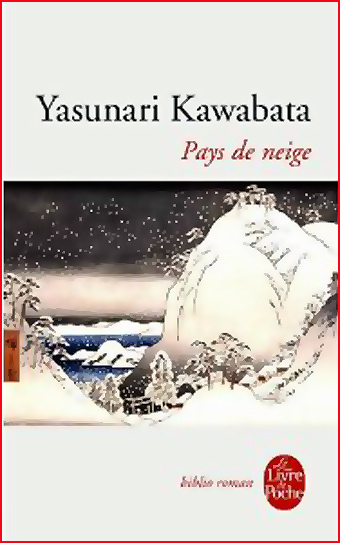


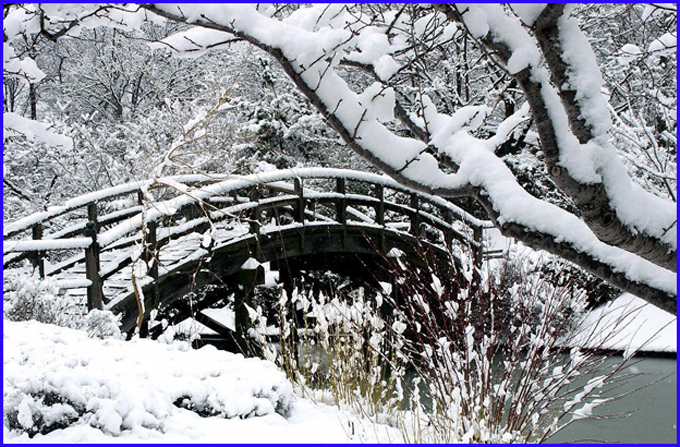

















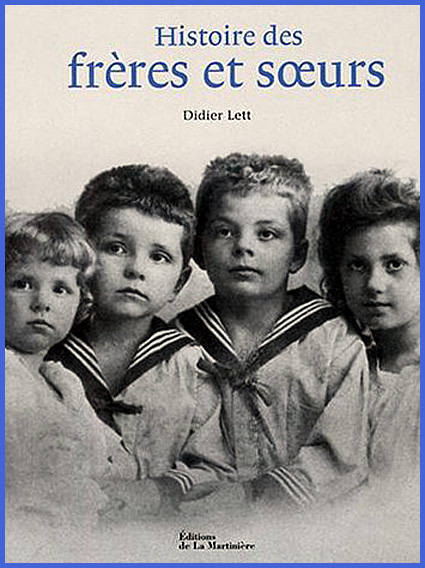
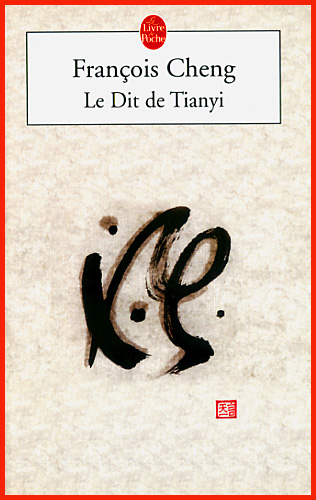
Commentaires récents