Ce volume d’essais littéraires est écrit au fil des réflexions nées de la lecture. La langue est choisie, le style aisé, les phrases longues respirent et créent un rythme ; le ton est de sagesse et d’harmonie. L’écrivain porte attention à la phonie, ce chant des lettres. Une pensée primesautière fait son miel ici du suc amassé en d’innombrables livres. La réflexion sereine d’un mental bien huilé me baigne de bonheur. Je prends un plaisir aigu à savourer les remarques ciselées – non dans le marbre, qui serait trop pur et trop froid – mais dans un bois dur et vivant comme le chêne. Ces courts textes (guère plus d’une page) ont la densité et le poli d’un meuble rustique. Ils ont ce grain du bois et cette couleur douce à l’œil des choses longuement caressées.
C’est à l’intimité de la littérature française du 19ème siècle que nous convie ici Julien Gracq. Il n’écrit pas pour l’éternité, il accompagne en sourdine les œuvres majeures qu’il a aimées. Son discours est une présence familière, on revient à son livre pour l’ouvrir au hasard ou pour rechercher le trait qui nous a marqué. Ses auteurs de prédilection sont Stendhal, Balzac et Flaubert surtout ; mais aussi Proust, Nerval, Baudelaire et Rimbaud.
Le favori reste Stendhal ; il est aussi parmi les miens. « Si je pousse la porte d’un livre de Beyle, j’entre en stendhalie », dit-il p.28. Son univers emporte hors de la réalité, il se situe à part, dans un certain merveilleux. Il est presque surréel : l’époque et le pays décrits dans un roman stendhalien apparaissent comme transfigurés par le rêve d’un univers éthique très personnel. « La seule morale sociale qu’on peut tirer de ses livres est que les BUTS ne servent à rien, si ce n’est à communiquer à une vie le mouvement au cours duquel le bonheur a une chance de se présenter à la traverse, et c’est la morale d’une classe ‘arrivée’, celle des nobles de cour, amis du plaisir, spirituels et désabusés des salons du XVIIIe siècle » p.25. C’est aussi le meilleur de l’esprit français que cette sociabilité du plaisir et de l’intelligence, de la conversation et du mot d’esprit. L’Italie de Stendhal est un mythe : c’est un pays proche où se tiennent encore, en plein XIXe siècle, des cours princières, que la Révolution à détruites en France. La Chartreuse de Parme est ce monde imaginaire du Stendhal intime : « La séduction de ce roman concertant, au fil des pages, grandit par la vertu d’un microclimat tellement épanouissant et tonique qu’il rend toutes les figures qui le peuplent tendrement parentes, ainsi que toutes les plantes, au printemps, sont moins différentes des autres que le reste de l’année » p.53. La morale aristocratique est déployée dans un univers rêvé – et voilà que la langue de l’écrivain prête sa voix à l’ensemble : « Cette prose n’est jamais une prose parlée ; elle n’a rien du vocabulaire et des tournures de la conversation familière, de l’entretien qui va à l’aventure. Mais elle en a presque constamment le dé-lié, la désinvolture, la liberté de non-enchaînement quasi-totale. Aucune prose où la phrase qui s’achève laisse moins prévoir la figure, le rythme, et même le ton de celle qui va suivre » p.36. Cette vivacité, ce sens de l’impromptu, est l’expression même du caractère aristocratique que tout concourt à mettre en scène. Ainsi cet air de vérité des créations de l’écrivain : « Ce qu’il y a peut-être de plus vrai dans la psychologie stendhalienne (…) ce sont les montées, les chutes de tension brutales et parfois instantanées qui affectent les sentiments de ses personnages, dont le voltage ne cesse de changer » p.66.
Chez Balzac, au contraire, le personnage ne nait pas de sa propre énergie intérieure, mais du décor qui l’entoure : « La singularité balzacienne essentielle (…) est un enserrement, et presque un enfouissement de chaque personnage dans le réseau hyperbolique de relations matérielles où il se trouve » p.22. Ce qui fait le style particulier de ses livres : « ses façons de table d’hôte, l’épaisseur si particulière, presque gluante, de sa coulée verbale qui s’étale nourrissante et poisseuse comme une confiture (si différente de la sécheresse aérée de Stendhal, qui claque ainsi que le linge dans un courant d’air) » p.73. Le décor prend toute son importance. Les objets, l’architecture, les relations, prennent l’individu dans un réseau comme l’araignée dans sa toile. Le personnage est l’apparence. Le génie vient quand une forte passion a su créer la toile (Grandet, Claës ou Goriot). Le décor qui emmaillote pour protéger est alors prolongement, extension de soi. L’homme dans son intérieur, l’homme social, est la réussite de Balzac : « Le bric-à-brac des intérieurs, si excessif, si envahissant qu’il soit par endroits, semble toujours avoir été soumis à une longue et tiède cohabitation casanière qui l’organise et nous le rend plausible : c’est le sentiment puissant de la tanière humaine qui émerge de ce fourre-tout » p.85.
Quant à Flaubert, il est l’architecte d’une passion. Madame Bovary : « une vie tout entière remémorée, sans départ réel, sans problématique aucune, sans la plus faible palpitation d’avenir » p.18. Flaubert est une abeille sceptique. Il ne sait pas inventer ; il ne crée aucun avenir ; il cisèle minutieusement un ‘cas’ qui est lui-même, illuminé. Avec lui, le roman classique s’enlise – mais projette ses ultimes feux. « Ce qui m’a frappé, ce n’est pas le ratage misérable des amours et des fantasmes d’Emma, sur lequel Flaubert s’appesantit, c’est l’intensité de flamme vive qui plante son héroïne, au milieu du sommeil épais d’un trou de Normandie, comme une torche allumée » p.82.
Proust renouvellera l’œuvre romancée. Il en fera un inventaire remémoré, une création nouvelle de l’esprit, une existence tout entière contée. « Dans Proust, la prolifération compacte de l’explicite réduit l’implicite abandonné au lecteur à la portion congrue (…) On ne rêve guère à partir de Proust, on s’en repaît : c’est une nourriture beaucoup plus qu’un apéritif » p.104. L’écrivain plonge dans son passé sans nostalgie, mais comme un chasseur ; il traque et extirpe les souvenirs avec violence. Gracq parle de « cet impérialisme tendu de Proust qui n’a de cesse qu’il n’ait remis une main fiévreuse sur les trésors dissipés » p.106.
Voilà pour le roman. Glanons encore quelques pensées sur la poésie. Comme celle-ci : « Les trois-quarts du plus beau de la poésie française ont été écrit de 1845 à 1885 » p.183. Ce n’est pas faux – reste à trouver pourquoi. Un siècle fermé socialement, en industrialisation progressive, aux valeurs puritaines, à l’urbanisation croissante, susciterait-il la poésie ? Ou bien est-ce le progrès de l’enseignement, le règne de l’écrit (juridique et littéraire) ? Il reste que le plus grand poète de la langue est peut-être bien Baudelaire : « Aucun vers n’est aussi LOURD que le vers de Baudelaire, lourd de cette pesanteur spécifique du fruit mûr sur le point de se détacher de la branche qu’il fait plier » p.155.
Et puis cette attention à la phonie encore, qui fait la typologie personnelle de Julien Gracq : « Il y a deux types de voix dans la poésie française : celle qui tend au staccato riche en R, en consonnes fricatives et dentales, de la profération triomphante » – exemples : Hugo, Mallarmé, Claudel, parfois Rimbaud – « et celle dont tout l’insigne pouvoir consiste à filer sans la rompre et à boucler l’arabesque d’une cantilène magique » – Lamartine, Nerval, Verlaine, Apollinaire, p.180.
J’ai retenu encore ce qu’il écrit de Saint-John Perse, mon grand poète des Vents : « Le monde qu’il célèbre est un monde arrêté, un monde bloqué pour toujours à l’heure de son solstice » p.199. Son discours : « c’est le déferlement théâtral du ressac sur une plage, une rumeur grandiose qui ne désigne et n’annonce que sa propre réitération » p.200. C’est le ton d’une certaine grandeur, la métaphore de l’action, des météores, voire du cosmos, c’est le chant de la terre à l’heure du monde fini et à l’aube de l’espace. C’est la beauté exclamative de la langue ; c’est aussi – un peu – une prière.
Les remarques de Julien Gracq sont celles d’un amoureux des livres, de cette espèce rare pour qui une œuvre n’est pas une perle à ranger dans un écrin, mais un couteau à tout faire ou une étoile pour la randonnée. L’œuvre stimule la réflexion et ne la bloque pas sur elle-même. Elle est prétexte à exister plus richement ; elle est ouverture à une autre vision du monde. « La lecture d’un roman (s’il en vaut la peine) n’est pas réanimation ou sublimation d’une expérience déjà plus ou moins vécue par le lecteur : elle EST une expérience, directe et inédite, au même titre qu’une rencontre, un voyage, une maladie ou un amour – mais, à leur différence, une expérience non utilisable » p.61.
Faites donc, avec lui, cette expérience inouïe.
Julien Gracq, En lisant, en écrivant, 1980, éditions José Corti, 302 pages, €20.00
Julien Gracq, Œuvres complètes tome 2, Gallimard Pléiade 1995, 1756 pages, €70.00





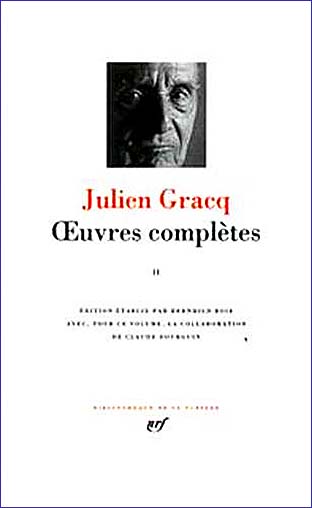




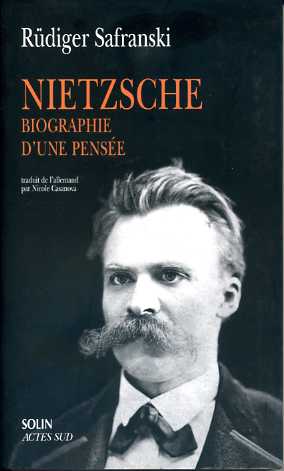

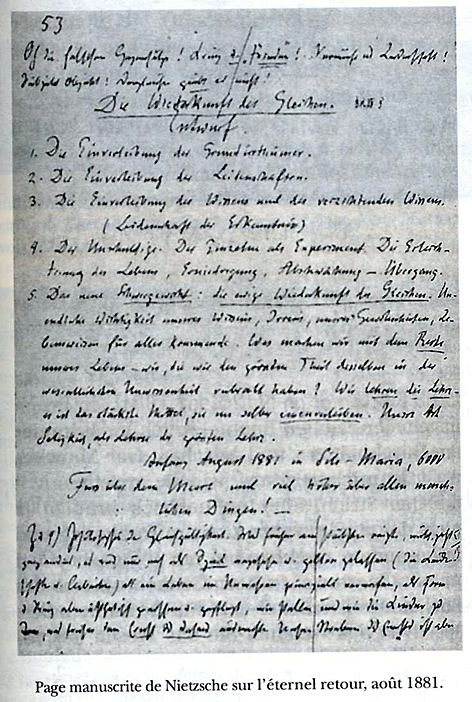











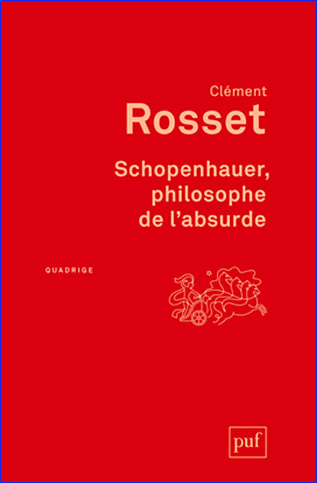
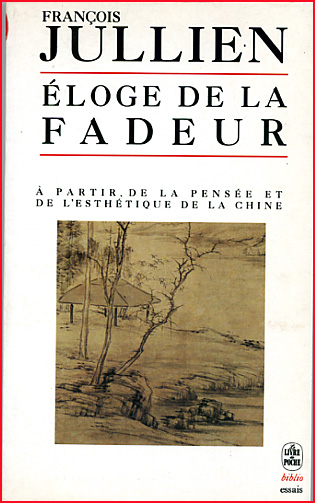
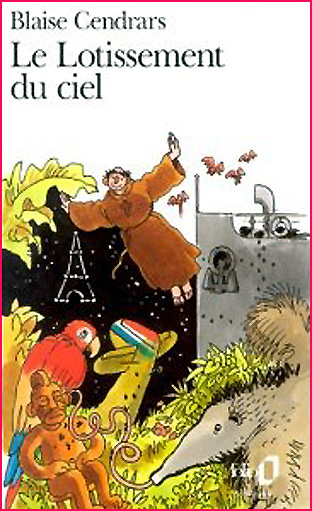
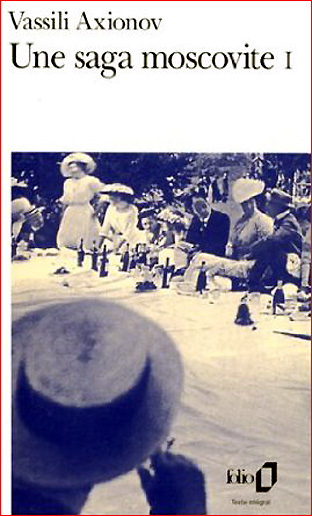














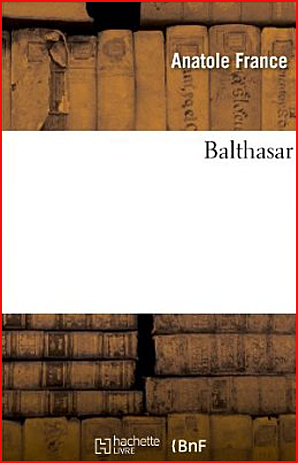

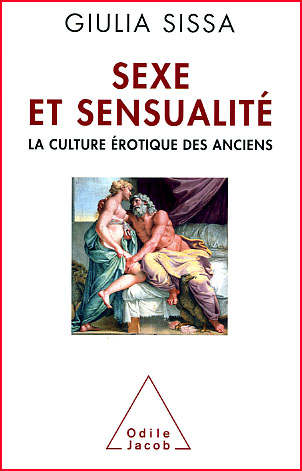





















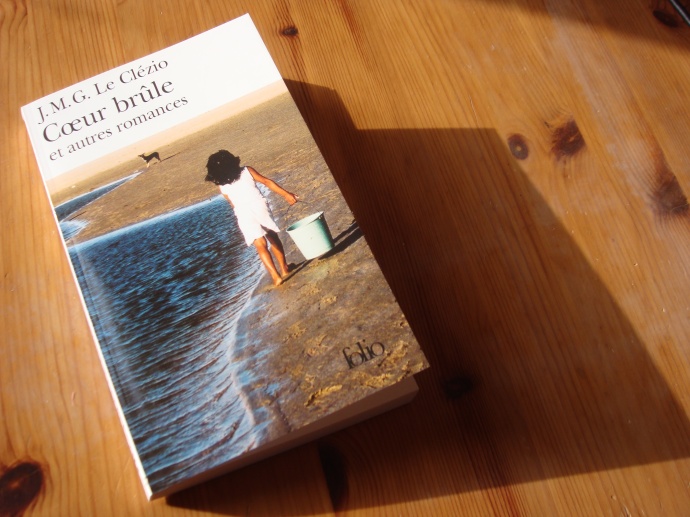
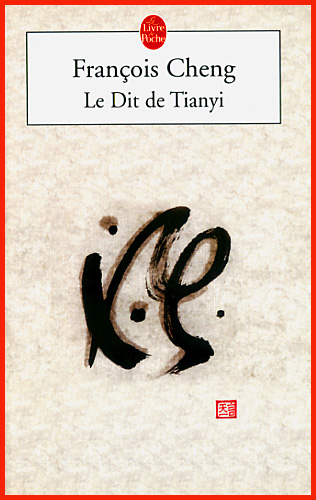
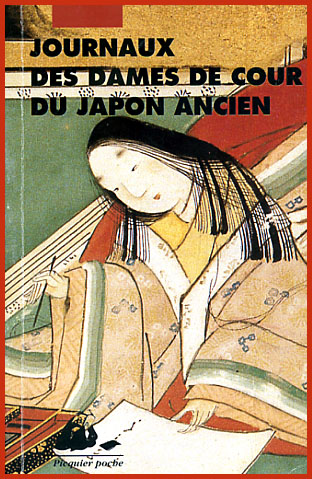

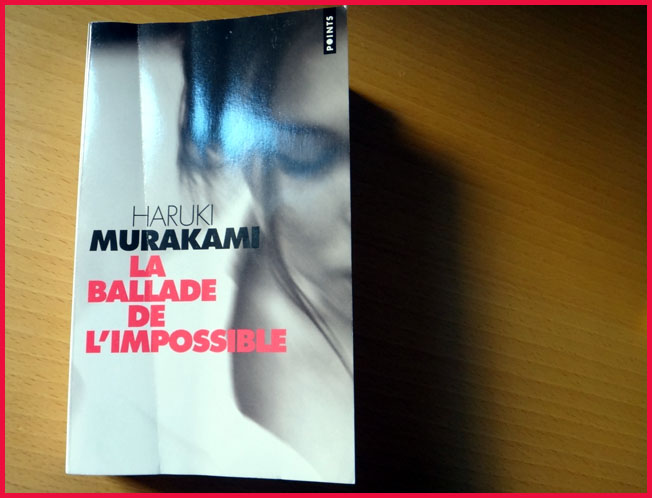

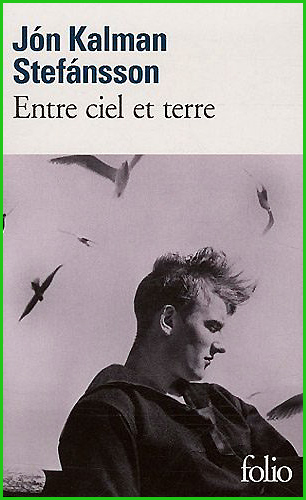




Commentaires récents