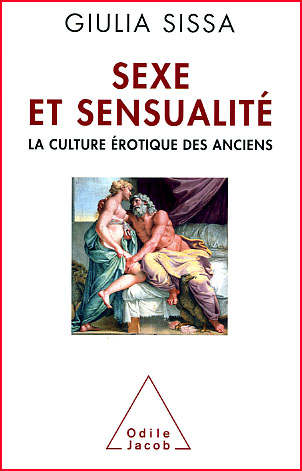
Un titre séduisant pour un vaste programme qui parcourt un millénaire d’amours antiques. Ce qui est intéressant est que Giulia Sissa, tête chercheuse au CNRS soit aussi professeur de théorie politique et de civilisations de l’Antiquité à UCLA (University of California Los Angeles). Sans entrer dans la querelle de dictionnaire pour savoir qui est homo ou hétéro, sans entrer dans les chapelles de genre pour définir homme ou femme, elle revisite les discours « depuis la médecine jusqu’à la philosophie, la rhétorique, le théâtre, la poésie ou le roman » p.273 – et le droit comme les institutions.
Elle n’hésite pas à critiquer les hypothèses hasardeuses de Michel Foucault et son « discours anesthésique », en se fondant sur les textes. Il s’agit du penser, parler et vivre des Grecs et des Romains et les interrogations sont cinq : « il y a deux sexes et deux genres ; les corps sont sexués, les corps sont exemplaires ; le désir, par sa nature insatiable, est ce qui met la pensée éthique au défi ; le désir désire le désir de l’autre. C’est le jeu de la séduction qui aboutit au plaisir des sens ; c’est l’échec de la réciprocité qui fait l’amour tragique » p.275.

Nous sommes avant la haine du corps terrestre, hérité de saint Paul (1ère Épitre aux Corinthiens). Dans la cité antique, les corps sexués s’affichent partout, fièrement, corps féminins et masculins nus, rappel constant de la différence des sexes et de leur complémentarité. Car ni les Grecs ni les Romains ne sont « tous pédés », comme la vulgate voudrait le croire. Ils sont indifférents à ce genre de distinction mais emplis de la sensualité des corps dans leur vénusté. « Seins ronds, ventres légèrement bombés, gestes langoureux ou pudiques d’une part ; muscles définis, maintien fier et allure martiale, de l’autre » p.281. La nudité chante le corps joyeux, la virilité et la féminité officiels. L’éducation physique était une façon de souligner l’anatomie en amplifiant le dimorphisme sexuel.

On ne naît pas homme, on le devient : par le climat, l’éducation, l’éveil à la puberté. « Or, parce que la féminité infantile fait partie de la mémoire du corps, ce n’est pas une inversion ni une perversion, mais la prolongation artificielle d’un état qui, par nature, doit évoluer – de même qu’il faut que jeunesse se passe. Ce n’est pas un drame non plus » p.286. Un homme fait est légitime à désirer un éphèbe, il lui faut seulement faire attention, par morale exigeante, à ne pas le déformer et à l’élever au niveau viril exigé de la société. La consommation sexuelle n’est admise que pour les esclaves, pas pour les futurs citoyens.
Se donner aux autres hommes peut être faute politique, tolérée si elle reste discrète, mais refusée si l’efféminé prétend aux charges de la cité. Le discours d’Eschine contre Timarque est un exemple ici largement analysé. Si les aristocrates sont réputés vertueux par naissance et éducation, les démocrates ne sont jugés adultes responsables que par le regard de tous. Actes et mœurs sont les seuls critères pour leur faire confiance dans les affaires publiques. Platon contre Eschine, Le Banquet vs Contre Timarque, la convivialité cultivée contre l’agora des travailleurs pères de famille – c’est tout l’écart des mœurs entre l’aristocratie de l’esprit et de la fortune (portés aux jeunes garçons) et les Athéniens ordinaires (plutôt hétéros conservateurs).

« Dans une relation pédérastique de qualité (…) l’homme qui, du fait de son âge et de son expérience, prend l’initiative d’une liaison doit vouloir du bien à son partenaire, et lui faire du bien. L’intérêt érotique pour une jeune personne, et non pas pour une chair fraîche, doit se prolonger longtemps, ce qui projette l’amour bien au-delà de l’adolescence (…) Se fixer sur des garçons pubescents parce qu’ils sont tendres et duveteux, pour enfin les quitter l’un après l’autre, dès que leur virilité se confirme : voici un comportement ignoble » p.123. Dans la culture populaire d’Athènes, la féminisation du garçon est une obsession et un cauchemar. Car la femme a la luxure gourmande, sans limites.
« Ce que j’espère avoir ajouté », dit l’auteur, « ce sont d’abord les arguments sur la priorité du désir, sur la transformation de la puberté, qui est à la fois transsexuelle et sensuelle, sur le jeu de miroirs entre discours différents, d’éloge ou de blâme, sur l’inexistence d’un rapport à sens unique entre pénétration et pouvoir et, surtout, sur la véritable absurdité de la dichotomie entre actif et passif, alors que les textes célèbrent, ou dénigrent les couples » p.293. Impact de la beauté, contagion du désir, durée dans l’attachement amoureux, c’est tout cela qui mène du mécanique (qui fascine nos contemporains) à la sensualité (réhabilitée des Antiques). « Je définis la sensualité comme tout ce qui exprime l’intensité intentionnelle de l’érotisme ; comme son irradiation esthétique, c’est-à-dire sensible d’un corps à l’autre » p.295. Quel que soit son genre, la sensualité est toujours un peu féminine. D’où la balance entre l’hommage à la virilité et la crainte de la mollesse, qui perd les cités (Sparte) et les empires (Rome).

Mais tout commence par le désir insatiable des femmes : on serait tellement bien, entre hommes, à converser agréablement lors d’un banquet – dit le philosophe – s’il ne fallait assurer enfants, richesses et attentions à l’épouse pour perpétuer la société… « Il y a une Antiquité fluide et femelle, toute à redécouvrir, dans ses accents propres qui n’ont rien à voir avec le pouvoir, indûment surestimé, d’une virilité violeuse et conquérante sur une féminité triste, inerte et chosifiée » p.18.
En Grèce, au commencement était Éros, l’entremetteur des contraires, capricieux et volage comme un petit garçon. Mais il faut distinguer les siècles : au VIIème (avant), dans le monde homérique, le désir est le passé du plaisir (désir-besoin, plaisir-soulagement) ; au Vème siècle des tragédies, l’amour est chimérique et désespéré d’absence, d’indifférence ou d’infidélité de l’être aimé ; au IVème siècle, chez les philosophes, le désir est insatiable, le plaisir dérisoire, mais le marchepied pour l’élévation de l’âme (et du disciple).
Rome est née de Vénus qui a fécondé Anchise, Romulus et Rémus sont nés d’une esclave qui s’est enfilée seule sur un phallus dressé dans l’âtre du roi Alba. Les rustres Romains ont dû enlever des Sabines pour les violer et assurer leur descendance. Tout l’art érotique de Rome sera de civiliser ces soldats-laboureurs. Ovide invente donc l’Art d’aimer, où toutes les femmes ne demandent qu’à être séduites, mais où l’homme doit ruser, amadouer, faire le siège avant de pousser la capitulation. C’est le jeu du désir, l’exacerbation de la sensualité plutôt que le sexe brut. Magnifier la femme (ou l’éphèbe) est mensonge, mais les deux finissent par y croire un peu. Magie de l’amour qui transfigure. Mais attention à la mollesse, elle prépare la décadence.
« Le phallus est une obsession romaine » p.250. L’idéal masculin est une fermeté du corps entier, érigé comme le pénis, image du caractère droit et de l’austérité ferme. A Rome, « il n’y a rien de mal pour un adulte à faire la cour à des garçons, dans la mesure où ces actes accomplis sur ces membres encore proches du féminin – et sexuellement malléables – n’en compromettent pas le développement naturel et la future masculinité » p.253. Dès 12 ans le garçon découvre les premières pulsions érotiques et commence à désirer ; il séduit et les poèmes de Catulle le célèbrent. Mais si le désir est spontané, l’amour s’apprend, y compris entre sexes opposés, c’est tout le message du roman Daphnis et Chloé.
Nous avons gardé du latin cette obsession de la virilité affichée, si nette dans les banlieues ou dans les engueulades entre automobilistes. Les Grecs étaient moins machos, autrement plus subtils. Les figures complexes d’Ulysse et Pénélope, d’Achille et Patrocle, d’Agamemnon-Iphigénie-Clytemnestre, d’Antigone, d’Agathon et de Phèdre nous parlent toujours.
Un beau livre fort instructif, facile à lire, d’une écriture un peu bavarde, mais disons lyrique et sensuelle, qui renouvelle le sujet avec érudition.
Giulia Sissa, Sexe et sensualité – la culture érotique des anciens, 2011, Odile Jacob, 329 pages, €23.99

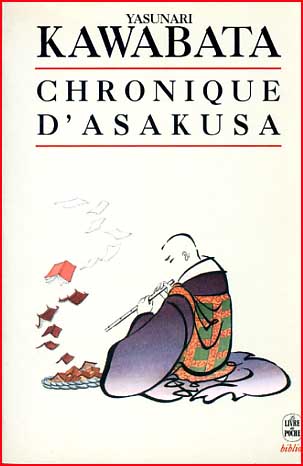

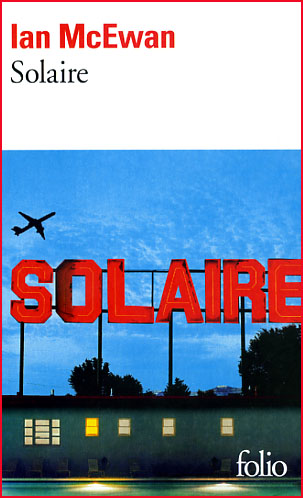

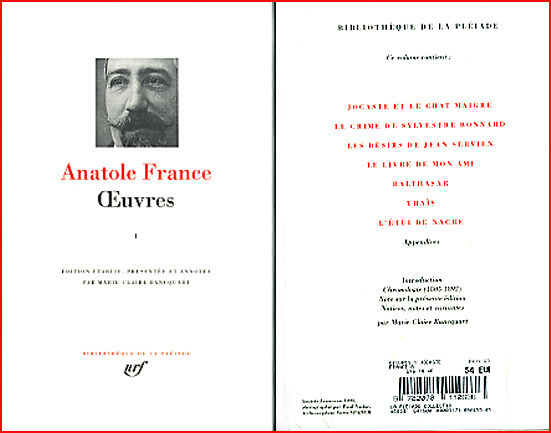


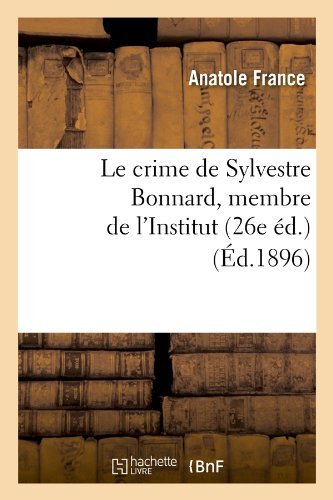
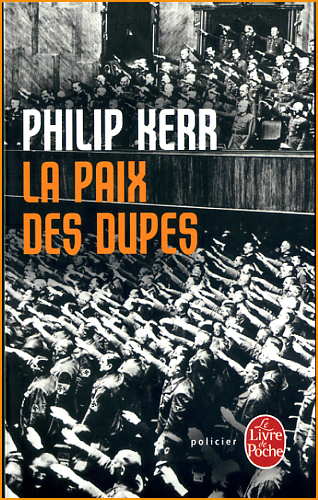

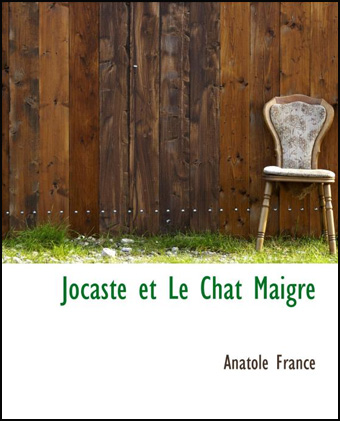
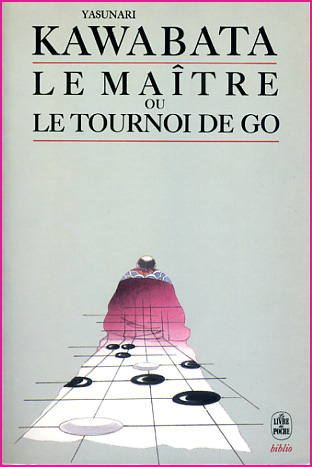




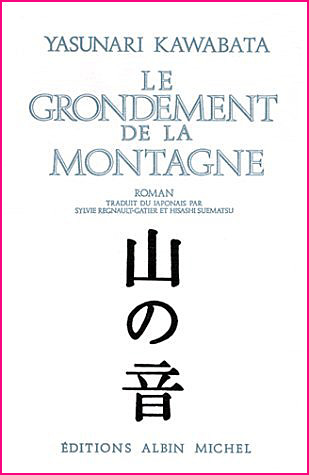



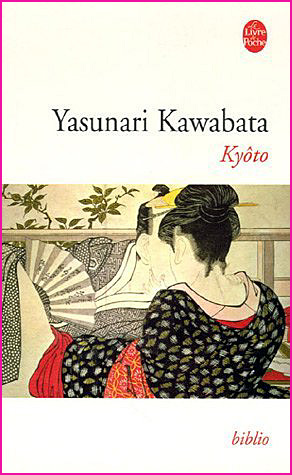





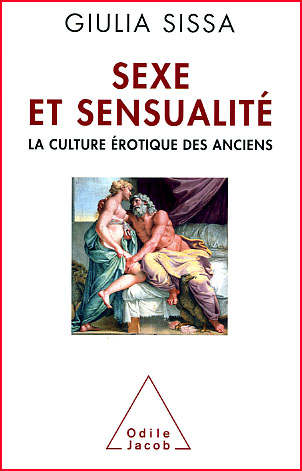









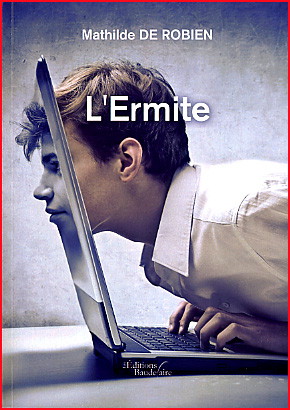


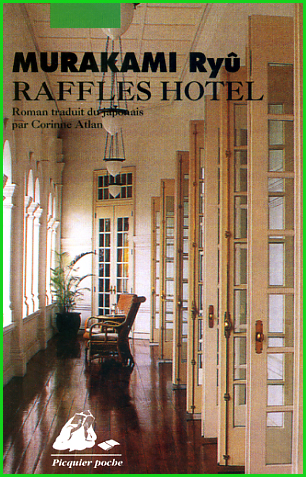
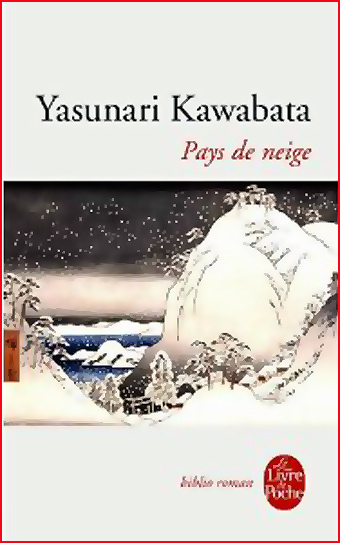


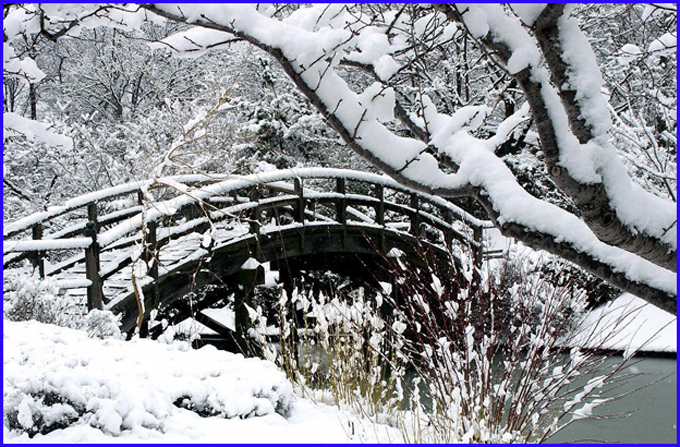


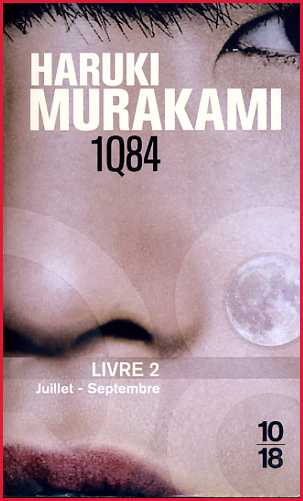

Commentaires récents