Il y a 50 ans, dans l’indifférence générale toute acquise à la morale sartrienne et à l’engagement à gauche pour les pires dictatures du siècle, paraissait un petit ouvrage sur l’autre versant de la philosophie : non pas celui de l’Être ni de la Morale, mais celui des phénomènes et du tragique. Sartre est aujourd’hui un cuistre oublié (et dire que j’ai cru un temps à son sophisme de « liberté » !) ; Rosset revit, éminemment actuel et d’une langue limpide.
« Notre principal dessein ici sera de comprendre en profondeur le ressort caché des différentes démarches morales, en dégageant ce qui nous en paraît le fondement le plus éclairant: l’incapacité où elles sont, même sur le plan purement intellectuel, de réussir à penser le donné » (Avant-propos). Démystifier moralisme et romantisme, ces plaies de toute croyance, y compris laïque, surtout en France et particulièrement à gauche. Le « donné » est ce qui est, les événements échappant à toute raison, à toute causalité. Le monde est la totalité des faits, non des choses, avait coutume de dire Wittgenstein, philosophe logicien. Les faits sont ce qui survient, au hasard et nécessaire, mais sans raison et sans but.
Deux parties dans cette démonstration : la tragédie du réel et la tentation morale. Dans cette dernière, la plus importante, l’angoisse du monde muet à laquelle répond l’interprétation morale, puis les philtres d’oubli que sont la liberté, la sincérité objective, le désapprentissage du réel, le divertissement (au sens de Pascal) et le sacrilège (de mettre en cause cette illusion morale). Suit une brève note sur le romantisme, dans laquelle il est montré combien le temps qui fuit, la brume floue des paysages et le chatoiement des passions engendrent une angoisse du temps, appelant les mondes clos de fixité que sont l’enfance, la thébaïde, l’île déserte, la forêt antique et ainsi de suite.
Le réel est – la réalité sans cause est tragique. « Ce qui condamne la liberté humaine n’est pas une nécessité qui viendrait nous contraindre suivant un schéma déterministe, à la façon dont s’enchaînent les phénomènes naturels (…) mais la seule nécessité de ce qui est, de ce que nous sommes, de cette existence antérieure à toute causalité et tout déterminisme » p.19. Clément Rosset va dans la littérature, cet inépuisable réservoir de caractères humains, pour démontrer ce donné sans illusion : Phèdre, Pons, Bardamu, Scapin, Tartuffe, Orgon, Hamlet.
La passion, chez Phèdre, est « la tragédie de l’enchaînement et du destin aveugle » qui « nous renvoie directement à l’intuition du donné sans raisons et, par là-même, à l’intuition générale de l’être » p.28. Chez Balzac, « si Mme Cibot est méchante, c’est seulement pour Pons, lequel Pons est un ingrat, du point de vue de Mme Cibot (…) Il n’y a pas de méchanceté qui tienne, ni aucune ‘qualité’, ni aucun défaut. Toute représentation ‘morale’ est ainsi ruinée : le monde est trop grand, le dynamisme illogique des passions humaines emporte tout. Le point de vue moral est passion lui-même : il revient en somme à porter à l’absolu une vision particulière (…) Il est la croyance en un point de repère fixe » p.32.
Les moralistes veulent reconstruire le monde à leur gré, en voilant de pudique illusion ce qui a produit réellement la crise. « Une ville est-elle rasée par un bombardement, l’homme moral en dénonce l’injustice » p.42. Sans se poser la question des faits : où ? quand ? comment ? pourquoi ? que peut-on faire concrètement ? « S’il est une vertu réelle, ce serait le courage propre à la lucidité. Encore ce courage n’est-il pas une vertu morale, mais bien plutôt une sorte de ‘grâce’, puisqu’il participe lui aussi du donné déjà, étant un fait de caractère sur lequel il serait vain d’épiloguer » p.43.
La morale est une démission face à la réalité et un refus du principe même d’existence au profit d’un monde d’illusion, confortable et sectaire, mais faux. « Le sentiment moral originaire est une angoisse devant le donné » p.50. Le silence du monde réclame d’urgence la glose pour « expliquer » l’inexplicable. Le moraliste ne peut simplement observer, laisser être les faits ; il lui faut en donner le sens, en trouver les causes, les relier à une grande construction de l’univers et du destin. « Nul doute que soit bien caractéristique de l’attitude morale cette étrange faculté à s’indigner, cette aptitude à être scandalisé, cette sorte de refus normatif en présence de tel événement ou de telle situation » p.56. Ce que l’on ne voudrait pas, on le refuse, comme si l’insignifiant individu avait pleins pouvoirs sur le monde et ses lois physiques. « Il est très caractéristique du sentiment de scandale que l’action scandaleuse soit comme une injure personnelle faite à ceux qui s’indignent » p.57. Ils n’ont pas encore admis que des événements soient.
D’où « cette étrange démarche, caractéristique de la morale, je veux dire ce droit qu’elle s’attribue en vertu duquel elle s’estime fondée à nier n’importe quoi, quelles que soient sa réalité et son existence, dès le moment que cette réalité ne lui ‘satisfait’ pas l’esprit » p.62. La perception morale de l’être humain considère non pas l’être qu’il est mais l’obscur ‘projet’ qui lui donnerait un sens (fils de Dieu, membre du peuple élu, vecteur de l’Histoire, hériter de la Résistance, sauveur de l’humanité…). Nietzsche, cité par Rosset : « faire du fait un effet, et de cet effet un être ». L’indignez-vous récent en est l’illustration.
« De ce souci de tout ‘signifier’ procède cette habitude qui consiste à ramener systématiquement les êtres et les idées qui vous échappent à des catégories connues » p.64 : salauds pour Sartre, étiquette de droite pour les socialistes bobos, sionistes pour les gauchistes victimaires. « Tout ce qui sort du schéma tant intellectuel que moral dans le cadre duquel ils ‘comprennent’ (…) l’existence est nul, non avenu, de mauvaise foi, inspiré par des intérêts économiques, égoïstes ou subversifs » p.69. Ainsi Tartuffe ramène-t-il toutes les interrogations à la gloire de Dieu. Après Marx, Nietzsche et Freud, comment peut-on croire aux grands sentiments ? La sublimation, le transfert, la bonne conscience font des dupes. « Tartuffe est comme un sosie qui hante toutes les ‘bonnes consciences’ » p.75, les vertueux, les indignés démagogues. « L’important n’étant pas que les scandales cessent, mais que les bons sentiments demeurent » p.141.
L’oubli du vrai trop blessant est le ressort de toutes les croyances. « Cette révolte première devant le donné est donc un instinct commun à toutes les formes de moralisme, que ce soit celui de Caton, de Cicéron, du christianisme, du libéralisme, de l’existentialisme, le d’Islam ou de Bouddha – si nous en oublions pardonnez-nous » p.90. La morale est de mettre un rempart de mots et de concepts entre la pensée et le réel, refus de voir les gens tout nu et les faits tels qu’ils sont, d’accepter la situation pour faire avec.
Ainsi la liberté : « il s’agit, coûte que coûte, de maintenir la distance entre le soi et le donné » p.96. Malgré le flou des diverses conceptions de la liberté, il s’agit d’un « besoin affectif », toujours « compromis entre ce qui est et ce qu’on voudrait voir être » p.96. D’où « le verbalisme frivole » d’un Sartre par exemple, qui n’hésite pas à jargonner pour enfumer le lecteur qu’il est nécessaire « d’être l’être qui est comme être dont l’être est en question dans son être » (L’Être et le néant p.642, cité p.99).
Ainsi la sincérité, l’équité, l’objectivité, mythes qui coïncident « le plus souvent avec une complaisance inconsciente pour la veulerie et le mensonge » p.102. Exemple ce prof qui remonte les notes des cancres et rabaisse celles des bons par souci de « justice » ! Il s’agit de se laver de la faute originelle de juger et, surtout, de refuser la moindre responsabilité dans l’inégalité des candidats. « Cette démission intervient sur un double plan : refus d’assumer, d’une part, les inévitables risques d’erreur propres à tous les examens, lesquels sont injustes par définition et par nécessité – refus d’assumer, d’autre part, les différences de savoir entre des candidats qui du point de vue moral sont tous égaux » p.104.
Duperie et mensonge qui servent la bonne conscience, pas la « justice » ni même « l’honnêteté » intellectuelle. « Car au fond le souci d’honnêteté ne se traduit pas par un regard lucide sur ce qui est, mais exprime tout au contraire une certaine manière de regarder qui finit par devenir indifférente à ce qu’elle voit » p.104. L’égalité est artificielle, assurée par le regard non pas neutre ni objectif, mais indifférencié. « Puisqu’on ne pouvait faire que les choses qu’on voit soient identiques, on a mis au point une certaine manière identique de voir les choses » p.104. L’idée juste de relativité s’égare dans le dogme de l’équivalence : tout vaut tout (et réciproquement).
Ainsi est-il enjoint par les moralistes de désapprendre le réel : « Face à une réalité quelconque [l’attitude morale] cherchera toujours on ne sait quel droit, quel mérite, quelle responsabilité, au lieu de s’en remettre au fait lui-même, et d’en répondre » p.116. Désapprendre le réel est avant tout désapprendre la souffrance : au lieu d’apprendre à encaisser les coups durs, « la morale enseigne à les renvoyer à un expéditeur » p.129 : bouc émissaire, démon ou même sa propre culpabilité. Tout malheur veut une cause et Rousseau en est la pitoyable caricature (p.131). Rousseau qui a inspiré bien plus que Montesquieu ou Diderot notre Révolution française, la tirant du côté de l’envie, du complot et de la fusionnelle volonté générale (traduite par quelques-uns et exécutée par un nombre encore plus restreint) – pour notre malheur politique.
« Résumons le mécanisme de l’appréhension du réel pour l’homme moral : pour commencer, il rejette l’être en bloc, puis refabrique un monde ordonné selon ses vues, entièrement privé de contacts avec la réalité, mais peu lui importe ; car c’est là qu’il entend vivre, là et non ailleurs » p.120. Que l’on pense aux sectes islamistes ou au parti socialiste, il s’agit toujours de nier le vrai monde au profit d’un monde repeint de moralisme, où tout est jugé selon les valeurs de la secte qui veut imposer aux autres ses fantasmes comme ses névroses. « Au fond, dit Clément Rosset, je leur reproche avant tout d’ignorer, sous couleurs de préoccupations morales, la responsabilité la plus difficile mais aussi la plus indispensable, savoir la prise en charge de ce qui est et de ce qu’on est » 135.
Un grand petit livre. A lire parce qu’inactuel – donc en plein dans notre actualité !
Clément Rosset, Le monde et ses remèdes, 1964, PUF, 169 pages, réédition 2000, €15.50

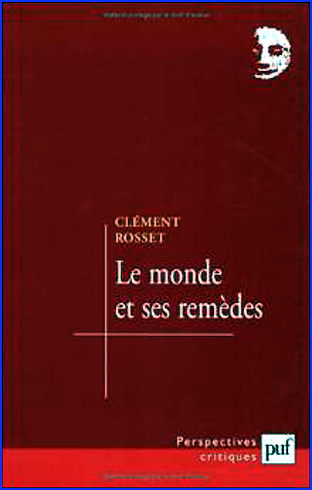
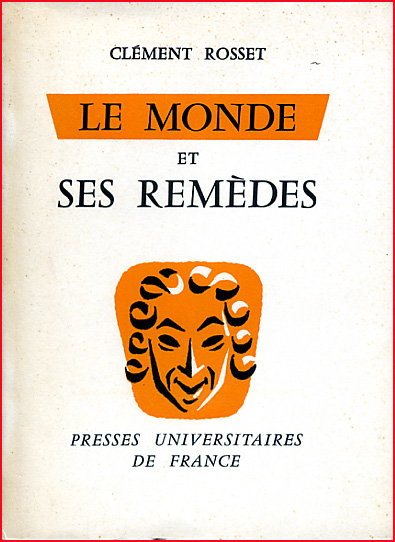




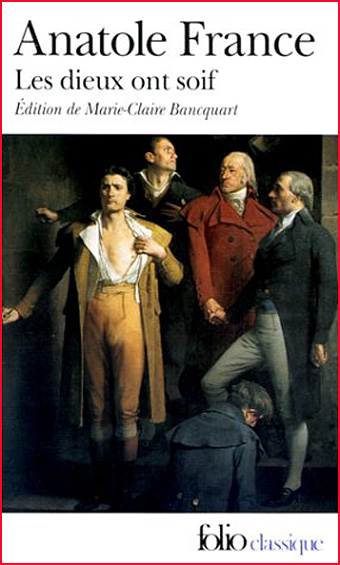


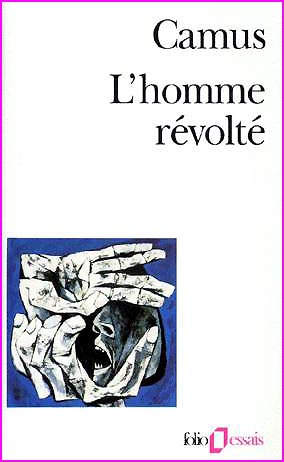

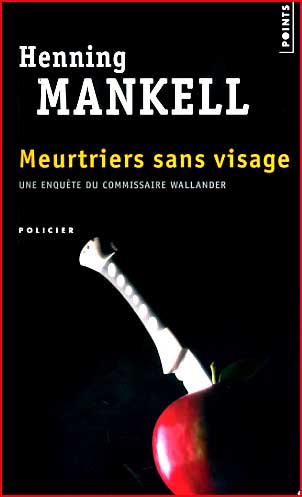



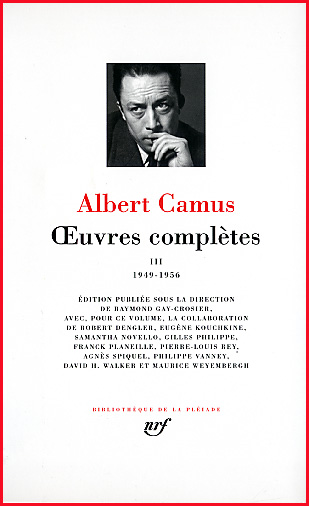
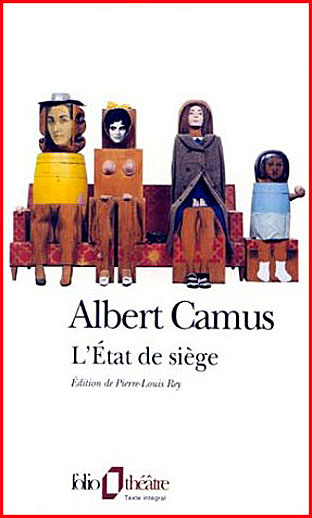












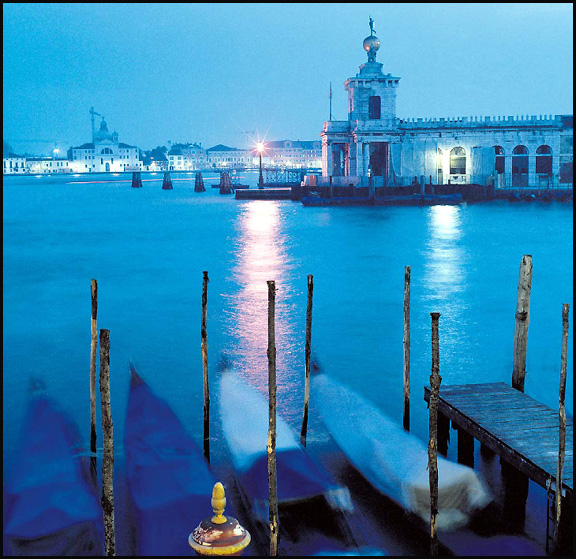




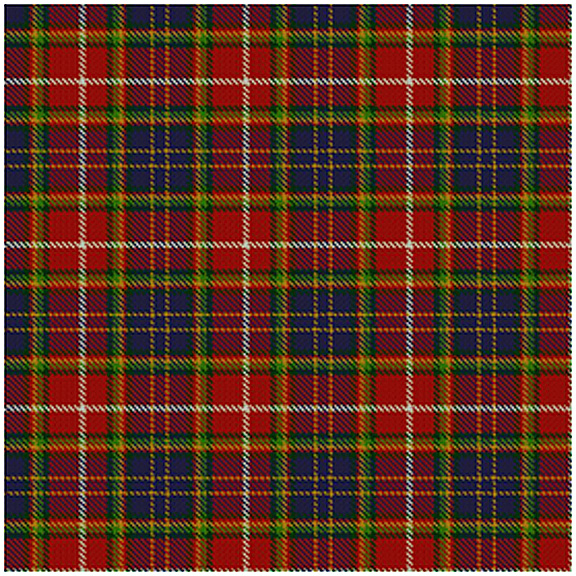













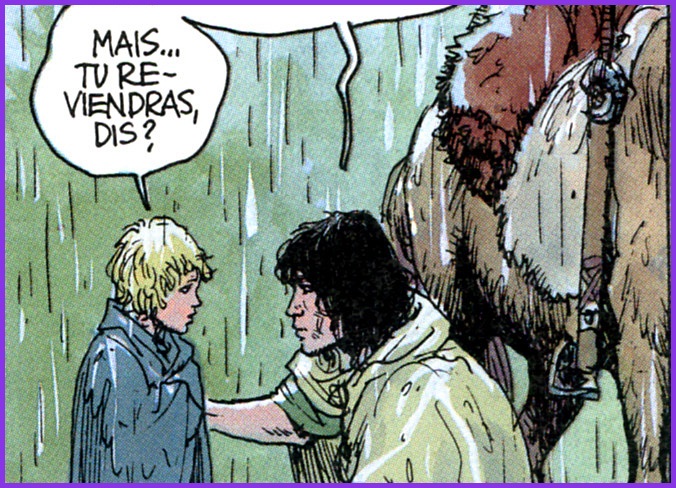







Commentaires récents