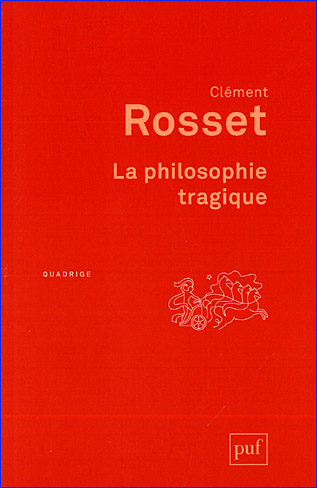
Le tragique est un sentiment de joie philosophique, venu de l’être même, qui bannit le pessimisme comme le moralisme. Il est probablement ce « vouloir-vivre » de l’Occident qui a permis l’essor du savoir et de l’économie, en même temps que les conquêtes et les explorations. Ce qui a eu pour conséquences l’exigence de la liberté de penser avec celle d’entreprendre, et la participation démocratique progressive, de puis l’Habeas corpus anglais jusqu’aux Révolutions française et américaine. « Rien de plus noble et de plus élevé en l’homme que son attitude critique qui le porte à déchirer impitoyablement toutes les croyances qui pourraient compromettre sa lucidité intellectuelle, mais auxquelles il se sent lié par un pressant besoin affectif : cette attitude – qui suppose une dureté envers soi-même – est proprement la ‘purification philosophique’ » (introduction).
L’auteur définit le tragique comme un « soudain refus radical de toute idée d’interprétation » p.7. Il est l’intelligence, cette faculté de l’esprit qui s’oppose à l’imbécilité. Le ‘baculus’ en latin est la canne, sur laquelle s’appuie toujours l’imbécile pour s’éviter de penser et de prendre ses responsabilités. L’imbécile est un boiteux de l’âme.
A l’inverse, l’esprit tragique accepte la surprise radicale, même celle qui fait mal parce qu’elle déstabilise : l’échec de l’affectivité et la solitude fondamentale de tout homme, la découverte de la bassesse inhérente à la nature humaine, l’apprentissage de l’absurde et de la mort. A cela, le tragique ne pourra jamais donner d’interprétation. Il s’agit d’un échec insurmontable, irrémédiable, irréconciliable avec l’univers. L’homme se découvre mortel, seul et nu. Il ne sera jamais Dieu, malgré le « progrès », le « bien », le « mérite ».
Les infantiles préfèrent refuser rageusement ce monde-là et croire aux chimères du « bonheur ». Les virils l’acceptent – tragiquement (viril au sens philosophique inclut les femmes, évidemment, au sens de fortes, fermes, courageuses tout comme les hommes). Il n’y a pas de liberté fondamentale de choix, mais un instinct, une force intérieure ou une faiblesse interne. Rodrigue (le Cid) ne choisit pas entre la grandeur ou l’égoïsme, il préfère la voix la plus longue de son instinct naturel : la générosité.
Le tragique est réaliste, il constate que l’humain n’est libre que relativement, contraint par sa condition de mortel, seul et faible – ni dieu ni ange, mais à moitié bête. Et qu’il faut faire avec. L’individu puise sa force en lui-même pour réaliser son humanité avec les autres, telle est sa gloire et sa joie. Tel est le tempérament que l’on pourrait qualifier « à la française » de droite, bien que ces distinctions apparaissent un tantinet ridicules dès que l’on quitte les frontières étroites du ghetto médiatique parisien. A gauche, pour user des mêmes distinctions poseuses, le tempérament est porté à l’illusion et aux grands mots ronflant – que l’on aime à confondre avec les choses. On croit encore que l’humain n’est qu’un ange déchu que ses mérites existentiels suffiraient à remplumer, une page blanche où « la société » écrirait tout le bien, qu’il a le « droit moral » de choisir pour éviter tout le mal – sans que Bien ou Mal ne soient vraiment définis autrement que « par ce qui est admis », donc ce que tout le monde aspire à faire – et qu’enfin ce choix détermine sa vertu au regard d’une justice immanente. Même si Dieu est mort, les laïcs de gauche croient encore en une Balance suprême…
« Le tragique est d’abord ce qui nous permet de vivre, ce qui est le plus chevillé au corps de l’homme, c’est l’instinct de vie par excellence » p.49. La vitalité est source de la joie, la grande joie dionysiaque de Nietzsche, « semblable à Hamlet ; tous deux ont plongé dans l’essence des choses un regard décidé : ils ont ‘vu’, et ils sont dégoûtés de l’action, parce que leur activité ne peut rien changer à l’essence éternelle des choses ». Connaître empêche parfois d’agir, il faut à l’action le mirage de l’illusion.
Mais le tragique n’est pas l’à-quoi-bon ? S’il est étranger à toute mise en question, il est lui-même l’éternel scandale. La vie vaut moins que l’homme, elle emprisonne, mais l’humain est le plus grand. Être homme, c’est ce courage s’assumer toutes les situations, bien que l’on n’ait aucune prise sur elles. Sans la responsabilité, que resterait-il de la liberté, donc de l’humanité ? L’estime de soi est allégresse. « L’héroïsme n’est pas un élément tragique : c’est le tragique qui engendre l’héroïsme » p.74. L’homme vaut plus que toute chose car il est le seul à posséder cette valeur-là. « La valeur réside dans l’exception, l’ordre des choses’, lui, est platitude » p.88.
La morale commence avec le non au tragique, par le refus du réel. Socrate avait senti l’incompatibilité entre morale et religion, cette conscience tragique de l’existence. Il fut donc le premier « blasphémateur » par peur et par haine de l’instinct religieux, blasphémateur du don tragique qui explique à la société les contradictions de la vie et des valeurs. Le refus d’affronter précède le refus d’admettre. Il conduit à l’absence de respect devant l’Être. La pitié, par exemple, consiste à s’illusionner sur autrui et écarte la réaction saine du mépris. Mépriser constitue une douleur morale intolérable : « entrer dans la pitié, c’est refuser de considérer que le méprisable est méprisable, c’est s’aveugler sur la réalité tragique, c’est fuir devant la souffrance » p.122. Avoir pitié, c’est fuir devant le réel humain, préférer l’illusion, réagir par atavisme moral (idéal) contre le tragique (réel) qui fait trop mal. Alors que la générosité est une force active qui aide dans la réalité son prochain par surcroît de vitalité et empathie pour endiguer ce qui va contre la vie.
Le moralisme triomphant secrète la bêtise, heureuse et sûre d’elle-même comme une vache à l’étable qui rumine son foin et regarde, quiète, passer les trains. L’idée bête du bonheur refuse l’irréconciliable pour lui substituer le « mieux ». Elle espère une solution de synthèse pour l’avenir, un « progrès » : c’est Socrate contre Sophocle, Voltaire contre Pascal.
Meurt alors l’innocence du devenir : le « mérite » est la causalité introduite dans le monde des valeurs. Si chacune a « sa raison », ce sens causal exerce une tyrannie et fait régner un esprit de sérieux clérical. Telle est l’Église solennelle de l’Inquisition, la sévérité puritaine des sectes, l’esprit de purification de la Terreur et de Daesh, la « ligne » de Lénine ou Staline, le « cant » victorien et le « politiquement correct ».
Un ancien petit livre encore tout frais de ses découvertes toujours actuelles.
Clément Rosset, La philosophie tragique, 1960, PUF Quadrige 2014, 204 pages, €11.00
Clément Rosset sur ce blog

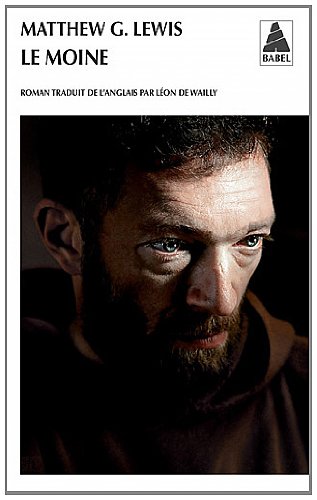

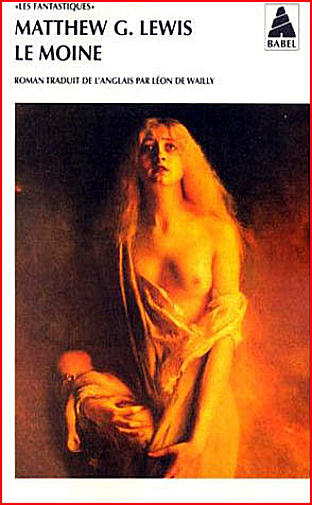
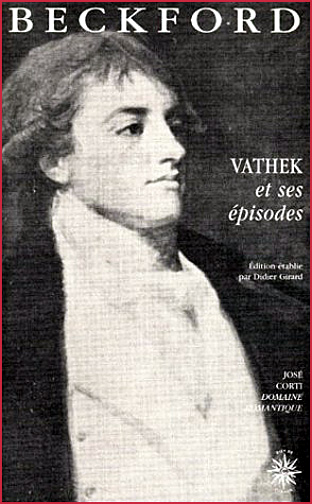
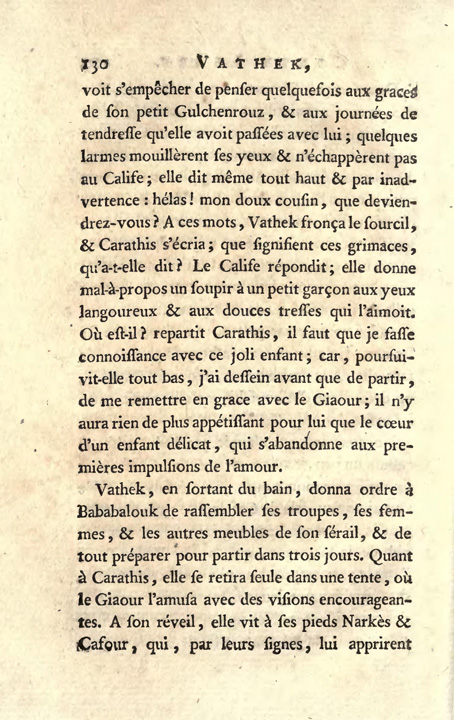








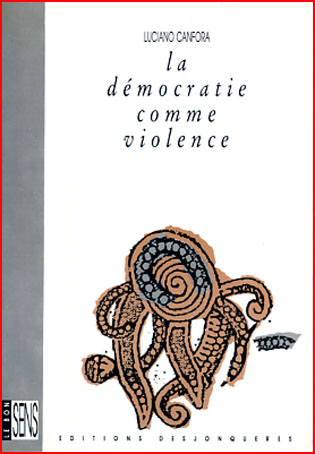





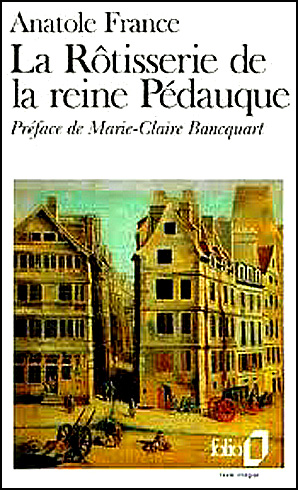



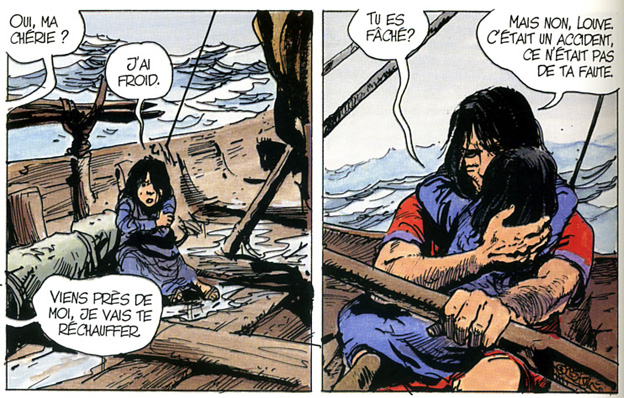

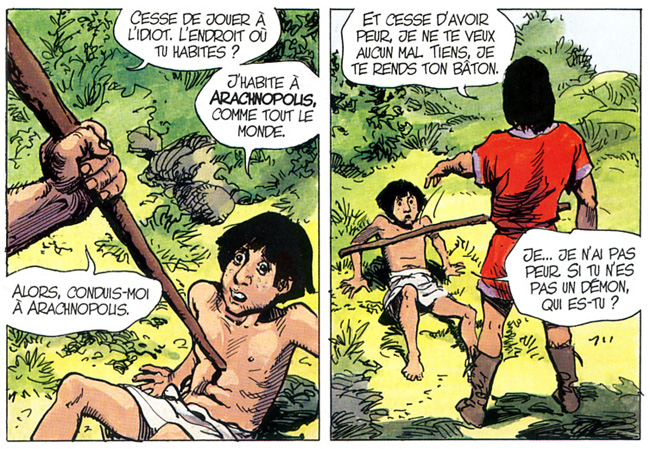






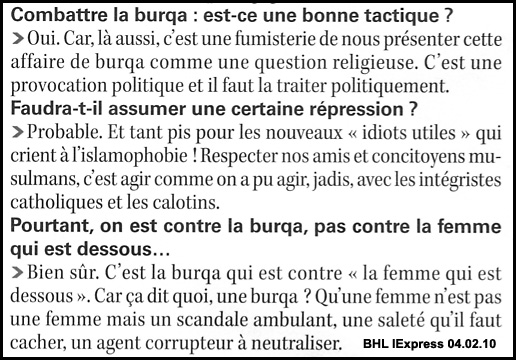






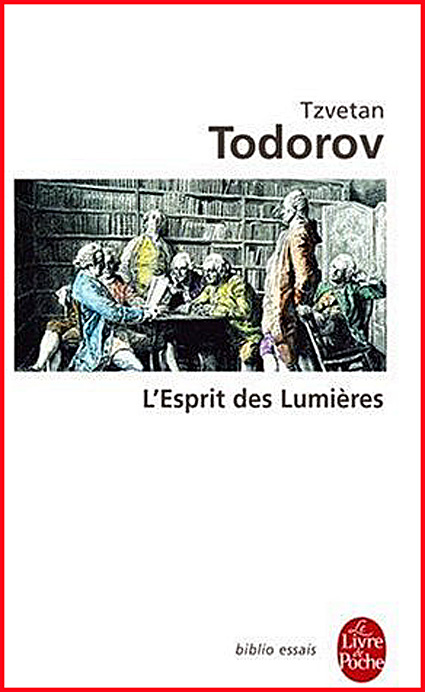
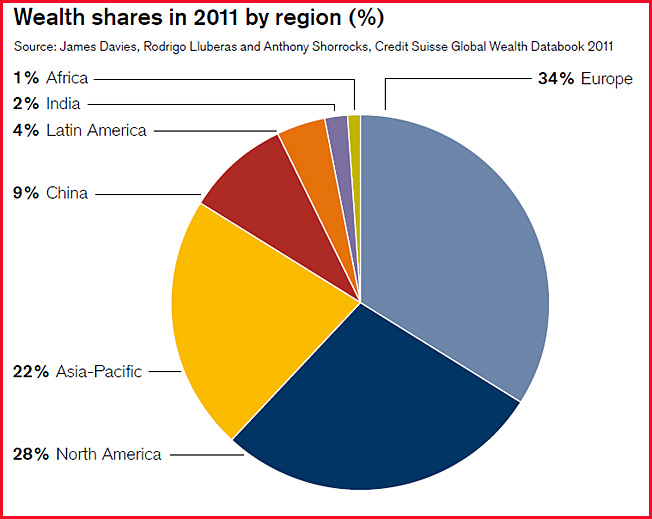















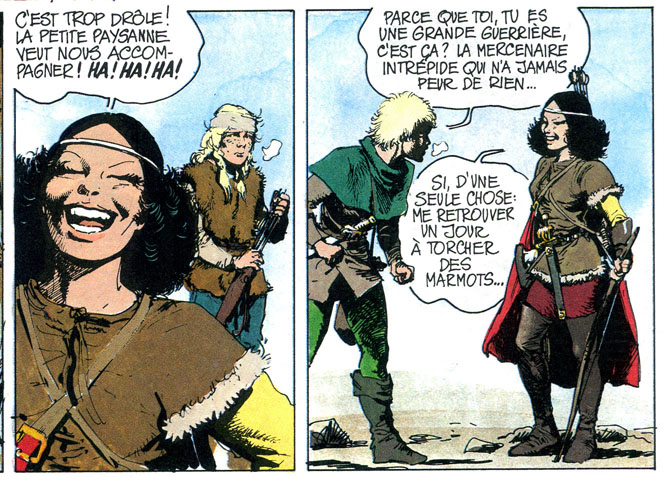


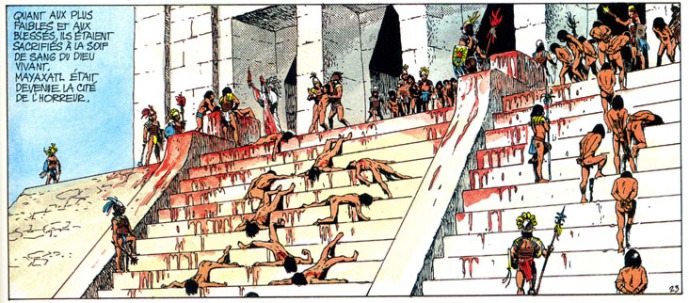

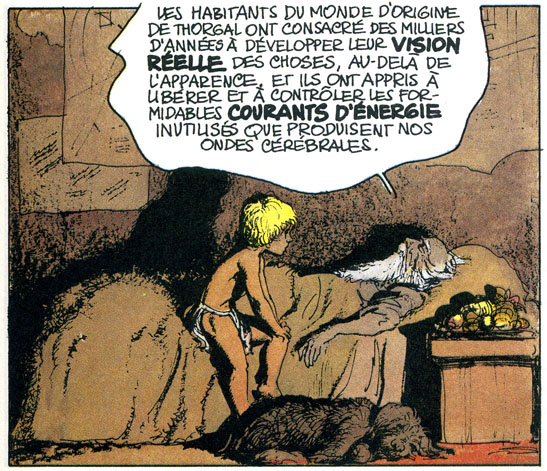
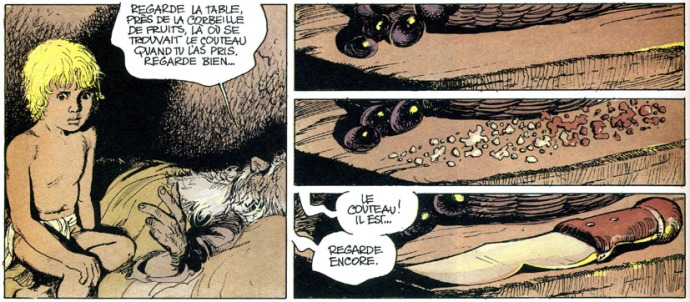



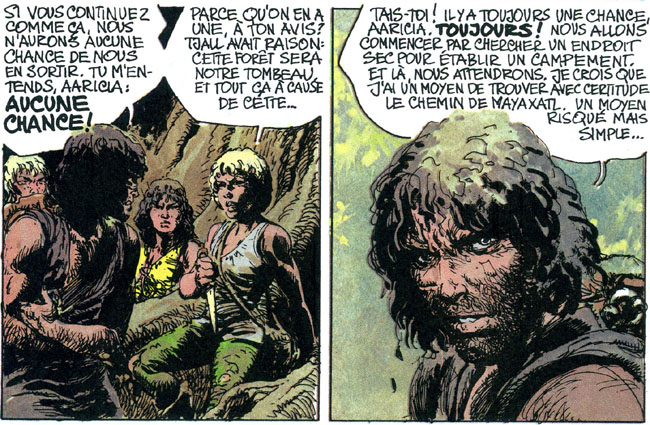
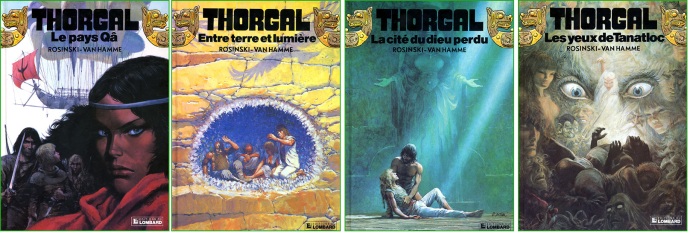
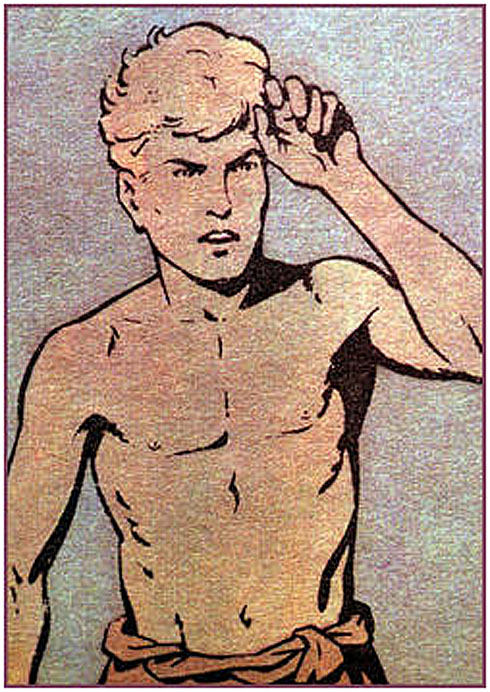


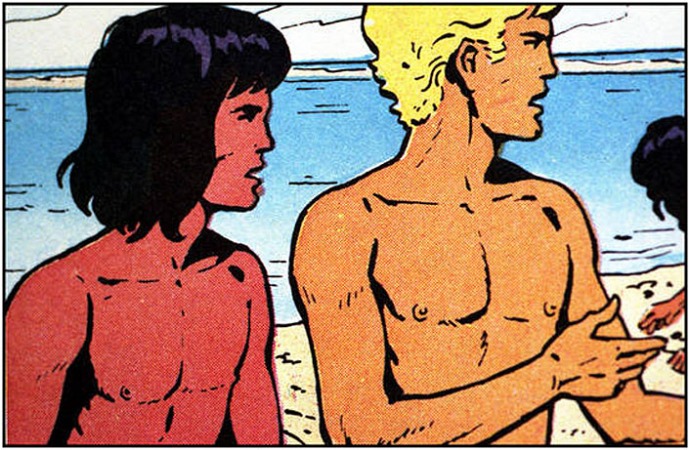

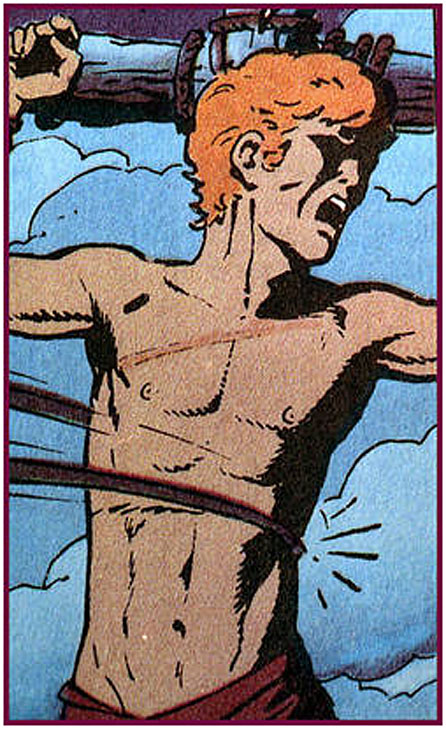
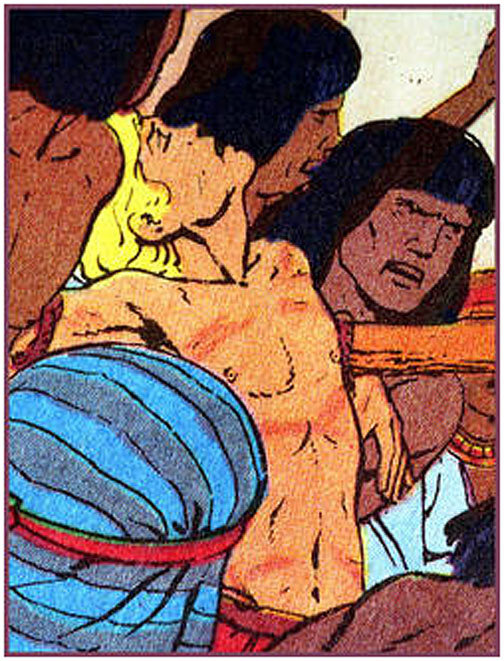
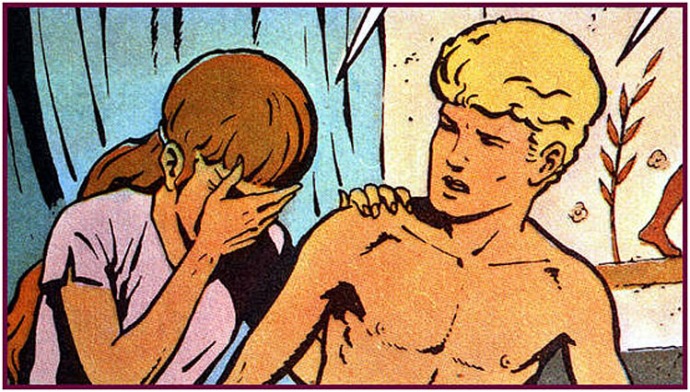
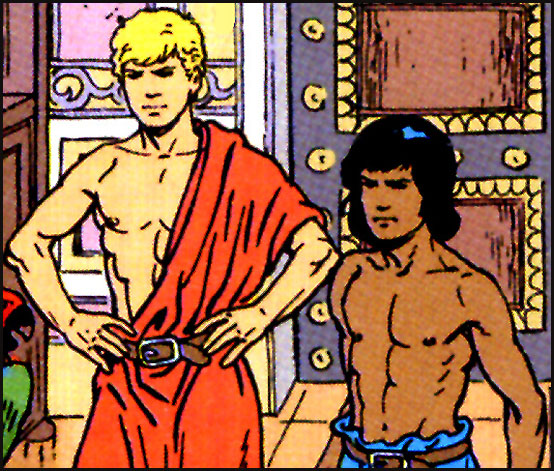
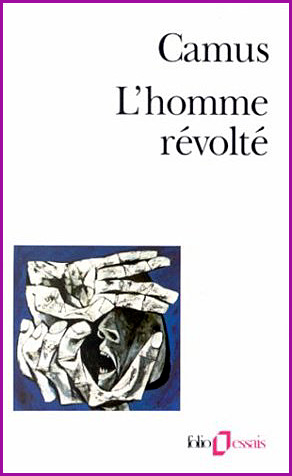
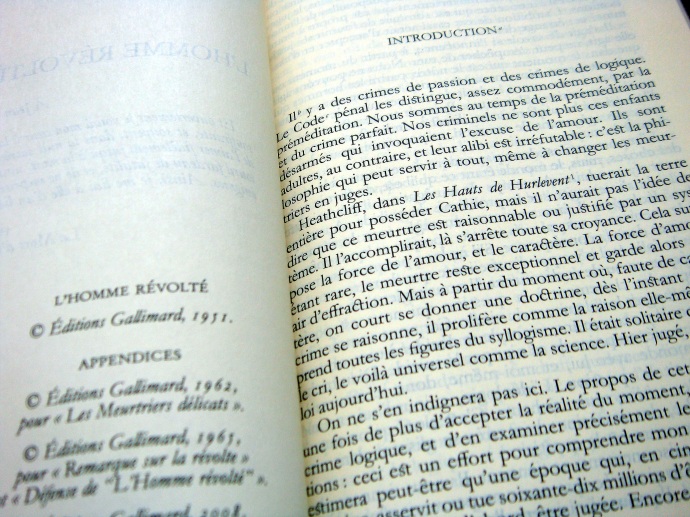






Commentaires récents