Retour aux années 30 ? 2013 = 1933 ? Drieu, surréaliste tenté par le communisme avant de suivre Doriot (devenu fasciste) avait diagnostiqué la situation de son époque. elle ressemble à la nôtre par les hommes (aussi médiocres), mais pas par les circonstances (l’histoire ne se répète jamais).
Dans Gilles, Drieu passe une volée de bois vert aux politiciens et autres intellos tentés par le pouvoir. « La politique, comme on le comprend depuis un siècle, c’est une ignoble prostitution des hautes disciplines. La politique, ça ne devrait être que des recettes de cuisine, des secrets de métier comme ceux que se passaient, par exemple, les peintres. Mais on y a fourré cette absurdité prétentieuse : l’idéologie. Appelons idéologie ce qui reste aux hommes de religion et de philosophie, des petits bouts de mystique encroûtés de rationalisme. Passons » p.927.

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…
Pourtant, le communisme pouvait être une idéologie intéressante. Déjà, « la foi politique fournit aux paresseux, aux déclassés et aux ratés de toutes les professions une bien commode excuse » p.1195. De plus, l’instrument du parti est appelé à créer une nouvelle noblesse d’État : « Qu’est-ce qui le séduisait dans le communisme ? Écartée la ridicule prétention et l’odieuse hypocrisie de la doctrine, il voyait par moments dans le mouvement communiste une chance qui n’était plus attendue de rétablir l’aristocratie dans le monde sur la base indiscutable de la plus extrême et définitive déception populaire » p.1195. D’où le ripage de Jacques Doriot du communisme au fascisme, du PC au PPF. Il y a moins d’écart qu’on ne croit entre Mélenchon et Le Pen.
Mais les intellos n’ont pas leur place en communisme, ils préfèrent le libéralisme libertaire des années folles (1920-29), et ce n’est pas différent depuis mai 68. Ils ne sont à l’aise que dans la déconstruction, la critique – certainement pas dans la création d’un mythe politique (voir les déboires actuels de l’écologisme), encore moins dans l’action ! « Il y avait là des intellectuels qui étaient entrés niaisement avec leur libéralisme dans le communisme et se retrouvaient, l’ayant fui, dans un anarchisme difficile à avouer tant de lustres après la mort de l’anarchie. Quelques-uns d’entre eux cherchaient un alibi dans le socialisme de la IIè Internationale où, dans une atmosphère de solennelle et impeccable impuissance, ils pouvaient abriter leurs réticences et leurs velléités, leurs effarouchements et leurs verbeuses indignations. A côté d’eux, il y avait des syndicalistes voués aux mêmes tourments et aux mêmes incertitudes, mais qui se camouflaient plus hypocritement sous un vieux vernis de réalisme corporatif » p.1233. Vous avez dit « indignation » ? Toujours la posture morale de qui n’est jamais aux affaires et ne veut surtout pas y être.
Les meetings politiques ou les congrès sont donc d’une pauvreté absolue, cachant le vide de projet et d’avenir sous l’enflure de la parole et le rappel du glorieux passé. François Hollande et Harlem Désir font-ils autre chose que causer ? Proposer des mesurettes dans l’urgence médiatique (tiens, comme Sarkozy…) ? « Mais au bout d’une heure, il lui fallait sortir, excédé de tant de verbiage pauvre ou de fausse technique. Il était épouvanté de voir que tout ce ramassis de médiocres à la fois arrogants et timorés vivaient avec leurs chefs dans l’ignorance totale que put exister une autre allure politique, une conception plus orgueilleuse, plus géniale, plus fervente, plus ample de la vie d’un peuple. C’était vraiment un monde d’héritiers, de descendants, de dégénérés et un monde de remplaçants » p.1214. »Remplaçants » : pas mal pour François Hollande, désigné au pied levé pour devenir candidat à la place de Dominique Strauss-Kahn, rattrapé – déjà – par la faillite morale.
Il faut dire que la France majoritairement rurale de l’entre-deux guerres était peu éduquée ; les électeurs étaient bovins (« des veaux », dira de Gaulle). La France actuelle, majoritairement urbaine, est nettement mieux informée, si ce n’est éduquée ; l’individualisme critique est donc plus répandu, ce qui est le sel de la démocratie. Rappelons que le sel est ce qui irrite, mais aussi ce qui conserve, ce qui en tout cas renforce le goût.

On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.

En politique, « tout est mythologie. Ils ont remplacé les démons, les dieux et les saints par des idées, mais ils n’en sont pas quittes pour cela avec la force des images » p.1209. La politique doit emporter les foules, mais la mystique doit aussi se résoudre en (petite) politique, forcément décevante. Les politiciens tentent aujourd’hui de pallier la désillusion par la com’.
Drieu l’observe déjà sur le costume démocratique : « Il vérifiait sur le costume de M. de Clérences qu’il était un homme de gauche. Clérences avait prévu cela depuis quelque temps : il s’était fait faire un costume merveilleux de frime. ‘La démocratie a remplacé le bon Dieu, mais Tartufe est toujours costumé en noir’, s’était exclamé à un congrès radical un vieux journaliste. En effet, à cinquante mètre, Clérences paraissait habillé comme le bedeau d’une paroisse pauvre, gros croquenots, complet noir de coupe mesquine, chemise blanche à col mou, minuscule petite cravate noire réduisant le faste à sa plus simple expression, cheveux coupés en brosse. De plus près, on voyait que l’étoffe noire était une profonde cheviotte anglaise, la chemise du shantung le plus rare et le croquenot taillé et cousu par un cordonnier de milliardaires » p.1150. François Hollande est aussi mal fagoté que les radicaux IIIè République. Il en joue probablement ; il se montre plus médiocre, plus « camarade » qu’il ne l’est – pour mieux emporter le pouvoir. Et ça marche. C’est moins une société juste qui le préoccupe que d’occuper la place… pour faire juste ce qu’il peut. « Une apologie de l’inertie comme preuve de la stabilité française » p.1216, faisait dire Drieu à son père spirituel inventé, Carentan.

Mais est-ce cela la politique ? Peut-être… puisque désormais les grandes décisions se prennent à Bruxelles, dans l’OTAN, au G7 (voire G2), à l’ONU. La politique n’est plus la mystique mais de tenir la barre dans les violents courants mondiaux. « (Est-ce qu’un grand administrateur et un homme d’État c’est la même chose ? se demanda Gilles. Non, mais tant pis.) Tu n’es pas un apôtre » p.1217.
Est-il possible de voir encore surgir des apôtres ? Drieu rêve à la politique fusionnelle, qui ravit l’être tout entier comme les religions le firent. Peut-être de nos jours aurait-il été intégriste catholique, ou converti à la charia, ou jacobin industrialiste, autre version nationale et socialiste inventée par le parti communiste chinois depuis 1978. Drieu a toujours cherché l’amour impossible, avec les femmes comme avec la politique, fusionnel dans le couple, totalitaire dans le gouvernement.
Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.
Nos politiciens sont tous sortis du même moule. Du temps de Drieu c’était de Science Po, du droit et de la coterie des salons parisiens ; aujourd’hui presqu’exclusivement de l’ENA et des clubs parisiens (le Siècle, le Grand orient…). Un congrès du PS ressemble fort à un congrès radical : « Ils étaient tous pareils ; tous bourgeois de province, ventrus ou maigres, fagotés, timides sous les dehors tapageurs de la camaraderie traditionnelle, pourvus du même diplôme et du même petit bagage rationaliste, effarés devant le pouvoir, mais aiguillonnés par la maligne émulation, alors pendus aux basques des présidents et des ministres et leur arrachant avec une humble patience des bribes de prestige et de jouissance. Comme partout, pour la masse des subalternes, il n’était point tellement question d’argent que de considération » p.1212. Pas très enthousiasmant, mais le citoyen aurait vite assez de la mobilisation permanente à la Mélenchon-Le Pen : déjà, un an de campagne présidentielle a lassé. Chacun a d’autres chats à fouetter que le service du collectif dans l’excitation perpétuelle : sa femme, ses gosses, son jardin, ses loisirs. Le je-m’en-foutisme universel des pays du socialisme réel l’a bien montré.
Dans le spectacle politique, rien n’a changé depuis Drieu. Les intellos sont toujours aussi velléitaires ou fumeux, les révolutionnaires toujours aussi carton-pâte, les politiciens tout autant administrateurs fonctionnaires, et les militants dans l’illusion permanente avides du regard des puissants (à écouter le syndicaliste socialiste Gérard Filoche aux Matins de France-Culture, on est consterné). Même s’il ne faut pas le suivre dans ses choix d’époque, Drieu La Rochelle reste un bon analyste de l’animalerie politique. Il n’est jamais meilleur que lorsqu’il porte son regard aigu sur ses contemporains.
Pierre Drieu La Rochelle, Gilles, 1939, Folio 1973, 683 pages, €8.64
Pierre Drieu La Rochelle, Romans-récits-nouvelles, édition sous la direction de Jean-François Louette, Gallimard Pléiade 2012, 1834 pages, €68.87
Les numéros de pages des citations font référence à l’édition de la Pléiade.
Tous les romans de Drieu La Rochelle chroniqués sur ce blog.



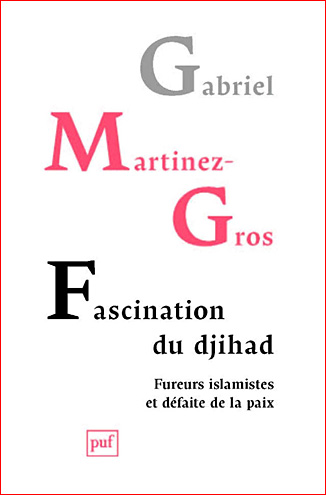



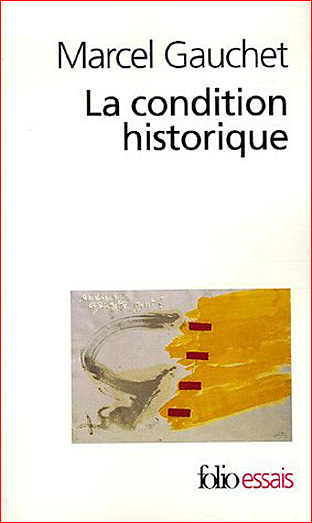




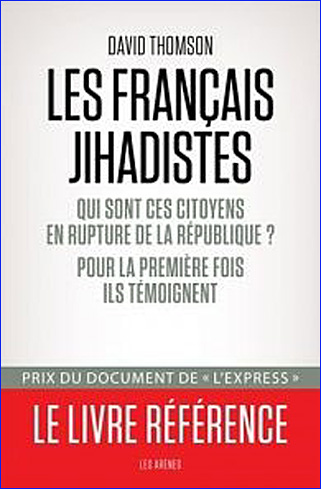



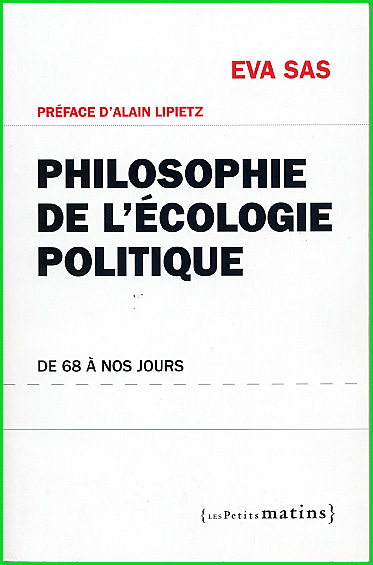










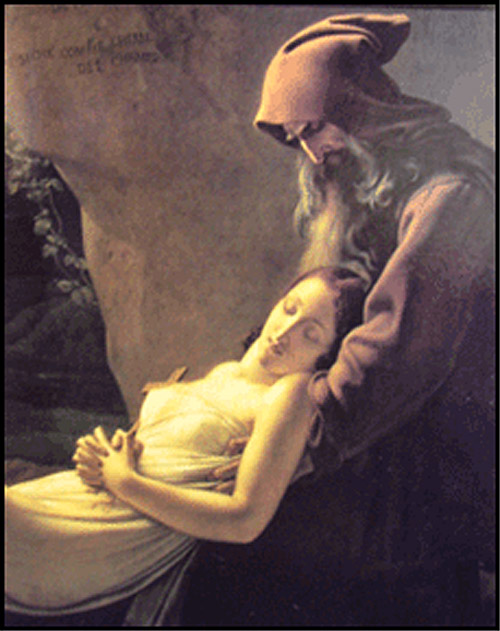

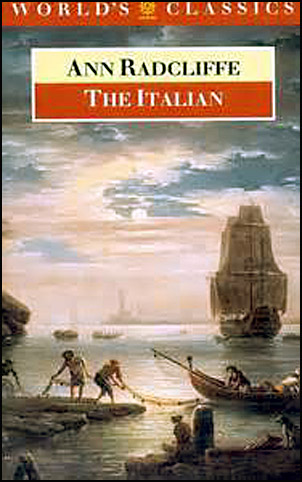





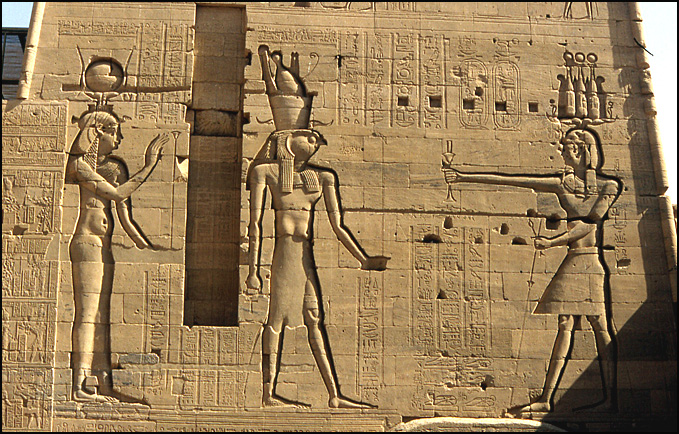




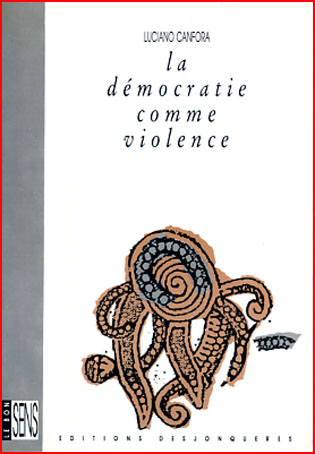






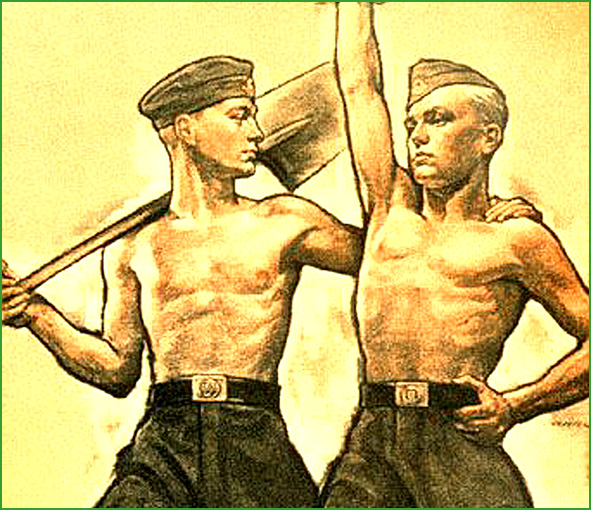







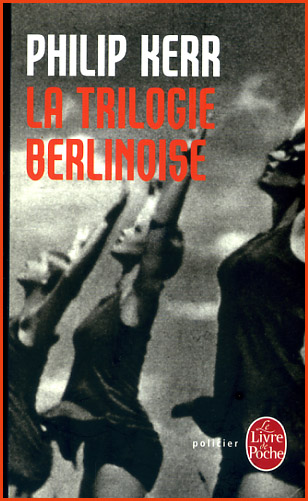
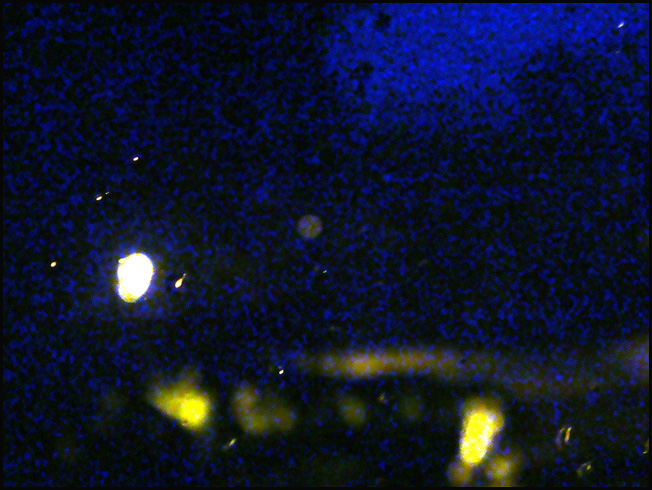


















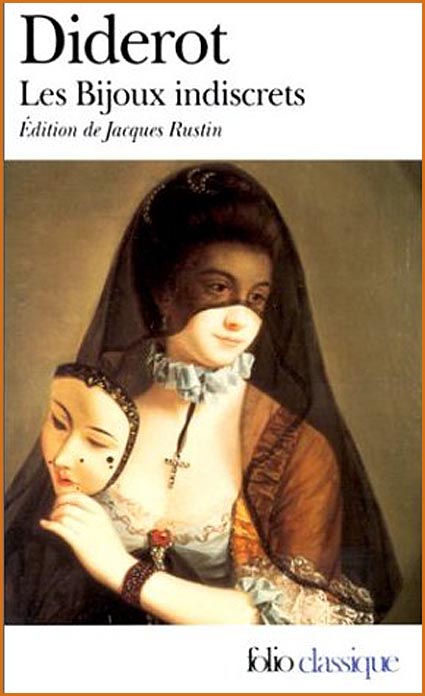

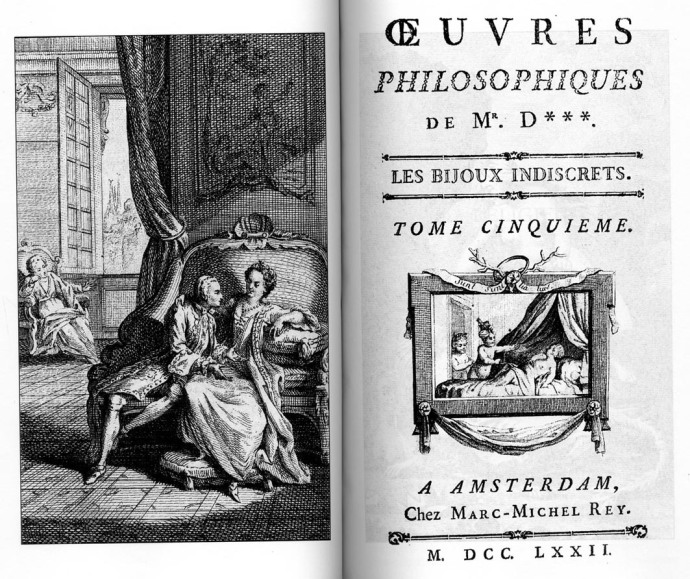
Tuer le rire ?
L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.
Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.
La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »
Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.
Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?
Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?
Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.
Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.
Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?
C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.
Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…
L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.
Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?
Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.